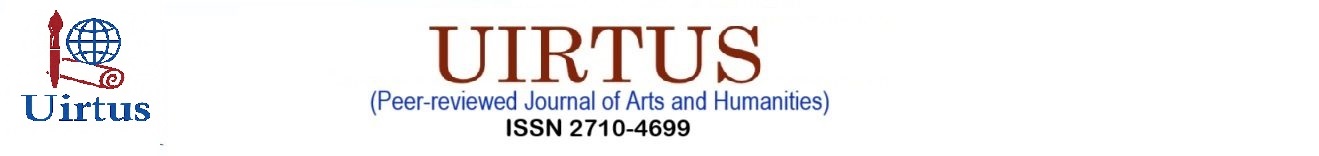Résumé : La survenue d’une maladie que l’on ne peut pas guérir même si on peut la soigner, vient briser le vécu fluide du temps. L’hypertension artérielle est une affection de longue durée, évolutive souvent associée à une invalidité. La présente recherche a pour objectif d’évaluer le vécu de la maladie chronique chez les patients hypertendus suivis au CHU Campus de Lomé. Les données ont été collectées par entretien semi-directif et traitées avec le logiciel statistique Sphinx et la méthode logico-sémantique de l’analyse de contenu. Au bout de l’étude, nous avons retrouvé un vécu favorable dans 66,7% des cas marqués par un vécu de la maladie comme un moyen d’apprécier la valeur de la vie. Le vécu péjoratif s’est manifesté par un vécu de la maladie par un sentiment de persécution (44,4%). Au vu des résultats de cette étude, il importe de proposer systématiquement une prise en charge psychologique aux patients hypertendus pour améliorer leur vécu de la maladie et par conséquent leur qualité de vie.
Mots-clés : Maladie chronique hypertension, prise en charge psychologique
Abstract: The occurrence of a disease that cannot be cured even if it can be cured, breaks the fluid experience of time. High blood pressure is a long-lasting, progressive condition often associated with disability. The objective of this research was to assess the experience of chronic disease in hypertensive patients followed at the CHU Campus de Lomé. Data were collected by semi-structured interview and processed with Sphinx statistical software and the logical-semantic method of content analysis. At the end of the study, we found a favorable experience in 66.7% of cases marked by an experience of the disease as a means of appreciating the value of life. The pejorative experience manifested itself as an experience of the disease through a feeling of persecution (44.4%). In view of the results of this study, it is important to systematically offer psychological care to hypertensive patients to improve their experience of the disease and their quality of life.
Keywords: Chronic disease, hypertension, psychological care.
Introduction
Les maladies chroniques sont ces maladies qui durent toute la vie ou du moins très longtemps et se confondent généralement avec la vie du patient. Ces maladies se caractérisent au-delà de leur durée, par l’ampleur de leurs répercussions sur la vie quotidienne des patients et de leur entourage. Elles affectent plusieurs aspects de la vie personnelle, affective, familiale, sociale et professionnelle. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2005), les définit comme un problème de santé qui nécessite une prise en charge sur une période de plusieurs années ou plusieurs décennies. Souvent incurables, seules leurs conséquences peuvent être traitées.
La maladie chronique, en raison même de son incurabilité, bouleverse le rapport au temps. L’homme sait bien que la mort l’attend au bout du chemin, mais il se comporte quotidiennement comme si la vie n’avait pas de fin (Grimaldi). Ces pathologies comprennent les cardiopathies (dont l’hypertension artérielle (HTA)), les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les cancers, les maladies respiratoires chroniques et les diabètes. Selon le rapport de l’OMS (2014), 68 % des décès dans le monde en 2012 ont été causés par une maladie chronique non transmissible, soit 38 millions de personnes. En 2030, le nombre de décès pourrait dépasser les 52 millions.
L’hypertension artérielle (HTA) est, selon l’OMS (2016) une pathologie cardiovasculaire définie par une pression artérielle trop élevée (pression artérielle systolique supérieure 140mmHg et une pression artérielle diastolique supérieure 90mmHg) et un facteur de risque majeur de l’accident vasculaire cérébral (AVC). Elle touche plus d’un adulte sur trois (OMS, 2016). Au-delà d’un simple facteur de risque de l’AVC, l’hypertension artérielle est une véritable maladie à caractère chronique et doit être prise au sérieux.
Même si on ne guérit pas de l’hypertension artérielle, elle peut être bien soignée et la prise en charge permet aux patients de bien vivre plus longtemps sans complications handicapantes. Selon une étude faite au Togo (Baragou), l’hypertension artérielle représenterait 36,7% de la population générale à Lomé et 74,29% des admissions dans le service de cardiologie du CHU campus, chez les sujets de plus de 50 ans. Malgré la gravité et les conséquences qu’entraîne cette maladie, beaucoup d’études ont montré que la moitié des patients pris en charge n’atteignent pas les objectifs des recommandations. En effet, il existe des discordances évidentes entre les possibilités thérapeutiques et le contrôle de la pression artérielle chez les patients hypertendus (Grillat). Cette non-concordance entre les recommandations médicales et le comportement du patient est qualifiée de « non-observance » ou « mauvaise observance » thérapeutique. Beaucoup d’études se sont penchées sur la notion d’observance thérapeutique pour comprendre le malade hypertendu, sous traitement antihypertenseur, qui, malgré tous les progrès qui ont pu être faits dans le domaine de la santé ces trente dernières années, se retrouve avec une hypertension non contrôlée (El Aassri et al., Pio et al.).
Des études également se sont intéressées aux aspects psychologiques associés à la maladie chronique. Ainsi, Kieffer explorant le vécu de la maladie et de la guérison chez les adolescents ayant souffert de cancer, avait noté que l’irruption brutale du cancer dans la vie d’un enfant ou d’un adolescent est un bouleversement majeur pour lui et l’ensemble de sa famille. Cet auteur a, en outre relevé des difficultés chez une minorité qui peuvent être des séquelles physiques, psychologiques ou sociales qui remettent en cause la notion de guérison, et qui peut constituer un traumatisme en elle-même. Il y a été relevé une détresse importante dans différents domaines de la vie. Ainsi, l’image du corps et l’estime de soi ont été souvent altérées chez ces jeunes patients ; des préoccupations quant à une éventuelle stérilité ou des troubles sexuels parfois sévères sont retrouvés (Kieffer). N’djessan et al. avaient trouvé à l’institut de cardiologie d’Abidjan que la perception de l’HTA par les patients dès la découverte était de deux ordres : comme une maladie normale (94,2%) et comme une maladie mystérieuse (8,8%). Le vécu dès l’annonce de la maladie aux patients se traduisait d’une part par l’espoir de guérir définitivement du fait de l’existence d’un traitement (33,5%) et d’autre part des craintes d’une non-assistance familiale. Ces auteurs ont noté qu’après trois mois de prise en charge, la perception de l’HTA n’avait pas très évolué, et des souffrances psychologiques étaient toujours observées.
Au Togo, les études sur le vécu de la maladie se sont peu intéressées à l’HTA. Ainsi, Mendouna avait évalué le vécu psychologique des personnes vivant avec le VIH/SIDA et l’influence de l’entourage. Il en est ressorti que 93,50% des patients vivaient l’infection au VIH/SIDA comme une déception et un découragement, 91,87% comme une honte, une indignité, une immoralité ; 82,93% comme un effondrement de l’image de soi, 82,93% comme une atteinte narcissique ; enfin dans 75,61% des cas, l’infection à VIH était vécue comme une persécution imaginaire et une incompréhension. La culpabilité avait été retrouvée dans 56,10% des cas et 60,98% des cas vivaient leur état sérologique comme une incapacité à se reproduire et 20,33% des cas de PVVIH/SIDA vivaient un rejet de la sexualité.
Par ailleurs, dans le cas de la drépanocytose, Kpedzroku avait trouvé un vécu péjoratif, marqué par une notion de dépendance et de faiblesse, une dépréciation de l’image de soi difficile à supporter.
Nous constatons de toute évidence un manque de données sur le vécu de l’HTA. Or, il est admis que la découverte du diagnostic d’une maladie chronique provoque une rupture biographique dans la trajectoire de vie du sujet (Keffane). Cette rupture amène le malade à chercher du sens à la maladie, et il lui faut trouver une trajectoire de vie avec ce qu’il est maintenant. Ce qui nécessite une reconstruction biographique, qui a pour but à la fois de réparer la coupure dans le fil de la vie, introduit par la maladie et de réapprendre à vivre avec la maladie chronique et avec les autres. Une des clés de la prise en charge efficace de la maladie chronique est la gestion de cette transformation identitaire, tant chez le malade qui se sent devenir autre que dans l’entourage, qui vit le changement (Keffane). Pour aider le malade à ce réapprentissage et pour une prise en charge médicale efficace, il importe de s’intéresser au vécu de la maladie par le patient et son entourage. D’où l’intérêt de la présente étude.
L’objectif de cette étude est d’évaluer le vécu de la maladie chronique chez les malades hypertendus accueillis au CHU Campus de Lomé.
1. Matériels et méthodes
La présente étude s’est déroulée dans le service de cardiologie du CHU-Campus de Lomé (Togo) sur une période de 2 mois (de février à mars 2021). Il s’agit d’une étude prospective qui a été effectuée sur un échantillon de 63 patients suivis dans le dit service. L’échantillon a été constitué à l’aide de la technique du tout-venant. Ont été inclus dans notre échantillon d’étude, tous les patients hypertendus ayant connaissance de leur maladie et sous traitement depuis au moins un mois, et présents dans le service de cardiologie pendant la période de l’étude. N’ont pas été inclus dans notre étude, tous les patients n’ayant pas eu de confirmation de leur HTA par un diagnostic ou dont l’état clinique ne permettait pas de faire un entretien avec eux.
Les données ont été collectées par entretien semi-directif, à l’aide d’un guide d’entretien.
Les principales thématiques explorées au cours de l’entretien sont :
- Les caractéristiques socio-démographiques à savoir le sexe, l’âge, le secteur d’activité, entre autres
- Les données sur la maladie, notamment le type d’hypertension artérielle, le temps écoulé depuis la découverte de l’HTA, les circonstances de découverte de la maladie, d’autres comorbidités, les complications liées à l’HTA, le nombre de médicaments pris contre l’HTA
- Le vécu de la maladie : deux sous thématiques ont été exploré : le vécu favorable et le vécu péjoratif. Pour évaluer le vécu favorable, les sentiments favorables par rapport à la maladie tels qu’un défi à relever, un moyen d’apprécier la qualité de la vie, ou un vécu de bénéfices secondaires ont été exploré. Le vécu péjoratif a concerné l’exploration des sentiments désagréables par rapport à la maladie tels que : la persécution, le déni de son état de santé, la dépendance financière, l’épuisement…
Les données recueillies ont été traitées et analysées à l’aide des statistiques descriptives, permettant le calcul des effectifs, fréquences et pourcentages. Le logiciel statistique Sphinx a été utilisé à cet effet. L’analyse qualitative a été faite avec la méthode logico-sémantique de l’analyse de contenu.
Sur le plan éthique, nous avons sollicité et obtenu une autorisation de la part de la direction du CHU Campus. En plus, avant tout entretien, nous avons expliqué les objectifs de la recherche aux participants et obtenus leur consentement éclairé.
2. Résultats de la recherche
2.1. Caractéristiques de la population d’étude
Tableau 1 : caractéristiques socio-démographiques des enquêtés
| Caractéristiques sociodémographiques | Effectif | Pourcentage | |
| Sexe | Masculin | 25 | 39,68% |
| Féminin | 38 | 60,3% | |
| Total | 63 | 100% | |
| Tranche d’âge | [30-39] [40-49] | 8 12 | 12,69% 19,04% |
| [50-59] | 12 | 19,04% | |
| [60-69] [70 et plus | 18 13 | 28,57% 20,63% | |
| Total | 63 | 100% | |
| Secteur d’activité Total | Ménagère | 8 | 12,69% |
| Secteur privé informel (commerçant, artisan, …) | 28 | 44,44% | |
| Retraité | 14 | 22,22% | |
| Salariés | 13 | 20,63% | |
| 63 | 100% |
Les sujets de notre étude sont en majorité de sexe féminin, soit 60,3% avec une sex-ratio H/F de 0,65. Ils sont majoritairement âgés de plus 50 ans (68,2%), avec un âge moyen de 56,11. Les sujets exerçant dans le secteur privé informel (44,4%) et les retraités (22,2%) sont les plus représentés.
Tableau 2 : Répartition des patients selon les données sur la maladie
| Données sur la maladie | Effectif | % | |
| Type d’hypertension | HTA Primaire | 55 | 87,30% |
| HTA Secondaire | 8 | 12,70% | |
| Temps écoulé depuis la découverte de la maladie (année) | 1 à 5 | 39 | 61,90% |
| 5 à 10 | 11 | 17,50% | |
| 10 à 15 | 10 | 15,90% | |
| 16 à 20 | 2 | 3,20% | |
| 21 à 25 | 1 | 1,16% | |
| Circonstance de découverte de l’HTA | Au cours d’une maladie | 28 | 44,40% |
| Au cours d’un bilan de santé | 8 | 12,70% | |
| Au cours d’une grossesse | 3 | 4,80% | |
| A la suite l’accouchement | 2 | 3,20% | |
| A la suite d’un malaise | 19 | 30,20% | |
| Lourdeur des jambes | 3 | 4,80% | |
| Autres maladies chroniques comorbides | Diabète | 7 | 11,10% |
| Insuffisance cardiaque | 8 | 12,70% | |
| Asthme | 2 | 3,20% | |
| Complications liées à l’HTA | Aucune complication | 51 | 81,00% |
| Insuffisance cardiaque | 7 | 11,10% | |
| AVC | 4 | 6,30% | |
| Nombre de médicament pris pour l’HTA | 1 médicament | 36 | 57,14% |
| 2 médicaments | 21 | 33,33% | |
| 3 médicaments | 6 | 9,52% |
De ce tableau, il ressort que l’hypertension artérielle primaire (essentielle) est la plus fréquente (87,3%) ; 81% des enquêtés n’ont pas développé de complications liées à l’hypertension artérielle, cependant 11,1% des enquêtés ont fait un accident vasculaire cérébral (AVC). Par ailleurs, 61,9% sont au courant de leur HTA depuis 1 à 5 ans. La découverte de l’HTA s’est faite le plus souvent au cours d’une maladie (44,4%). 57,14% des enquêtés prenaient un seul produit pour leur hypertension artérielle, tandis que 33,33% en prennent deux.
2.3. Vécu de l’hypertension artérielle
Nous avons répertorié deux types de vécu de la maladie : le vécu péjoratif et le vécu favorable.
Tableau 3 : Répartition des patients enquêtés selon le vécu péjoratif de la maladie
| Vécu péjoratif | Fréquence | Pourcentage |
| Sentiment d’être persécuté | 28 | 44,44% |
| Sentiment de déni de son état de santé | 38 | 60,31% |
| Sentiment d’être dépendant financièrement | 21 | 33,33% |
| Sentiment d’épuisement | 8 | 12,69 |
L’analyse des résultats sur le vécu péjoratif, relève que 60,31% des enquêtés vivent un sentiment de déni de la maladie, 44,44% des patients vivent un sentiment de persécution et 33,33 % vivent la maladie comme à l’origine d’une dépendance financière.
Tableau 4 : Répartition des enquêtés selon le vécu favorable de la maladie
| Vécu favorable | Fréquence | (%) |
| Maladie vécue comme un défi à relever | 24 | 38,09% |
| Maladie vécue comme moyen d’apprécier la valeur de la vie | 42 | 66,66% |
| Vécu de bénéfices secondaires | 15 | 23,80% |
Le vécu favorable de la maladie s’est manifesté le plus fréquemment comme un moyen d’apprécier la vie (66,66%), comme un défi à relever (38,09%) et par un vécu des bénéfices secondaires (23,80%).
Nous avons relevé dans notre étude une prédominance féminine (60,3%) avec une sex-ratio H/F de 0,65. N’djessan et al. en Côte-d’Ivoire avaient fait le même constat avec une prédominance féminine à 58%. Yayehd et al. (2011), au Togo avait trouvé une prédominance féminine avec 34,6 % des hommes et 38,4 % des femmes hypertendus. Une prédominance féminine (sex-ratio F/H=1,64) avait été également relevé par Atta at al. au Togo.
Les sujets de notre recherche sont majoritairement âgés de plus de 50 ans (68,2%), avec un âge moyen de 56,11 ans. Nos données sont similaires à celles de N’djessan et al. qui ont trouvé un âge moyen de 58,8 ans avec des extrêmes de 28 et 87 ans. Ces données sont également en concordance avec celle de de Baramoue et al. au Congo Brazzaville qui ont indiqué que 65,5% de patients de leur étude ont un âge supérieur à 50 ans. Au Togo, Atta et al. ont relevé un âge moyen de 52 ± 13 ans. Cette moyenne d’âge confirme que l’hypertension artérielle est une pathologie des sujets adultes. Cependant des auteurs en occident (Asmar et al., Safar et al., cités dans N’djessan et al.) ont retrouvé une moyenne d’âge de 63 ans, donc plus élevée que la nôtre. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que la population occidentale est vieillissante comparativement à la population africaine.
Les sujets exerçant dans le secteur privé informel (44,4%) et les retraités (22,2%) sont les plus représentés. N’djessan et al., ont relevé une importante proportion de retraités, soit 32,2%. Cette différence peut s’expliquer par le niveau de vie différent entre les retraités togolais et ceux Ivoirien. De plus le secteur informel est très développé au Togo et ceux qui y travaillent peuvent disposer de beaucoup plus de ressources financières leur permettant de se soigner à l’hôpital.
L’analyse des données de notre enquête a relevé que 61,9% des patients hypertendus sont au courant de leur HTA depuis 1 à 5 ans. Ces données se rapproche de celles de Pessinaba et al. (2015) qui ont trouvé une durée moyenne de l’HTA de 6,7 ± 6,9 ans.
La découverte de l’HTA s’est faite le plus souvent au cours d’une maladie (44,4%). Ces résultats ressemblent à ceux de Yayehd et al., qui ont relevé que L’HTA a été de découverte fortuite chez 42,4 % des hypertendus.
Les enquêtés prenant un seul produit pour leur hypertension artérielle représentent 57,14%, tandis que 33,33% en prennent deux et 9,52% en prennent trois. Ces résultats sont concordant avec ceux de Pio et al. (2013) qui ont indiqué qu’une monothérapie antihypertensive a été prescrite chez 41,04%, une bithérapie chez 52,62% et une trithérapie chez 6,34%. Aussi Konin et al. en Côte d’Ivoire ont trouvé 45% des patients chez qui une monothérapie a été prescrite, une bithérapie chez 28,5% et une trithérapie ou plus chez 26,5%.
L’analyse des résultats sur le vécu péjoratif, relève que 60,31% des enquêtés vivent un sentiment de déni de la maladie. Ces résultats se rapprochent des données de N’djessan et al., qui ont trouvé chez certains des sujets de leur étude, dès l’annonce de la maladie, un vécu marqué par l’espoir de guérir définitivement du fait de l’existence d’un traitement (33,5%) ; cet espoir peut être compris d’un point de vue psychologique comme un refus d’admettre la réalité de la maladie chronique. Lainé, étudiant le vécu subjectif de la maladie de Crohn, a rapporté qu’un tiers des patients de son étude se remémore avoir été dans une phase de déni de la maladie qu’ils expliquent par la volonté de continuer à vivre comme si la maladie n’existait pas. Une proportion importante des sujets de notre recherche (44,44%) vit un sentiment de persécution, concordant ainsi avec l’étude de Mendoun qui a relevé 75,61% de vécue d’une persécution imaginaire chez les personnes vivant avec le VIH. Dans la même logique N’djessan et al. ont trouvé que 8,8% des sujets de leur recherche perçoivent l’HTA dès sa découverte comme une maladie mystérieuse.
Des patients enquêtés vivent la maladie comme à l’origine d’une dépendance financière (33,33%). Ce vécu se rapproche des données relevées par Ndjessan et al., dans leur étude, qui ont mis en évidence un vécu marqué par des craintes d’une non-assistance familiale, des impacts de la maladie sur leurs activités professionnelles et une baisse de leur rendement qui peut aboutir à un licenciement. Kpedzroku a trouvé un vécu péjoratif, marqué par une notion de dépendance et de faiblesse.
Le vécu favorable de la maladie s’est manifesté le plus fréquemment comme un moyen d’apprécier la vie (66,66%), comme un défi à relever (38,09%) et par un vécu des bénéfices secondaires. N’djessan et al. (2019) ont trouvé qu’une forte proportion (91,2%) des sujets de son étude rapporte sa perception de l’HTA, dès sa découverte, comme une maladie naturelle. Par ailleurs Coutin, à travers une étude qualitative du vécu de la maladie chronique, a relevé des bénéfices secondaires de la maladie exprimé comme ceci par les enquêtés (28) :
Ça me manque pas forcément le travail, parce que je me dis euh, je peux profiter, ben là ça fait quoi un an et demi déjà ; je profite de mes enfants un maximum quoi, chose que je pouvais pas faire avant. On peut dire que c’est le bon côté. C’est, non c’est un mal pour un bien, pour moi en tout cas ! Ah euh, pour moi y’a que du positif !
Ces mêmes enquêtés ont trouvés que la maladie leur a permis un changement de la vision de la vie et un changement de caractère ainsi matérialisé : « Une autre manière de penser, une autre manière de vivre, de dire euh euh », « je sais que je suis devenue une autre personne » ! (Coutin 29).
L’hypertension artérielle (HTA) est une maladie cardio-vasculaire à caractère chronique et constitue un enjeu majeur de santé publique. L’objectif de cette recherche était d’évaluer le vécu de la maladie chronique chez les patients hypertendus suivis au CHU campus de Lomé.
Pour ce faire nous avons procédé par entretien semi-directif pour collecter les données sur le vécu de l’HTA.
A l’issue de l’analyse des résultats, il a été mis en évidence deux types de vécus de la maladie. Un vécu péjoratif marqué par un sentiment de déni de la maladie (60,31%), un sentiment de persécution (44,44%) et un vécu de dépendance financière (33,33 %) et Le vécu favorable de la maladie qui s’est manifesté par un vécu de la maladie comme un moyen d’apprécier la vie (66,66%), comme un défi à relever (38,09%) et par un vécu des bénéfices secondaires (23,80%).
De ces résultats, il ressort qu’une maladie chronique telle que l’HTA, de part son caractère chronique, peut provoquer des vécus divers. Ces vécus peuvent impacter favorablement ou non l’évolution de la maladie et son suivi. Il apparait donc important d’en tenir compte pour offrir au patient une prise en charge holistique prenant en compte l’aspect psychologique et incluant des programmes d’éducation thérapeutique (ETP) du patient.
Travaux cités
Asmar, Roland. « Risque cardiovasculaire et mesure ambulatoire de la pression artérielle ». Ann Cardiol Angeiol, vol. 47, n°2, 1998, p. 75-80.
Atta, Borgatia et al. « Contrôle de l’hta chez le patient reçu en consultation de cardiologie au chu sylvanus olympio de Lomé (Togo) ». JSUL, vol. 22 n°4 2020, p. 99-106.
Baragou, Soodougoua., Pio, Machihude, Afassinou, Yaovi, Atta, Borgatia, Oloude-Kapkovi, Nansirine. « Prévalence de l’HTA et des autres facteurs de risque cardiovasculaires en milieu professionnel sub-saharien (Togo) ». JSUL, vol. 14, n°2, 2015, p. 105-109
Bouramoue, Christophe, Kimbally-kaky, Gisèle, Ekoba J. « Hypertension artérielle de l’adulte au centre hospitalier de Brazzaville : à propos de 4928 cas ». Med Afr Noire, vol. 49, n°4, 2002, 191-6
Coutin, Omahira. « Vécu de l’annonce de la maladie grave par le patient à La Réunion : étude qualitative ». Médecine humaine et pathologie, ffdumas-01970281, 2018.
El Aassri, Hind, El Mghari, Ghizlane., El Ansari, Nawal. « Patients diabétiques de type 2 hypertendus : préfèrent-ils traiter le diabète ou l’hypertension artérielle »? Pan African Medical Journal, vol. 17 n° 193, 2014, https://www.panafrican-med-journal.com/content/article/17/193/full.
Grillat, Sébastien. « Prise en charge de l’hypertension artérielle et représentations de la maladie hypertensive au sein de la cohorte Stanislas : enquête réalisée auprès de 134 patients lorrains ». Science du vivant, Hal-0173329, 2003.
Grimaldi, André. « La maladie chronique ». Presses de Sciences Po « Les Tribunes de la santé», vol. 4, n°13, 2006, 45 – 51.
Keffane, Salim. « La prise en Charge Psychologiques chez les Personnes atteintes par des maladies chroniques ». Conference : Le 2 forum mondial des droits de l’homme, Psychologie et Droits de l’Homme, Marrakech 27-30 novembre 2014, 2020.
Kpedzrokou, Kokou Essinam. Vécu de la drépanocytose et inobservance thérapeutique des personnes drépanocytaires. Mémoire de DESS non publié, Université de Lomé : Togo, 2009.
Konin, C. et al. « L’observance thérapeutique et ses facteurs chez l’hypertendu noir africain ». Archives des maladies du cœur et des vaisseaux, vol. 100 n°8, 2007, 630-634.
Lainé, Agathe. Vécu subjectif de la maladie de Crohn et facteurs psychosociaux prédictifs de la rechute : vers une approche intégrative. Thèse de doctorat non publiée, Université Bourgogne Franche- Comté, Laboratoire de psychologie, 2017.
Mendouna, Séma. Vécu psychologique des personnes vivant avec le VIH/SIDA et l’influence de l’entourage sur l’évolution de ce vécu. Etude prospective à propos de 123 cas colligés du 15 décembre 2005 au 15 mai 2006 à l’association vivre dans l’espérance de Dapaong. Mémoire de maitrise de psychologie non publié, Université de Lomé, 2006.
N’djessan, Yapo Jean-Jacques et al. “Etat psychologique des patients hypertendus suivis à l’institut de cardiologie d’Abidjan ». Rev int sc Méd Abj-RISM, vol. 21, n°3, 2019, p. 219-222.
Organisation mondiale de la santé (OMS). Prévention des maladies chronique : un investissement vital. Présentation générale, Genève, OMS, 2005.
………Global status report on noncommunicable diseases 2014: attaining the nine global noncommunicable diseases targets : a shared responsibility, Geneva, OMS, 2014.
………. Prévention des maladies chroniques, un Investissement vital, rapport, Genève, 2016.
Pessinaba, Soulemane et al. « La dysfonction érectile chez l’hypertendu togolais : étude transversale chez 100 patients dans le Service de Cardiologie du CHU Campus de Lomé ». Pan African Medical Journal, vol. 21, n°47, 2015, https://www.panafrican-med-journal.com/content/article/21/47/full.
Pio, Machihude et al. « Observance thérapeutique de l’hypertension artérielle et ses facteurs dans le service de cardiologie du CHU Tokoin de Lomé ». Pan African Medical Journal, vol. 14, n°48, 2013, https://www.panafrican-med-journal.com/content/article/14/48/full.
Yayehd, Komlan et al. « Prévalence de l’hypertension artérielle et description de ses facteurs de risque à Lomé (Togo) : résultats d’un dépistage réalisé dans la population générale en mai 2011 ». Ann Card angéiol, vol.62, n°1, 2013, p. 43-50
Comment citer cet article :
MLA : Barma, Marodégueba. « Vécu de la maladie chronique chez les patients hypertendus suivis au CHU Campus de Lomé ». Uirtus 1.2 (décembre 2021): 125-137.
§ Université de Lomé / [email protected]