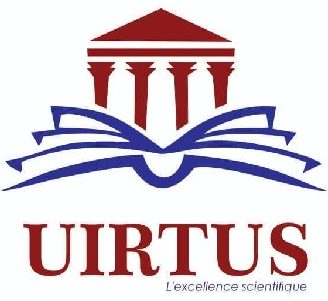Résumé (Le style mbougarien et la réinvention du moule romanesque dans La plus secrète mémoire des hommes)
Abibou Samb§
Résumé : Avec La plus secrète mémoire des hommes, Mohamed Mbougar Sarr nous a révélé, mieux que ses pairs, les merveilles de la vraie littérature au miroir du tout-monde. Au détour des consensus qui ont longtemps défini la littéralité d’une œuvre, ce jeune romancier a osé se frayer un nouvel itinéraire individuel et audacieux où seul l’expérience de lecteur, le talent et la maturité dans la fabrique rénovée du moule romanesque restent les véritables critères qui décident de la grandeur d’une œuvre et de l’écrivain. Ainsi, pour user de tous les mystères de l’écriture et amener les acteurs à repenser la définition de la littérature, il s’inspire d’une triste histoire imaginaire sur un auteur et son livre. Sur ce, il nous accroche par un style fantastique et nous invite à partager avec lui la singularité de ses structures langagières et la forme réinventée de la roue romanesque.
Mots-clés : roman, style, talent, littérature, lecteur, écrivain
Abstract: With La plus secrète mémoire des hommes, Mohamed Mbougar Sarr has revealed us, better than his pairs, the wonders of real literature to the mirror of the whole-world. At the detour of the consensus that have been for a long time defined literality of a piece of work his young novelist has dared creating a new individual itinerary where only the experience of the reader, talent, and maturity in the renovated factory of the roman mussel are the real criteria which testify to the greatness of both a piece of work and a writer. Thus, to use all the mysteries of writing and bring actors to rethink the definition of literature, he lays on an imaginary sad story about an author and his book. In fact, he hooks us up with a fantastic style and invites us share with him the singularity of his language structures and the renovated form of the roman wheel.
Keywords: Novel, Style, Talent, Literature, Reader, Writer
Introduction
Loin de nous abandonner dans une perplexité ou un mutisme béant, la lecture de La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr, nous impose à adhérer au talent de l’auteur, à l’épaisseur et à la diversité de sa culture, à l’actualité des sujets soulevés, à l’originalité et la modernité du récit. En fait, dans la posture d’un écrivain « gentleman », il a osé « marcher seul vers un destin littéraire » (Sarr 56). Jamais la parution d’un roman n’a suscité, malgré la prestigieuse distinction qui lui a été décernée (Le prix Goncourt 2021), autant de débats sur la morphologie du récit que sur les obédiences identitaires même de l’auteur. De vives réactions que l’auteur, par anticipation, profile dans le propos ci-dessous de Béatrice, un personnage issu du sérail des écrivains : « Un vrai écrivain, avait-elle ajouté, suscite des débats mortels chez les vrais lecteurs, qui sont toujours en guerre ; si vous n’êtes pas prêts à caner dans l’arène pour remporter sa dépouille comme au jeu du bouzkachi, foutez-moi le camp » (Sarr 14). À l’opposé de la critique européenne qui peine à dissimuler son délire face au niveau de réussite de l’œuvre, certains lecteurs patentés (hâtifs ou moins avisés ; je dirais) ou surtout des censeurs de mœurs et gardiens de la pudeur (ignorant peut-être les rouages de l’acte littéraire), s’ils ne s’abstiennent pas, versent dans la stigmatisation de son auteur.
À la croisée de tous ces débats, cette contribution compte explorer minutieusement, les fondements esthétiques qui sous-tendent la singularité de cette fiction. D’emblée, il faudrait préciser que s’aventurer à bâtir cette réflexion sur l’analyse de quelques aspects de ce roman où tout, jusque dans les moindres détails, est intéressant dans la grille des performances, serait, a priori, une option suffisante pour disqualifier notre aventure ou mésaventure littéraire. Certes, rien n’existe, futile et isolé dans l’armature de cet imaginaire couronnant dans le tout-monde, nous en sommes conscients. Mais, s’interroger sur certaines lignes de forces qui dépouillent la maturité prétentieuse du style mbougarien et les nouvelles orientations que l’auteur dicte à la structure matricielle du récit, pourraient être tolérés, quand on sait, in extenso, que tout dans une œuvre ne peut être analysé. Ainsi, grâce à la narratologie et aux sémiotiques francophones qui, au sens peircien (1958) du terme, se déploient sur la maïeutique des fabriques narratives et du système d’encodages et de décodages des signes, nous allons, dans un premier temps, étudier les caractéristiques qui irriguent la prééminence du style mbougarien. Dans un second temps, nous nous évertuerons, non seulement à épingler les différentes manifestations des matériaux mobilisés dans cette narration, mais surtout à nous appesantir sur le diagnostic des timbres novateurs que Mbougar a forcés au récit pour réinventer, encore une fois, les virtuosités narratives des moutures tout-monde.
1. La fabrique des structures langagières, un don du talent
La littérature est un vaste domaine qui impose ou plutôt exige de ses acteurs (écrivains, lecteurs, critiques…) un certain nombre de dispositions intellectuelles pour pouvoir la dompter. À l’instar d’une ravissante jeune femme, de premières approches facile mais difficile à conquérir, le véritable texte littéraire doit « draguer » le lecteur et créer, selon Paul Ricœur, « un espace de la jouissance. […]. La possibilité d’une dialectique du désir » (Ricœur 11-12). Dans cette fiction, la face attrayante du texte s’est d’abord illustrée par les prouesses notées sur le langage. Toutefois, pour analyser la rhétorique expérimentée dans la génétique de cette fiction, nous allons, dans le catalogue des figures de style mobilisées, nous intéresser, à titre indicatif, à la rénovation de la personnification et de la métaphore. Concernant les techniques d’écriture, nous focaliserons étude sur le bord de la perversion qui semblerait offrir à son langage littéraire plus de subtilité et d’épanouissement.
1.1. Le langage littéraire: des mots aux images
À travers le narrateur homodiégétique Diégane Latyr Faye que le lecteur soupçonne être l’incarnation de l’auteur, nous sommes impressionnés, de prime abord, par cette belle image courtisane personnifiant, dans ce propos, les rapports esthétiques qui lient les axes de production et de réception :
La littérature m’apparut sous les traits d’une femme à la beauté terrifiante. Je lui dis dans un bégaiement que je la cherchais. Elle rit avec cruauté et dit qu’elle n’appartenait à personne. Je me mis à genoux et la suppliai : Passe une nuit avec moi, une seule misérable nuit. Elle disparut sans un mot. (Sarr 46)
Outre la séduction, le lecteur et/ou l’auteur doit entreprendre avec le texte un échange passionné et endurant ; une sorte de conquête courtisane. Cette posture laborieuse et conflictuelle, ennuyeuse et ludique, délicate et formative, reste un levier incontournable dans le processus d’incubation du génie créatif de tout écrivain en devenir ou de tout bon lecteur. Le talent, en littérature, ne se donne pas, il s’arrache sous l’aune de beaucoup de lectures riches et diversifiées. Donc, si T. C. Elimane, l’écrivain idole de Diégane Latyr, est parvenu, par son « biblicide », Le Labyrinthe de l’inhumain, à faire délier toutes les langues, c’est parce qu’il a tout lu. Une révélation que vient soutenir Albert Maximin (symbole de critique littéraire) en ces termes : « On se perd dans son Labyrinthe (même s’il est inhumain) avec bonheur, malgré toutes ses inutiles virtuosités de premier de la classe qui a tout lu » (Sarr 99). Le personnage narrateur, investi de cette ambition, en est conscient et, dès ses premiers pas au lycée, Diégane Latyr, friand de littérature, s’est mis à l’œuvre :
C’était en 2008, classe de première, dans un internat militaire situé au nord du Sénégal. La littérature commençait à m’attirer et je formais le rêve adolescent de devenir poète. […]. Je commençai par conséquent à me perdre dans les anthologies poétiques, les dictionnaires de synonymes, de mots rares, de rimes. J’en commis d’affreuses, qui ponctuaient de branlants hendécasyllabes pleins de « larmes blettes », de « ciels déhiscents », de « hyalines aurores ». Je pastichais, parodiais, plagiais. (Sarr 16)
À bien des égards, un petit travail d’indexation centré sur la terminologie du texte, les noms des auteurs et titres d’ouvrages recensés, témoignerait de la culture encyclopédique de l’auteur. Aussi, les informations bibliographiques illustrent bien la brillante carrière intellectuelle et littéraire de Mohamed Mbougar Sarr[1]. Mais, vouloir s’enliser dans des considérations générales et/ou reconnaître, ad libitum, le talent de l’auteur ne saurait, en aucun cas, suffire comme arguments fiables pour décréter la dextérité de celui-ci dans la gestation et la production de fictions auréolées de prestigieux. Alors, dans le panorama des critères qui plaident pour son érudition intellectuelle et sa maturité stylistique, nous pouvons retenir la fascinante maîtrise de la rhétorique française et l’usage particulier qu’il réserve aux figures de style, en l’occurrence, la personnification et la métaphore.
Figure royale dans la fabrique du registre fantastique, la personnification confère aux animaux et aux choses abstraites et animées des attitudes humaines. En fait, elle adule le goût et aliène la passion du lecteur. L’émerveillement qu’engendre cette cire linguistique, Mbougar l’a su utiliser pour agrémenter et imprimer de l’originalité à son texte. Déjà dans l’épigraphe que Gérard Genette définit comme « un mot ou généralement une citation qu’on trouve au bord de l’œuvre et non dans l’œuvre » (Sarr 134), l’auteur nous fait découvrir les vermeilles de la personnification rénovée. Également, dans le creux de l’extrait ci-dessous qui taille l’acte littéraire dans la silhouette d’une séduisante jeune femme qui refuse de se dompter, le moule mbougarien personnifiant la littérature, nous dévoile, dans une coulée de subordonnées conjonctives construites sur le modèle (que + infinitif ou substantif + ne suffit pas), tout le périmètre des aptitudes de ce qui fait la grandeur de l’écrivain :
Mais vient toujours ce terrible moment, sur le chemin, en pleine nuit, où une voix [la voix de la littérature] résonne et vous frappe comme la foudre ; et elle vous révèle, ou vous rappelle, que la volonté ne suffit pas, que le talent ne suffit pas, que l’ambition ne suffit pas, qu’avoir une belle plume ne suffit pas, qu’avoir beaucoup lu ne suffit pas, […] ; et la voix dit encore que tout cela peut être, et est souvent une condition, un avantage, un attribut, une force, certes, mais la voix ajoute aussitôt qu’essentiellement aucune de ces qualités ne suffit jamais lorsqu’il est question de littérature, puisque écrire exige toujours autre chose, autre chose, autre chose. (Sarr 46- 47)
Encore une fois, le cliché ci-dessous qui personnifie la mort, semble être le plus inédit. À travers une longue lettre familière adressée à Diégane Latyr, par e-mail (sur les pages 379 – 392), le personnage Musimbwa dépeint la tragédie causée par la mort, déguisée en être humain et accompagnée de ses enfants, durant la deuxième guerre mondiale. Ce passage extrait de ces pages pourrait servir d’illustration :
J’entendis donc les rires gras des enfants de la mort, j’entendis le bruit de leurs ceinturons qu’ils détachaient et jetaient par terre, j’entendis leurs commentaires sur ma mère, ses fesses, ses seins, son sexe, sa bouche […]. J’entendis ensuite les râles des hommes, leurs cris sauvages, les obscénités. Mais je n’entendis pas ma mère. Le temps a passé, puis la mort a dit :
– Ça suffit. Devancez-moi. Je vais finir. (Sarr 385)
La finesse dans la façon d’imbriquer récit et discours épistolaire s’explique par la diversité et la flexibilité de ses caprices esthétiques dans l’élaboration d’un récit hybride. Pour plus d’une fois, dans la caricature de la complicité qui le lie avec Le labyrinthe de l’inhumain, le narrateur nous livre ce décor pictural et pittoresque où leurs rapports sont personnifiés : « Depuis lors, j’ai serré le livre contre moi. Il m’a entraîné par crêtes et gouffres, dans l’espace et dans le temps, entre les morts et parmi les survivants. Et maintenant nous voici ou nous revoici au pays de nos origines » (Sarr 394).
En fait, si le recours à la personnification est visible dans la grille d’appréciation de la maturité du style de l’auteur, les clichés métaphoriques, distillés à tout bout de phrase, demeurent eux aussi des procédés de taille. À vrai dire, ce qui est le plus frappant dans la technicité stylistique de Mohamed Mbougar, c’est la duplicité de sa plume. Mbougar, il faut le lui reconnaître, sait nimber le grotesque d’images captivantes. Mieux, il sait cohabiter les deux bords[2]. En plus, il dispose surtout de techniques de cadrage qui, à l’instar d’un artiste photographe ou peintre, lui permet de représenter les idées dans des tableaux décoratifs. Cette double vocation visible quasiment sur toutes les pages de son roman s’est dévoilée, à titre indicatif, dans de ce passage :
Cesse de me vouvoyer, cesse de m’appeler Madame Siga, c’est ridicule, et cesse aussi de bander, dégonfle-moi-ça, mënn na la jurr, je pourrais être ta mère, Diégane. – Kone nampal ma, alors fais-moi téter comme une mère, répliquai-je, […].Elle s’apprêta à se lever avant de s’interrompre : À moins que tu ne préfères que je te nampal ici et maintenant ?
Elle concrétisa la proposition et tira presque aussitôt, bas sur sa gorge, le col de l’ample boubou ; et alors un sein lourd, le gauche, jaillit du corsage défait. Tu veux ? dit Siga D. Voilà la chose. La grande médaille de l’aréole éclata dans sa nuance brune, île au milieu d’un océan d’abondance aux teintes plus claires. (Sarr 25)
À côté du cadrage, la représentation symbolique des choses et des idées a encore forcé l’admiration du génie de l’auteur dans sa maîtrise des techniques de l’art du langage. Pour traduire le caractère impudique et audacieux du personnage de Marème Siga D. : « une femme mûre qui n’avait jamais reculé ni devant le plaisir ni devant la douleur » (Sarr 28), le narrateur recourt à un cliché allégorique d’une acuité mordante à travers ce passage:
C’était une beauté emmêlée de douleur ; un corps impudique, éprouvé, réprouvé ; un corps sans rudesse, mais que la rudesse du monde n’effrayait pas. Il suffisait de le voir vraiment pour le connaître. Je regardais Siga D. et je savais la vérité […], c’était une araignée, l’Araignée-mère, dont l’immense ouvrage croisait des milliards de fils de soie, mais aussi d’acier et peut-être de sang. (Sarr 28)
Concernant l’attitude de Diégane Latyr comparé à un chasseur pris dans ses filets, le narrateur personnage choisit le tableau symbolique suivant : « et moi j’étais une mouche empêtrée dans cette toile, une grosse mouche fascinée et verdâtre, prise dans Siga D., dans le lacis et la densité de ses vies » (Sarr 28). Dans ce même registre, après avoir instruit le lecteur de son aventure sexuelle avec Siga, le narrateur clôt sa fresque érotique par un propos métaphorique codé où les images expliquent tout le scénario pornographique, mais cette fois-ci, dans un ton pudique : « La grosse mouche sortit ainsi de la toile » (Sarr 38).
En substance, la particularité du charme de la plume mbougarienne réside, non seulement dans l’usage rénové de ces figures de rhétorique, loin d’être ignoré par tout auteur, mais dans la duplicité, la finesse et la perspicacité dans le choix des images et leur mise en forme. In fine, nous lui concédons cette grandeur et cette originalité esthétique car tout dans ce texte est images et, de surcroît, des images impressionnantes toutes animées de vie. En fait, l’auteur a réussi à tirer son épingle du jeu. Il a, selon Debussy, de la bouche de Paul Ricœur, « cherché humblement à faire plaisir » (Sarr 33). Outre cette dextérité opérée sur l’usage inédit de la personnification et de la métaphore, la maturité de l’auteur s’est encore illustrée, dans la géométrie de cet imaginaire, par l’usage de procédés subversifs qui versent sa langue d’écriture dans une certaine allure provocatrice.
1.2. Le bord subversif et les prouesses du langage littéraire
L’auteur a utilisé et diversifié, non seulement, toutes les techniques du langage, mais il a surtout réussi à leur imposer, chacune, son timbre. Car comme le suggère Tahar Ben Jelloun :
Une langue a ceci de particulier : c’est une immense maison aux portes et aux fenêtres sans cadres, ouvertes en permanence sur l’univers ; c’est un pays sans frontières, sans police, sans État, sans prisons. La langue n’appartient à personne en particulier, elle est là, disponible, malléable, vive, magnifique et toujours truffée de mystères. (Le Bris et Rouaud 121-122)
Cette sentence métaphorique noyée dans un libéralisme licencieux insinue que le langage littéraire ne s’épanouit que sous la lame de la perversion et du piétinement des normes grammaticales. Dans cette « hétérologie par plénitude où la langue se reconstruit ailleurs par le flux pressé de tous les plaisirs du langage, où tous les signifiants sont là et chacun fait mouche » (Barthes 15), la première touche de l’auteur est beaucoup plus visible dans le maquillage du français d’emprunts et de néologismes. Dans son style, sans le dire, encore moins le réclamer, l’auteur instruit le lecteur de son appartenance à la culture sérère. Du coup, il affiche son africanité, ménage la hantise de la « conscience linguistique » (Weinrich 1991) et recycle l’idéal idéologique de « la civilisation de l’universelle » chère à Léopold Sédar Senghor. L’emploi ludique et sans gêne des expressions comme : « laya ndigil », « un bol de sàcc fu lipp » « boo feet ndax Roog », éparpillées un peu partout dans le texte, sans compter les dénominations onomastiques propres à la culture sérère : « Mboyil », « Ndé Kiraan », « Mossane », « Mbin Madag », rapprochent Mbougar de ce que Blachère (1994) appelle « la négrification » (105). Elle est une pratique langagière qui consiste à « insérer dans le français littéraire, l’utilisation d’un ensemble de procédés stylistiques présentés comme spécifiquement négro-africains visant à conférer à l’œuvre un cachet d’authenticité, à traduire l’être nègre et à contester l’hégémonie du français de France » (Manirambona 8). C’est dans cette veine qu’il faudrait, à juste titre, faire écho de ce propos de Charles Becker et de Waly Coly Faye : « Le nom propre sert à la fois à identifier [un individu, une famille] ; à classer et à signifier […]. Ainsi dans chaque culture, les noms propres constituent un système qui fournit des indications précieuses sur la façon dont les groupes sociaux agencent le réel » (Becker et Faye 15).
En dehors des idiomes empruntés à la langue sérère, Mbougar a aussi fécondé son roman d’indices langagiers wolof « mënn na la jurr », « kone nampal ma » (Sarr 15), néerlandais, « Als het erop aan komt »(29-31), lingala « Nkolo, pambola bord oyo. Yango ne mutu eko sunga mokili… » (69), pour ne citer que ceux-là.
En outre, dans cette poétique de « transmutation » (Barthes 44), la répétition acerbe de certaines expressions et le recours au jeu de mots ne cessent de prouver la promptitude de l’auteur dans la fabrique de son style. Sur les pages 190-191-193 de son roman, est répété plusieurs fois « elle raconta » ou « elle + verbe d’action) ; expression où le pronom personnel « elle » est mis tantôt pour la narratrice Marème Siga D., tantôt pour la narrataire Marème, une maniaque sexuelle, étudiante en philosophie à l’UCAD. Ce même format, nous le retrouvons sur la page 41 avec la conjonction de coordination « ou » : « Au-delà de cette échéance, il faudra que je me démerde : trouver un vrai travail, ou reprendre […], ou vivre dans la rue, ou devenir[…],ou écrire un livre de régression personnelle[…]. Ou crever » (Sarr 41). Cette technique, n’en déplaise aux linguistes puristes, permet de déconstruire la syntaxe de la phrase et de plier le propos dans une sorte de délire où rien n’est plus pris au sérieux. Sous cet angle, le lecteur découvre une certaine démence précoce de l’auteur qui s’ouvre à l’écriture surréaliste où le pensable, sous la dictée de l’automatisme, surnage le pensé. Ce faisant, sous le forçat de ces coulées de phrases apparemment désarticulées, toutes les obscénités dites par le personnage passeraient sous le registre de l’humour. Ce passage surpris dans le propos de la poétesse « […] ce qu’il avait fait et vécu et souffert et tu et caché » (194), viole la règle sur l’usage de la conjonction de coordination « et » qui, en lieu et place de sa répétition, doit être remplacée par la virgule et ne devrait apparaître qu’entre les deux derniers mots.
Sur l’étendue du « Deuxième biographème », intitulé « Trois cris en plein tremblement » (Sarr 175-185), par le personnage de Mossane, l’auteur, dans un style transgressif, à la limite grossier, écrase le point de la phrase grammaticale. Comme dans un fouillis, il s’engage à transcrire, sans censure aucune, tout ce qui lui traverse l’esprit. Ainsi, pour faire comme les surréalistes dans l’écriture automatique, Mbougar, dans cet extrait, « [et donc je réponds Je ne sais pas à la question de la terre, » (Sarr 177), supprime le point et relance le propos par une majuscule. Sur la même page et sur le même modèle, il fait précéder, cette fois-ci, la majuscule d’une virgule : « elle a commencé à trembler alors j’ai insisté, Je ne sais pas, […] » (177). Toujours, dans le registre de ses acrobaties stylistiques, nous notons un aménagement coquet configurant un jeu avec les mots qui rime avec le corps de son récit :
J’écrivis un petit roman, Anatomie du vide, que je publiai chez un éditeur plutôt confidentiel. […].Neuf cent dix-neuf avaient commenté. « Félicitations ! », « Fier ! », « Proud of you ! », « Congrats bro ! », « Bravo ! », « Ça m’inspire ! » (et moi j’expire), « Merci, frère, tu fais notre fierté », « Hâte de le lire In Sha Allah ! », « Il sort quand ? » (J’avais pourtant indiqué la date de sortie dans le post), « Comment se le procurer ? » (C’était aussi dans le post), « Il coûte combien ? » (idem), « Titre intéressant ! », « Tu es un exemple pour toute notre jeunesse ! », « Ça parle de quoi ? » (cette question incarne le Mal en littérature), « On peut le commander ? », « Dispo en PDF ? », etc. (Sarr 21)
À travers ce style télégraphique, l’auteur imprime sa jeunesse, le sens élevé de la modernité de son langage mais également son ouverture et sa promptitude dans le métissage des langues. Toutefois, pour faire effraction dans le jargon juvénile, l’auteur mélange les niveaux de langue fait copuler les code oral et écrit avec la complicité du numérique.
Tout compte fait, prendre le risque de s’aventurer à étudier l’ensemble des techniques d’écriture mises en expérimentation par la plume mbougarienne dans cet article, c’est déjà tresser des lauriers à la critique qui taxerait notre réflexion de partielle. En réalité, l’œuvre que Mohamed Mbougar Sarr a opéré sur sa langue d’écriture est inédit. Non seulement il a convoqué dans son texte tous les aspects constitutifs de la langue, mais il en a surtout fait, pour chaque élément, un usage jusque-là en friche. Rien dans le fonctionnement de la langue n’a été laissé en rade. Il faut le reconnaître, Mbougar a bien compris que « l’écriture n’a pas de langue fétiche » (Le Bris et Rouaud 197). Par conséquent, il a osé franchir l’infranchissable et a risqué de pêcher dans les eaux boueuses de la langue pour lui extorquer tout ce qu’elle n’avait pas voulu donner. Mais, un fait est certain car, si l’auteur est parvenu à réaliser de telles prouesses, c’est parce qu’il a été initié. Cette initiation, au-delà des aptitudes acquises dans les fabriques originales du langage littéraire, a aussi inspiré l’auteur à réinventer la matrice interne du roman afin de brouiller le rayonnage dans la nomenclature des genres.
2. Le roman à l’épreuve de sa réécriture : déclin ou déclic
Toute description implique un choix d’éléments, des proportions à établir, des lignes de force qui orientent. Ainsi, dans l’étude de cet imaginaire qui divorce avec les consensus esthétiques, aussi bien sur la forme que sur le fond, notre investigation compte explorer une double perspective ancrée, d’une part, sur l’analyse de l’arsenal paratextuel et, d’autre part, sur la structure génétique. En termes clairs, il s’agira, dans un premier axe de montrer en quoi l’auteur demeure innovant dans l’espace paratextuel de son texte. Dans un second axe, nous allons « disséquer » la structure textuelle pour « flairer » sa nature composite, son niveau générationnel pour enfin arbitrer sur l’épaisseur de sa littéralité.
2.1. Spatialité paratextuelle entre brouille et créativité
Selon Gérard Genette : « Le paratexte est donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs, et plus généralement au public. Plus que d’une limite ou d’une frontière, il s’agit ici d’un seuil ou […] d’un “vestibule” qui offre à tout un chacun la possibilité d’entrer ou de rebrousser chemin » (Genette 7). Il est partie intégrante du texte et offre, d’une manière ou d’une autre, des intuitions de sens au lecteur. Dans sa composition organique nous avons le titre, les intertitres, les épigraphes, le prologue, l’épilogue, mais aussi les illustrations et informations des pages de couvertures. De prime abord, nous pouvons signaler qu’un auteur, de mèche avec son éditeur, peut écrire un ouvrage et le publier sous l’anonymat ; mais jamais sans titre. D’ailleurs, pour Roland Barthes (1973), celui-ci a un pouvoir d’ « authenticité et d’identification » (53) et, dans bien des cas, il inspire des hypothèses de sens sur le projet d’écriture de l’auteur. Or, si nous nous intéressons un peu au titre de notre roman en question « La plus secrète mémoire des hommes », cette dualité est loin d’être vérifiée. Certes, le lecteur pourrait identifier le genre par la transcription, dès la première de couverture, du mot « Roman », mais sa curiosité sur le projet littéraire de Mbougar restera entière. Cette façon de faire place, dès lors, l’auteur en marginal et l’écarte de la plupart de ces thèses. À titre indicatif, avec « Black Bazar », le lecteur peut parier sur le choix d’une écriture fragmentée ; avec « Celles qui attendent », le projet thématique sur l’immigration et ses corollaires s’affichent ; « Les pieds sales » ne va pas davantage s’éloigner de la thématique de l’exil, de l’errance. Alors que pour le roman en question, n’eût été l’épigraphe dans lequel figure entièrement le titre de l’ouvrage, le lecteur n’aurait aucune idée sur les intentions littéraires de Mbougar ; intentions qui comptent, si l’on se réfère à la citation, se déployer sur le bord subversif, sur « le littérairement » indocile, source de débats.
Par « épigraphe » ou « exergue », Gérard Genette explique que c’est « un mot ou généralement une citation qu’on trouve au bord de l’œuvre et non dans l’œuvre » (Genette 134). C’est un petit fragment de discours en tête de page qui cite la pensée d’un auteur différent de celui du texte. « D’origine grecque, elle signifie “inscription” et son usage, dès le XVIIe siècle, par certains auteurs classiques, se justifie par son statut d’éclaireur de sens » (Sarr 147). Donc, l’allusion faite à Yambo Ouologuem (6) et la citation de Roberto Bolaño, extraite de Les Détectives sauvages (9), pourraient permettre au lecteur de formuler deux hypothèses sur l’œuvre aventureuse de Mbougar. Car, il faudrait rappeler qu’Ouologuem fut le premier romancier négro-africain auteur d’un imaginaire inédit « Le devoir de violence ( 1968) » qui a animé beaucoup de débats aussi bien sur la thématique tendancieuse que sur la polémique liée à « un plagiat que le Malien aurait commis en empruntant des passages à des ouvrages de Graham Greene et d’André Schwarz-Bart » (Mabanckou 129). À l’instar d’Alain Mabanckou dans Le sanglot de l’homme noir, Mbougar a recyclé cet épisode sous un format parodié sur les pages 206-226 de son roman sous le titre : « Qui était vraiment le Rimbaud nègre ? Odyssée d’un fantôme. Par B. Bollème » (Sarr 202). Concernant la citation de Roberto Bolaño, le lecteur comprendrait facilement que l’auteur compte provoquer les critiques et les dispositions lectorielles habituelles pour mettre son texte au cœur des débats. Au sujet des « intertitres » que Genette déclare être « une occasion ou une respiration du texte narratif [figurant] comme des démultiplications du titre » (Genette 281) et qui sont subdivisés en « intertitres thématiques et rhématiques » (281), Mohamed Mbougar en a fait un usage marginal et a surtout innové d’autres motifs qui échappent à la nomenclature genettienne. Déjà, dans leur emploi, l’auteur a préféré, pour susciter un débat, défier Gérard Genette en brouillant cette déclinaison. Également, ce qui va ensuite le plus émerveiller le lecteur sur cet aspect du paratexte, c’est surtout l’empreinte singulière que l’auteur y a apportée. Au détour des types précédents, la créativité mbougarienne a dilaté, voire enrichi l’épaisseur de l’escorte textuel de nouveaux modèles ni thématiques, encore moins rhématiques comme celui-ci : « Amitié-amour х littérature = ? » (Sarr 307),
politique
se ramifiant en [« J-5 » « J-4 », « J-3 », « J-2 », « J-1 », « J », « J+1 »)] sur les pages 308 – 372. À cela, nous pouvons ajouter les dates sur l’ensemble des séquences narratives qui occupent les pages 39-110. Cette pratique renvoie, non à des aspects paratextuels du roman, mais plutôt au journal. Sur ce, nous pourrions rapprocher Mohamed Mbougar d’Abdourahman Ali Waberi qui en fait plein usage dans son roman Passage des larmes.
En résumé, outre la touche cavalière imprimée à l’alchimie anatomique du roman, désormais en phase d’une mort-renaissance, le génie de l’auteur a défiguré profondément la géométrie classique de la structure romanesque dans l’optique de la rénover et de la promouvoir.
2.2. Esthétique du difforme et modernité énonciative
Le charme et la particularité de ce roman, sous l’angle physiologique, peuvent être appréciés sous plusieurs dimensions. Au sujet de l’axe thématique, le roman semble ne pas s’intéresser, comme à l’accoutumée, à un schéma classique d’une intrigue tissée sur une histoire figée. En fait, il met ici en épreuve un certain Diégane Latyr Faye, personnage narrateur se substituant dans la plupart des cas aux personnages du roman, qui va à la quête, comme dans le polar ou dans la fiction d’aventure, d’un certain T. C. Élimane introuvable, auteur du célèbre roman, Le labyrinthe de l’inhumain, source de beaucoup de débats dans le monde littéraire. Sur le parcours du personnage, l’auteur a fait essaimer beaucoup de préoccupations qui concernent la vie de l’homme et surtout le monde de la littérature. Il faut le souligner, le plus impressionnant dans la toile de ce roman, c’est la spécificité et la modernité de beaucoup de ses sujets abordés. Tantôt l’auteur se perd sur des itinéraires moins fréquentés, tantôt il brise le silence sur des sujets difficiles à traiter, tantôt il aborde des thèmes inédits. Dans cette triple déclinaison nous pouvons soutenir que, certes des auteurs tels qu’Alain Mabanckou dans Black Bazar (2009), Fatou Diome dans Les veilleurs de Sangomar (2019), Sami Tchak dans Al Capone le Malien (2011), entre autres, ont abordé dans leur fiction quelques caractéristiques de ce qui fait une œuvre littéraire, mais jamais cela n’a été aussi présent et prégnant avec Mbougar dans un roman. De la définition métaphorique de la littérature à la critique en passant par les fonctions, les mobiles de l’acte littéraire, les sources d’inspiration, la condition de l’écrivain africain en exil, les fondements de la vraie littérature, les rapports entre l’auteur et son livre, entre le livre et le lecteur, les plagiats, les procédés d’écriture et de réécriture, la littérature et la presse, la littérature, les institutions et le éditions, rien n’a été traité en parent pauvre. La plume de l’auteur a papillonné partout. À titre illustratif, et dans le pêle-mêle, nous pouvons retenir ce passage qui met en exergue les rapports étroits entre un grand livre qui ragaillardit l’auteur et qui murit le lecteur :
Un vrai écrivain, avait-elle ajouté, suscite des débats mortels chez les vrais lecteurs, qui sont toujours en guerre ; si vous n’êtes pas prêts à caner dans l’arène pour remporter sa dépouille comme au jeu du bouzkachi, foutez-moi le camp et allez mourir dans votre pissat tiède que vous prenez pour de la bière supérieure : vous êtes tout sauf un lecteur, et encore moins un écrivain. (Sarr 14)
Quant aux mobiles de l’acte littéraire centrés sur l’auteur et des fonctions de la littérature qui interpellent le lecteur, ils sont, dans un ton satirique, mis en exergue dans ce propos :
Mais pourquoi continuer, tenter d’écrire après des millénaires de livres comme Le Labyrinthe de l’inhumain, qui donnaient l’impression que plus rien n’était à ajouter ? Nous n’écrivions ni pour le romantisme de la vie d’écrivain – il s’est caricaturé –, ni pour l’argent – ce serait suicidaire –, ni pour la gloire – valeur démodée, à laquelle l’époque préfère la célébrité –, ni pour le futur – il n’avait rien demandé –, ni pour transformer le monde – ce n’est pas le monde qu’il faut transformer –, ni pour changer la vie – elle ne change jamais –, pas pour l’engagement – laissons ça aux écrivains héroïques –, non plus que nous ne célébrions l’art gratuit – qui est une illusion puisque l’art se paie toujours. (Sarr 48)
Concernant la querelle des générations, des rapports des champs littéraires, sans compter le statut et la condition de l’écrivain africain en situation d’exil face aux critiques, nous ne saurions trouver un meilleur extrait illustratif que celui-ci :
Nous avions ensuite longuement commenté les ambiguïtés parfois confortables, souvent humiliantes, de notre situation d’écrivains africains(ou d’origine africaine) dans le champ littéraire français. Un peu injustement, et parce qu’ils étaient des cibles évidentes et faciles, nous accablions alors nos aînés, les auteurs africains des générations précédentes : nous les tenions pour responsables du mal qui nous frappait. (Sarr 48)
Par ailleurs, le chapelet d’extraits de critiques qui occupent les pages 79 à 104, abordant avec différentes positions Le labyrinthe de l’inhumain, tantôt le taxant de plagiaire, tantôt de faussaire, tantôt de chef-d’œuvre avec une érudition prématurée pour un écrivain noir, ouvrent une brèche sur les polémiques focalisées sur les plagiats et les procédés d’écriture et de réécriture. La fresque pornographique décrite dans tous ses détails dans un langage impudique maquillé d’emprunts wolof « kone manpal ma », « je te manpal » (Sarr 25), pour désigner l’acte sexuel, rentre dans le cadre des sujets tabous pour une certaine catégorie de lecteurs. Ces séquences qui traitent de l’exhibitionnisme sexuel, désormais à la mode chez les romanciers de la postcolonie, nous les retrouvons sur les pages 68 – 70. En outre, recycler le propos outrancier d’Edouard Vigier d’Azenac dans l’extrait suivant :
La barbarie des Africains n’est pas qu’imaginaire : nous avons pu la voir au front, durant la Grande Guerre, chez ces braves mais terribles phalanges de nègres qui horrifièrent les Allemands mais aussi les Français. L’Afrique nous effrayait déjà un peu. Elle nous répugne proprement désormais. La colonisation doit continuer, et la christianisation de ces âmes malheureuses et damnées se poursuivre » (Sarr 86),
revêtirait un caractère tapageur, si l’on se réfère à la race de l’auteur, pour ranimer un débat sur des sujets dérangeants. Dans cette même veine, le comble serait atteint lorsque Mbougar, en dépit de sa nationalité et de son appartenance religieuse qui s’affichent avec son prénom « Mohamed », se donne l’audace, non seulement, de s’ouvrir à l’homosexualité et à ses corollaires mais, de surcroît, de l’aborder avec une plume apologétique :
L’univers des libertins. C’était un milieu de secrets, de masques, d’ombres. Les gens ne s’y intéressaient pas à votre curriculum, ni même à votre identité. Ils ne voulaient que faire de vous un allié dans l’érotisme. […] Nous ne savions pas grand-chose de la vie intime, je veux dire, érotique, d’Elimane. […]. Je ne lui connaissais pas d’amante, ni d’amant d’ailleurs. […]. Dans ces milieux, on ne se repaît que de la nouveauté, de la chair inconnue, du frisson de la découverte. Elimane, en plus de posséder tout cela, était africain. Même dans cet univers pourtant peuplé de gens éclairés et cultivés, on n’échappait pas aux stéréotypes sur les Africains et leur sexualité. Il se forgea vite une belle réputation d’amant. On le réclamait. Tout le monde voulait découvrir Elimane, le goûter, voir si le don qu’on lui prêtait était vrai. (Sarr 13-14)
Encore une fois, les allusions graveleuses employées dans les passages comme : « X. est la première écrivaine lesbienne à voir son livre publié en écriture inclusive », « Y. est bisexuel athée le jeudi et mahométan cisgenre le vendredi : son récit est magnifique et émouvant et si vrai ! », « Z. a tué sa mère en la violant, et lorsque son père vient la voir en prison, elle le branle sous la table du parloir : son livre est un coup de poing dans la gueule » (284), pour caricaturer certains critiques littéraires, risqueraient, au-delà des débats sur le talent, la maturité esthétique, de stigmatiser, voire de soupçonner l’identité de l’auteur.
Toutefois, vouloir circonscrire la singularité de cette fiction qui a reçu la plus haute distinction littéraire pour l’année 2021, sur des thèmes inédits et/ou licencieux, serait une attitude moins raisonnable. Car il faut rappeler que la quasi-totalité des thèmes majeurs et récurrents ont été également visités et revisités dans le creux de cet imaginaire. Mais ce qui reste le plus impressionnant sur son axe thématique, c’est la contribution littéraire que Mbougar a réservé au traitement de certains sujets d’une brûlante actualité comme l’euthanasie, la révolte de la jeunesse africaine, pour ne citer que ceux-là. Ainsi, pour expliquer les raisons qui sous-tendent le choix délibéré de mourir, l’auteur nous sert le récit sur la maladie du personnage de Mbar Ngom et d’Ousseynou Koumakh, le guérisseur. Sur quatre pages (279-283), l’auteur, de la bouche d’Ousseynou Madag, est parvenu à convaincre le malade à choisir la mort :
Si tu acceptes de rejoindre de ton propre gré l’autre monde, les esprits qui t’y attendent te donneront la chance de guérir. Une nouvelle vie en communauté t’attend. Les esprits savent que la vie de l’âme est beaucoup plus longue que celle du corps. C’est l’âme qu’on soigne. On a le temps d’en prendre soin de l’autre côté. Tu peux redevenir quelqu’un, prendre le temps de te retrouver. Ici, il n’y a plus rien pour toi. Rien que la souffrance. […].Tu tiens à ta vie ici malgré ton mal. Mais c’est de l’autre côté que la vie véritable commence. Viens, et tu verras. (Sarr 82)
En résumé, nous pouvons admettre que l’auteur, dans son aventure hardie sur la thématique a réussi à placer son œuvre au cœur des débats. Cette fascination dans la fabrique carnavalesque du récit s’est aussi illustrée, dans son option poétique de défiguration du moule du récit, au niveau de son schéma narratif et actanciel, des modes de représentation et de la personne de l’énonciation, entre autres.
Tout lecteur, dès son premier contact avec cette fiction est d’abord frappé par le niveau de profondeur de la « désagrégation » (Baroni 16) du récit. Les « liens de causalités » (Najjara 32) qui entretiennent sa structure narrative sont, a priori, loin d’être visibles pour un lecteur hâtif. La chronologie dans la séquencialité est diffuse et désarticulée. L’auteur veut jouer avec la patience et la finesse du lecteur dans un exercice de raccommodage. D’entrée de jeu, même si le lecteur parvient à saisir les contours de la situation initiale, il se perd facilement par la suite puisque le livre de T.C. Élimane, Le labyrinthe de l’inhumain, qui était au départ l’objet de la quête assoiffée du narrateur Diégane Latyr est retrouvé dès les premières pages du récit entre les mains de sa première conquête Siga D. Un dénouement alors dans un commencement ; ce qui serait une farce, une perversion de la grammaire du récit. Par ailleurs, suite plusieurs lectures du livre, le personnage héros est resté sur sa faim d’autant plus que Le Labyrinthe refuse de lui livrer son contenu, malgré le soutien des autres collègues écrivains : « Le Labyrinthe de l’inhumain m’a appauvri. Les grandes œuvres appauvrissent et doivent toujours appauvrir. Elles ôtent de nous le superflu. De leur lecture, on sort toujours dénué » (Sarr 39). Sous ce rapport infructueux, le narrateur semble abandonner le récit sur Le labyrinthe et s’intéresse au monde de la littérature par des clichés datés qui renvoient à un journal. Ainsi, pour déconnecter les séquences et travestir la linéarité du récit, l’auteur, par une « analepse interne » (Fontaine 44), fait explorer au lecteur les aventures érotiques entre Béatrice et Musimba et les correspondances téléphoniques avec Diégane qui est tenté, cette fois-ci, par la recherche de T.C. Élimane pour être édifié sur l’énigme du conte mythique relaté par l’auteur (la prophétie et le Roi). Dans la suite, pour instruire le lecteur sur l’identité d’Elimane, il procède par prolepse à un collage d’extraits d’articles de presse ; une façon de brouiller la théorie du récit et, par ricochet, déconstruire son moule classique. Également, pour perturber l’ordre temporel et diversifier les procédés d’écriture, il calque, entre ou dans la coulée des articles, des syntagmes narratifs. Ce même procédé est aussi visible dans le « Quatrième biographème » titré « Les lettres mortes » (Sarr 373). Introduit dans la chaîne du récit au moyen de la technique du couper-coller, le catalogue d’articles qui traite du « biblicide » dans le « Premier biographème » intitulé « Trois notes sur le livre essentiel : Extraits du journal de T.C. Elimane » (110), pourrait dérouter le lecteur.
Au demeurant, la première partie du deuxième livre : « Le testament d’Ousseynou Koumakh » qui s’étire et se tortille sur la généalogie de T.C. Elimane a permis à l’auteur de retravailler la syntaxe du récit, la personne de l’énonciation, les focalisations et, parallèlement, l’autobiographie. Pour revenir sur la quête de Diégane Latyr, le personnage de Siga D., narrataire devenue narratrice, relance la suite du récit par une description pointue, à la limite surréaliste, de l’univers familial des parents de T.C. Elimane. Du coup, le « je » énonciatif employé par le narrateur principal (Diégane Latyr), désigne Siga qui, après la présentation d’Ousseynou redevient la narratrice-narrataire. La prise de parole d’Ousseynou Koumakh, devenu le « je » narrant, traduit chez l’auteur un vœu œuvrant à brouiller le lecteur et parodier l’autobiographie ; ce qui amène à repenser, de facto, la classification des focalisations. Siga qui était censée être la narratrice, se retrouve, à l’instar de Diégane Latyr, le narrataire. Mieux, pour jouer sur les rapports d’ordre et de durée entre le temps du récit, l’auteur s’adonne, au moyen d’une analepse extérieure (Fontaine 40), par régression, à un enfilage (Chklovski 170-196) de plusieurs récits secondaires sur la famille d’Elimane. Encore une fois, pour aggraver la difformité du récit et amener la critique à reconsidérer le genre, l’auteur, sous le format interviewé, revient sur l’histoire du Labyrinthe et de son auteur. Le récit de Brigitte Bollème sur l’affaire du « Rimbaud nègre », rapporté par Siga D. demeure pour celui-ci un alibi esthétique lui permettant de faire effraction dans l’univers commercial, les droits d’auteur et la polémique sur les plagiats.
Conclusion
En définitive, si Mbougar, avec La plus secrète mémoire des hommes, a réussi à se tailler, en 2021, le meilleur prestige littéraire, c’est parce que son roman s’est imposé par son originalité dans la réinvention de la géométrie des fabriques énonciatives du tout-monde. Ce succès qui a vanté le mérite de l’auteur s’est illustré par les prouesses notées dans la transmutation spectaculaire des mots, des idées, tous, en images au moyen des figures de rhétorique accordant le privilège à la personnification et à la métaphore. Mieux, dans la construction du langage littéraire, l’auteur a dévoilé que les ressources et la plénitude de la langue se traquent dans les sinuosités du bord subversif. En réalité, la transgression du patrimoine linguistique, loin d’être un délit, ou moins un déclin programmé du langage artistique, reste un déclic dans la créativité et les procédés novateurs pour l’écriture et la réécriture des imaginaires tout-monde. Également, il faudrait encore signaler que Mbougar a restructuré la morphologie de la spatialité paratextuelle, remis en question la classification genettienne et innové d’autres motifs, jusque-là méconnus. Toutefois, pour réinventer la mouture de la narratologie et la moderniser, le génie de l’auteur a pu convaincre le lecteur et les critiques que la déformation, voire la dévalorisation du dispositif énonciatif, longtemps jaloux de sa forme classique, est couveuse de merveilles. En termes clairs, l’auteur nous a démontré et prouvé que la roue de l’énonciation, en perpétuelle réinvention, demeure une œuvre au service du talent de l’auteur. Par conséquent, nous pourrions nous interroger sur l’actualité et la pertinence de la critique conformiste si nous admettons que le modèle parachevé (s’il existe d’ailleurs) tue la littérature.
Travaux cités
Awumey, Edem.(2009). Les pieds sales. Paris : Éditions du Seuil.
Baroni, Raphael. (2004). « Le temps de l’intrigue ». Cahiers de Narratologie [En ligne], 18 | 2010, 2004 mis en ligne le 06 juillet 2010. URL : http: //journals.openedition.org/narratologie/6085, (consulté le 22/01/ 2021).
Barthes, Roland. (1984). Temps et récit II. Paris : Éditions du Seuil.
——— (1973). Le plaisir du texte. Paris : Éditions du Seuil.
Becker, Charles et Faye, Waly Coly. (1991). « La nomination en sérère ». Éthiopiques. Revue semestrielle de culture négro-africaine, La civilisation sérère d’Hier à Demain, Actes du Colloque des Journées culturelles du Sine, Fatick, 10-12 mai.
Blachère, Jean Claude. (1994). Négritures. Les écrivaines d’Afrique noire et la langue française. Paris : L’Harmattan.
Chklovski, Victor. (1965). « La construction de la nouvelle et du roman ». Théorie de la littérature. Paris : Le Seuil.
Diome, Fatou. (2010). Celles qui attendent. Paris : Flammarion.
Fontaine, David.(1993). La poétique – Introduction à la théorie générale des formes littéraires. Paris : Nathan.
Genette, Gérard. (1987). Seuils. Paris : Edition Seuil.
Le Bris, Michel et Rouaud, Jean. (2007). Pour une littérature-monde. Paris : Gallimard.
Mabanckou, Alain. (2009). Black Bazar. Paris : Éditions du Seuil.
———– (2012). Le Sanglot de l’homme noir. Paris : Librairie Arthème Fayard.
Manirambona, Fulgence.(2017). « Esthétique de la réappropriation linguistique du romancier africain francophone contemporain » : ENS-Université de Bujumbura, Burundi.
Najjara, Nabil. (2012). « Le retour critique de l’intrigue dans le Nouveau roman français : entre tension et passion ». Littératures : Université Le Mirail Toulouse II.
Ouologuem, Yambo. (1968). Le Devoir de violence. Paris : Seuil-Réédition, Le Serpent à plumes.
Propp, Vladimir. (1970). Morphologie du conte (1928). Le Seuil, « Points Essais ».
Sarr, Mohamed Mbougar. (2021). La plus secrète mémoire des hommes. Philippe Rey/Jimsaan. (Version électronique)
Tchak, Sami. (2011). Al Capone le Malien. Paris : Mercure de France.
Waberi, Abdourahman Ali. (2009). Passages des larmes. Paris : Éditions Jean-Claude Lattès.
Weinrich, Harald. (1991). Conscience linguistique et lectures littéraires. Paris : Éditions de la maison des Sciences de l’homme de Paris.
Comment citer cet article :
MLA : Samb, Abibou. « Le style mbougarien et la réinvention du moule romanesque dans La plus secrète mémoire des hommes». Uirtus 2.1. (avril 2022): 296-315.
§ Université Cheikh Anta Diop de Dakar / [email protected]
[1] Elève du lycée Prytanée Militaire de Saint-Louis du Sénégal. Meilleur élève des classes de Terminale au concours général en 2009 – Etudiant en classes préparatoires littéraires au lycée Pierre – d’Ailly de Compiègne – Etudiant à l’Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) – Master en Arts en Langages – Lauréat du prix Stéphane Hessel pour sa nouvelle La cale ( 2014) – Prix Ahmadou Kourouma et du Grand Prix du roman métis pour Terre ceinte (2015) – Prix littérature monde au Festival Etonnants voyageurs de Saint- Malo pour son deuxième roman Silence du chœur ( 2017) – Prix Goncourt pour son roman La plus secrète mémoire des hommes.
[2] Dans Le plaisir du texte, Roland Barthes définit les deux bords comme suit : « un bord sage, conforme, plagiaire (il s’agit de copier la langue dans son état canonique, tel qu’il a été fixé par l’école, le bon usage, la littérature, la culture), et un autre bord, mobile, vide (apte à prendre n’importe quels contours), qui n’est jamais que le lieu de son effet : là où s’entrevoit la mort du langage », Roland Barthes, Le plaisir du texte, Éditions du Seuil, 1973, p. 13.