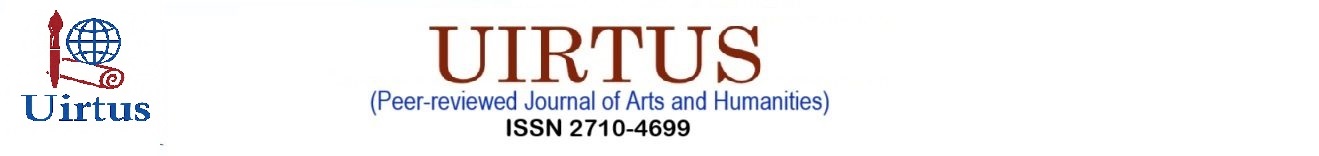Abstract :La dimension cachée de la pédagogie dans la circonscription scolaire de Ouenzé II à Brazzaville
Our study focuses on the hidden dimension of teacher education Ouenze 2 in Brazzaville. This concept is defined as “the set of unanticipated situations that occur in the teaching-learning process that the teacher faces”. The objectives of this study were to highlight the characteristics of the hidden dimension and its …