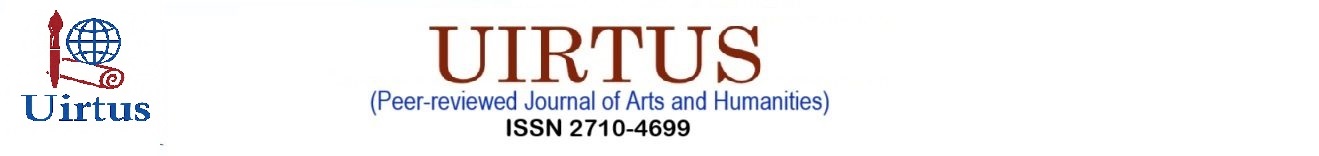Résumé : Nos propos traitent du moment de l’insertion de postulats théoriques grammaticaux de l’enseignant avant ou après la production de l’apprenant. Nous avons tenté d’y apporter des débuts de réponse. Les interrogations basiques de l’apprenant permettent d’introduire des notions grammaticales spécifiques d’apprentissage et qui sont en lien direct avec ses besoins. Aussi, est-ce pour cela que l’intervention de l’enseignant est conseillée avant la production de l’apprenant, pour situer et délimiter le contexte. Nonobstant cela, une synthèse des deux approches a été proposée, afin de ne pas créer de rupture d’enseignements/apprentissages d’une part entre les enseignants et les apprenants, et d’autre part, entre les apprenants eux-mêmes.
Mots-clés : intervention grammaticale, apprenant, production, grammaire française.
Abstract: Our remarks deal with the moment of the insertion of the teacher’s grammatical theoretical postulates before or after the learner’s production. We have tried to provide the beginnings of an answer. The learner’s basic questions allow the introduction of specific grammatical learning concepts which are directly related to their needs. Also, this is why the intervention of the teacher is recommended before the learner’s production, to locate and delimit the context. Notwithstanding this, a synthesis of the two approaches has been proposed, so as not to create a break in teaching / learning on the one hand between teachers and learners, and on the other hand, between the learners themselves.
Keywords: Grammatical Intervention, Learner-Production, French Grammar.
Introduction
Des auteurs (Beacco 2014 ; Fougerouse 2001 ; Ignacia Dorronzoro et Klett 2007) ont mis en avant la prépondérance des cours de grammaire sur les autres cours lors de l’enseignement-apprentissage de la langue française. Selon eux, ce serait lié au handicap de la réputation de langue complexe. Ce qui ne faciliterait pas les enseignements-apprentissages. Le faisant, ces auteurs sembleraient dire que la langue française est plus « complexe » que les autres langues. Cela est-il avéré ? Une telle position est difficilement défendable pour des linguistes. En effet, les langues du monde possèdent des moules morphophonologiques, morphosyntaxiques et morphosémantiques pour traduire les différentes réalités de leur environnement immédiat ou lointain. Toutes les langues possèdent ainsi des particularités paramétriques qui les distinguent les unes des autres. Cependant et avant toute spéculation, nous pouvons noter que les langues du monde sont à même d’encoder et de décoder les différentes réalités linguistiques qui se présentent à elles. Partant, il est donc loisible d’indiquer que la complexité de la langue française ne saurait expliquer une quelconque prépondérance à accorder aux cours de grammaire lors des enseignements-apprentissages liés à cette langue.
Certes le problème évoqué ci-dessus rappelle la complexité des règles de grammaire de la langue française. Mais, ce qu’il importe de voir en toile de fond, c’est le moment auquel l’enseignant propose les explicitations grammaticales aux apprenants. Comment doit-il s’y prendre ? Est-il tenu d’être en adéquation parfaite avec les instructions officielles d’une classe à l’autre, si l’on se réfère au fait que les publics d’apprenants sont disparates, y compris les rythmes d’apprentissages ? C’est à ces questions supra que nous tenterons de répondre dans l’analyse qui va suivre.
Pour ce faire, nous nous appuierons sur les travaux des chercheurs que sont Beacco (2010), Besse et Porquier (1994), Goes et Sfar (2015). Ces travaux s’inscrivent dans une démarche qui se veut synthétique, relativement au moment de l’enseignement-apprentissage de la grammaire à un apprenant donné.
Par ailleurs, au titre des observations pratiques des comportements (enseignants, apprenants), nous avons collecté des données de pratiques en classe auprès de collègues exerçant au Centre Universitaire d’Études Françaises (CUEF)[1]. Le CUEF accueille d’une part les étudiants non francophones désirant intégrer les universités ivoiriennes ou d’autres universités francophones, et, leur dispense des enseignements/apprentissages de la langue française. D’autre part, des diplomates en poste ou des touristes de passage dans le pays sont aussi les bienvenus dans ce centre. Chaque année académique, les effectifs varient entre vingt-cinq et quatre-vingts apprenants. Nos observations et analyses découlent des enseignements de grammaire aux différentes générations d’apprenants qui s’y sont succédées d’avril 2010 à octobre 2021.
À la lumière de différentes conclusions tirées des observations, il s’agira de proposer une ou plusieurs approche(s) méthodologique(s) idoine(s) pour une harmonisation meilleure des enseignements/apprentissages de la grammaire.
Aussi, dans l’étude qui va suivre, indiquerons-nous d’abord l’opportunité de faire les enseignements-apprentissages avant la production de l’apprenant dans une perspective interventionniste. Ensuite, il s’agira de voir dans quelle mesure lesdits enseignements-apprentissages peuvent être placés après la production de l’apprenant dans une perspective communicative. Enfin, nous explorerons la voie d’une synthèse des deux possibilités précédentes.
1. L’intervention grammaticale avant la production de l’apprenant
En choisissant la voie « avant la production de l’apprenant », l’enseignant se place ipso facto dans une perspective interventionniste. En effet, il va formuler des enseignements limités d’une langue aux possibilités de combinaisons illimitées, à dispenser dans un espace-classe déterminé, à un moment donné et pour un public précis d’apprenants. Ces enseignements feront l’objet de spéculations intellectuelles (re)ordonnées selon les objectifs généraux et spécifiques assignés à chaque point abordé (Cyr 5-21). Pour des enseignants (les deux tiers de la collecte de données), seules des composantes de théories seront retenues, ainsi que d’autres méthodes/approches mises en avant lors de sa propre formation et lui semblant les plus significatives, ou, des composantes de référence pour lui. En effet, cela cadre avec la pédagogie traditionnelle. L’apprenant y était considéré comme un simple réceptacle devant être rempli de connaissances extérieures lors d’un cours magistral. Les exercices et autres micro-enseignements ne servaient qu’à créer un conditionnement et à reproduire les modèles enseignés. Malheureusement, c’était et c’est une attitude révélatrice de la seule prépondérance du « critère « technique scolaire » sans aucune attention aux référents didactiques les mieux appropriés (Garabédian 1996). Ce qui est reproché au modèle pédagogique ci-dessus évoqué, c’est qu’il repose uniquement sur les assurances de l’enseignant. En revanche, il comportait l’avantage d’initier des analyses contrastives entre les langues en présence, pour une meilleure prise en charge des cas d’interférences linguistiques. Ainsi, ce modèle pédagogique offrait l’opportunité de la présentation des composantes grammaticales avant l’intervention de l’apprenant. Fort de ces acquis, l’apprenant était en mesure de réinvestir le matériel théorique linguistique dans les différentes productions et ce, que ce soit dans un environnement « sous contraintes maîtrisées » (la salle de classe), ou, « sans, avec et au-delà de contraintes maîtrisées » (hors de la salle de classe avec tous les cas de figures possibles). À toutes fins utiles, le modèle pédagogique permettait à l’apprenant de bénéficier donc d’un nombre limité de contraintes régulatrices pouvant lui permettre de faire face à un nombre illimité de variations linguistiques structurelles réelles. Ce sont autant d’acquis qui ouvrent la voie à l’apprenant en l’amenant à la construction de représentations métalinguistiques grammaticales et personnelles, voire à l’écoute attentive des consignes de l’enseignant, pour accomplir au mieux les différentes tâches pédagogiques.
Cependant, une interrogation légitime pourrait intervenir dans le sens suivant : dans quelle mesure est-il possible de dispenser des enseignements sur des contenus qui sont en train d’être mis à la disposition des apprenants, conformément à une progression et à des évaluations desdits contenus ? En fait, l’interrogation serait mal posée. Plutôt que de faire allusion aux discours essentiellement axés sur ce qui est en train d’être dispensé, peut-être qu’il y a lieu d’analyser ce qui y est de façon conventionnelle et selon des paramètres idoines. Partant, nous pouvons noter que l’intervention de l’enseignant balise les productions grammaticales futures de l’apprenant et anticipe sur d’éventuelles fossilisations desdites productions. L’objectif visé par l’enseignant, c’est l’aspect des échanges linguistiques permanents et non leur analyse – ceci est de ressort des didacticiens et autres spécialistes des langues…
Nonobstant cela, l’intervention grammaticale avant la production suppose que l’enseignant va faire seul le cours : la participation des élèves/étudiants/apprenants aux enseignements sera réduite dans la mesure où, l’enseignant est le seul à maîtriser les concepts, leurs enchaînements, leur pertinence dans telle position plutôt que dans telle autre. L’enseignant va donc faire le cours comme le seul dispensateur de connaissances ; entraînant ipso facto un désintérêt des apprenants pour ses enseignements. Il urge donc de présenter en des termes simples la définition des expressions techniques qui vont être employées, afin d’être le plus proche d’eux. Est-il possible de le faire après la production de l’apprenant ?
2. L’intervention grammaticale après la production de l’apprenant
Après la production de l’apprenant, l’intervention grammaticale présuppose que l’enseignant (le tiers sur les trois de la collecte des données) fait le cours en impliquant ses auditeurs : les liens « enseignant-apprenant » sont fortement participatifs et déterminants, dans la mesure où l’enseignant propose des enseignements basés sur des exemples de l’apprenant. En effet, c’est ce dernier qui apprend. Et, « apprendre » demande une implication et un investissement personnels sans lesquels tous les efforts semblent voués à l’échec. L’apprenant est ainsi au centre d’interactions « entre connaissance et information, entre sujet et environnement » (Altet 33). « L’apprenant est le sujet qui est en train d’apprendre en donnant des pistes d’orientations possibles sur la façon dont les apprentissages peuvent être bénéfiques pour lui ». Autrement dit, en tant qu’acteur de ses apprentissages (pouvoir passer du sens des productions à leur structure organisationnelle, trouver des jugements de grammaticalité desdites productions, opérer les transferts idoines…), l’apprenant est le mieux placé pour dire ce qui est avantageux ou non pour sa compréhension et son expression. Il reste entendu que l’enseignant aura pris le soin de baliser auparavant « les orientations possibles de l’apprenant », afin d’éviter de trop grandes digressions.
L’apprenant s’exerce à faire des constructions syntaxiques conformes aux productions linguistiques attendues de la langue de référence. Ce faisant, ce sont des possibilités qui se réalisent avec l’apprenant par le biais de l’enseignant. Les deux se retrouvent dans un moule comprenant des actions qui vont conduire à l’exécution de tâches insurmontables avant l’apport intellectuel de l’enseignant. Ainsi, les actions et autres tâches visent ou doivent viser des compétences utilitaires et/ou neutres pour une insertion réussie de l’apprenant aux activités linguistiques pouvant en découler, comme l’intériorisation ou la conceptualisation d’informations grammaticales, la mise en place de stratégies d’apprentissage, la (re)définition de son profil ou de son style d’apprentissage.
Une telle attitude de l’enseignement est de nature à permettre à l’apprenant de s’adapter à des étapes de retour sur les apprentissages, sur les mises en objet desdits apprentissages, sur les possibilités de réflexion à propos des connaissances en cours d’acquisition…
[…] La construction d’une compétence […] favorise l’émergence d’une conscience linguistique, voire de stratégies métacognitives qui permettent à l’acteur social de prendre conscience et de garder (le) contrôle de ses modes spontanés de gestion des tâches et notamment de leur dimension langagière (Coste et al. 13).
Il s’agit donc d’offrir à l’apprenant des pistes de réflexion sur ses acquis et leurs améliorations envisagées. En effet, ce sont les interactions qui favorisent les apprentissages, en autorisant la confrontation ou la conciliation des opinions, en les validant ou non et/ou en les adaptant aux représentations conceptuelles propres. L’apprenant en formation s’invente des stratégies qu’il utilise régulièrement lorsqu’elles fonctionnent correctement et qu’il contextualise en fonction de ses besoins et ce, jusqu’à ce qu’il en découvre de nouvelles. L’apprenant va donc rechercher à établir des parallèles entre ce qu’il sait le mieux et ce qu’il est censé apprendre. Dans ce cas de figure, ce sont des constructions habituelles qui vont être le premier point d’ancrage. Ensuite, il en essaiera de nouvelles jusqu’en trouver de meilleures et à les mettre également à l’épreuve de la pratique. Par son intervention après la production de l’apprenant, l’enseignant a des marques de repérage pour fixer l’attention de l’apprenant et le motiver, afin de lui faire acquérir efficacement ce qui est prévu par le programme. Car, en définitive, ce qui est recherché, c’est l’autonomie de l’apprenant face à des apprentissages nouveaux. Cependant, le risque majeur, c’est de ne pas pouvoir achever les enseignements/apprentissages tels que prévus par le chronogramme officiel. Dans ces conditions, comment opérer un choix méthodologique qui prend en charge l’intérêt de l’apprenant et les compétences essentielles pour son épanouissement linguistique ?
3. Le choix méthodologique à opérer
Opter pour un choix méthodologique revient à s’investir dans la recherche d’un cadre délimité pour l’appropriation des structures grammaticales. C’est ce cadre qui peut valablement autoriser une définition approximative réelle des différentes situations d’apprentissage, avec les connaissances et compétences projetées selon des paramètres tenant lieu de formes discursives spécifiques (séminaire, anecdote, débat libre…).
D’une part, la perspective interventionniste présentée supra pose la difficulté d’assimilation de certains présupposés théoriques. En effet, l’apprenant est face à des notions « étrangères » dont il doit d’abord saisir l’orthographe et la sémantique. Ensuite, il mettra cela en relation avec la connaissance exposée par l’enseignant. Un tel exercice demande une capacité de compréhension au-dessus de la moyenne pour un apprenant ordinaire. Or, les classes d’apprenants considérées[2] sont hétérogènes. Ce ne sont pas a priori des apprenants ayant un haut niveau d’instruction en langue française, auquel cas ils ne s’intéresseraient plus à l’apprentissage « des rudiments de la langue française ».
En plus, la perspective de la centration de l’apprentissage sur l’apprenant permet de savoir si celui-ci cerne ou non les enseignements spécifiques dispensés, et, à quel niveau de compréhension. Cette perspective offre l’avantage majeur de pouvoir faire des ajustements théoriques et pratiques à toutes les étapes des apprentissages. Cependant, elle présente aussi l’inconvénient majeur d’étendre lesdits apprentissages sur une période plus longue que prévue et ce, en raison de possibles situations d’incompréhensions et qui nécessiteraient des taux horaires beaucoup plus larges à consacrer auxdits apprentissages. Que faire alors pour une meilleure prise en charge des méthodes de transmission des connaissances grammaticales par l’enseignant et des attentes de l’apprenant vis-à-vis desdites méthodes ?
Le choix méthodologique accordera plus d’attention à la nature des savoirs grammaticaux, à la validation des acquis par l’expérience des enseignants, y compris ce que ceux-ci intègrent à leurs enseignements pour expliciter tel fait habituel de grammaire de façon improvisée aux apprenants[3]. Loin d’être lié à une pratique d’enseignant débutant, il s’agit plutôt d’une pratique en harmonie avec la créativité, la recherche personnelle d’une improvisation selon les contextes, les ressources et autres circonstances éducatives.
Ainsi, le choix méthodologique accordera plus d’attention à la nature des savoirs grammaticaux, à la validation des acquis par l’expérience des enseignants, y compris ce que ceux-ci intègrent à leurs enseignements pour expliciter tel fait habituel de grammaire de façon improvisée aux apprenants[4]. Loin d’être lié à une pratique d’enseignant débutant, il s’agit plutôt d’une pratique en harmonie avec la créativité, la recherche personnelle d’une improvisation selon les contextes, les ressources et autres circonstances éducatives.
Dès lors, les interventions de l’enseignant peuvent s’organiser autour d’un ensemble de questionnements dont les principaux sont liés à la systématisation morphosyntaxique des objets didactiques : la nature des éléments grammaticaux à enseigner, leur impact sur les apprentissages, les charges horaires attribuées auxdits éléments. Nous pouvons noter que les objets didactiques supra se rattachent d’une part aux méthodologies d’enseignement et d’autre part aux stratégies mises en œuvre pour les enseignements-apprentissages. Quelle peut donc être la nature des activités grammaticales induites ?
3.1. La nature des activités grammaticales
La nature des activités grammaticales apparaît comme la base à partir de laquelle il est possible de faire des propositions intéressantes. Ainsi, les pratiques peuvent ne pas avoir changé dans la typologie des exercices de grammaire (Besse et Porquier 1994 ; Vigner 1984). Cette constance a été notée également au niveau des exercices issus de l’approche communicative. Nous pouvons observer que ce sont des pratiques et approches adossées à la linguistique générale, en dépit de différentes évolutions dans divers domaines de la description du français (Haillet 2007). À cela, nous pouvons ajouter des études sur les capacités réflexives des apprenants mises en œuvre à travers des exercices de conceptualisation. En effet, de telles activités montrent les capacités d’auto-analyse des apprenants ; capacités d’auto-analyse susceptibles d’être étendues aux enseignants et ce, par la médiation entre des savoirs issus d’intuition et des savoirs issus de représentations des cultures éducatives et s’étendre aux enseignants (Berthoud 1982). Quelles en sont les incidences ?
3.2. Les incidences de ces activités
Au niveau de la grammaire, les incidences vont se traduire par des pratiques tendant à rendre plus explicites les différentes systématisations en liaison avec l’âge des apprenants, le niveau d’instruction supposé ou réel, la possibilité de prise en compte ou non des cas de transferts et/ou d’interférences linguistiques (Bange 21-36). Comment mettre ceci en application ? À partir de questionnements sur l’interlangue des apprenants et des représentations induites, leur interprétation des discours en usage en classe, des propositions idoines seront faites sur la base du propos grammatical habituel de l’enseignant relativement à une leçon donnée, celui des ouvrages au programmes – même s’il se résume à la « présentation simple de règles d’emploi » des grammaires du français (Beacco 89-105).
Au demeurant, c’est une anticipation sur les contenus spécifiques des activités grammaticales et leur mode d’appropriation qui est exigée. Ici, il serait indiqué de mieux concevoir les curricula et donc les référentiels de programmes, en tenant compte de la diversité des contextes d’enseignement/apprentissage et d’autres formes d’acquisition des langues dans toute leur acception. Dès lors, les référentiels qui en sont issus pourront être des résultantes de compétences linguistiques croisées tant au niveau des compétences purement linguistiques qu’au niveau de la nature des cultures éducatives à acquérir. En d’autres termes, à travers les instructions officielles de travail, l’enseignant repère l’objectif principal qui est de dispenser une notion donnée.
Partant, il se charge de vérifier les pré-requis et leurs critères de reconnaissance, de les faire accompagner d’une « visualisation pratique » qui n’est autre qu’un ensemble d’exemples appropriés fournis par les apprenants. Ce qui suppose, selon notre vécu, que l’enseignant présente son cours autour de cinq grandes phases. Ce sont la contextualisation de la situation, la présentation des pré-requis en lien avec les classes antérieures et/ou les leçons précédentes, les exemples proposés par les apprenants, la correction desdits exemples et la synthèse présentée par l’enseignant, en plus de la règle.
Conclusion
Peut-on raisonner en termes de positionnement d’intervention grammaticale avant ou après la production de l’apprenant ? Grâce aux observations et analyses de certains enseignants et chercheurs, nous avons tenté d’y apporter des débuts de réponse. Les interrogations de l’apprenant permettent d’introduire des notions grammaticales spécifiques d’apprentissage et qui sont en lien direct avec ses besoins. Le risque, c’est de voir la progression des enseignements ne pas suivre l’ordre préalablement adopté, conformément aux référentiels desdits enseignements. Aussi, est-ce pour cela que l’intervention de l’enseignant est conseillée avant la production de l’apprenant, pour situer le contexte et le délimiter. Nonobstant cela, une synthèse des deux approches est à recommander, afin de ne pas créer de rupture d’enseignements/apprentissages d’une part entre les enseignants et les apprenants, et d’autre part, entre les apprenants eux-mêmes.
Certes la grammaire a un statut qui varie au cours de la scolarité de l’apprenant : tantôt objet d’enseignement et dans ce sens, elle permet à l’apprenant de connaître les structures grammaticales de la langue de référence et leurs (ré)emplois, tantôt médiation pour transmettre fidèlement le contenu d’un domaine donné entre au moins deux interlocuteurs, et, assurer avec succès les échanges (inter)communicationnels. La grammaire apparaît ainsi comme une activité transversale qui participe de la production de l’apprenant et qui ne peut être reléguée à une position secondaire.
Travaux cités
Altet, Marguérite. « Les compétences de l’enseignant professionnel. Entre savoirs, schèmes d’action et adaptation, le savoir-analyser », In Paquay, Léopold et al. (éds.), Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? Quelles compétences ? Bruxelles, De Boeck, 267p. 1996.
Bange, Pierre. « L’usage et la règle dans l’enseignement et l’apprentissage de langue étrangère », In Cicurel, Francine, Véronique, Danièle (sous la dir.), Discours, action et appropriation des langues, Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, p. 21-36. 2002.
Beacco, Jean-Claude. « Représentations de la grammaire et enseignements des langues étrangères : quelles marges de manœuvre ? », In Babylonia 02/14, (2014) : p.16-22 : http://babylonia.ch/fileadmin/user_upload/documents/2014-2/Beacco.pdf 21.01.2021.
Beacco, Jean-Claude. « Les savoirs linguistiques ordinaires en didactique des langues : des idiotismes », In Beacco, Jean-Claude, Porquier, Rémy (sous la dir.), Grammaires d’enseignants et grammaires d’apprenants de langue étrangère, Porquier Langue française, Paris, Larousse, n°131. 2001. https://www.persee.fr/docAsPDF/lfr_0023-8368_2001_num_131_1_1038.pdf 27.09.2021.
Beacco, Jean-Claude. La didactique de la grammaire dans l’enseignement du français et des langues. Savoirs savants, savoirs experts, savoirs ordinaires, Paris : Didier, 2010. https://www.academia.edu/35985292/La_didactique_de_la_grammaire_dans_lenseignement_du_fran%C3%A7ais_et_des_langues_Savoirs_savants_savoirs_experts_et_savoirs_ordinaires 27.09.2021.
Berthoud, Anne-Claude, Gajo, Laurent. « Bricolages métalinguistiques pour construire des savoirs non linguistiques », In Beacco, Jean-Claude et al., Les cultures éducatives et linguistiques dans l’enseignement des langues, Paris, PUF, (2005) p.89-106.
Berthoud, Anne-Claude. Activité métalinguistique et acquisition d’une langue seconde, Berne, Pierre Lang, 233p. 1982.
Besse, Henri et Rémy Porquier. Grammaire et didactique des langues, Paris, Crédif-Hatier, Coll. LAL, 1994.
Coste, Daniel, Moore, Danièle, Zarate, Géneviève. Compétence plurilingue et pluriculturelle, Conseil de l’Europe, Comité de l’éducation, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, p.13. 1997.
Cyr, Paul. Les stratégies d’apprentissage, Paris, CLE International, Collection « Didactique des langues étrangères », 1996, https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4904571/mod_resource/content/1/Cyr%20strategies%20apprentissage.pdf 27.09.2021.
Fougerouse, Marie-Christine. « L’enseignement de la grammaire en classe de français langue étrangère », In Études de linguistique appliquée, 2001/2 (no 122), p. 165-178 : https://doi.org/10.3917/ela.122.0165 21.01.2021.
Garabédian, Michèle « Apprendre une langue quand on en parle déjà une », Revue internationale d’éducation de Sèvres, 1996, p. 119-130 : http://journals.openedition.org/ries/3404 27.09.2021.
Goes, Jan, Sfar, Ines (sous la dir). « La grammaire en FLE/FLS. Quels savoirs pour quels enseignements ? », In Le français dans le monde. Recherches et Applications, Paris, Clé International, n°57, 158p. (2015).
Haillet, Pierre Patrick. Pour une linguistique des représentations discursives, Bruxelles, De Boeck-Duculot, Coll. Champs linguistiques, 2007.
Ignacia Dorronzoro, Maria, Klett, Estela. « Le rôle de la grammaire dans l’enseignement de la lecture en langue étrangère », In Études de linguistique appliquée, 2007/4, (2007) : p.499-511 : https://www.cairn.info/revue-ela-2007-4-page-499.htm 27.09.2021.
Maccario, Bernard. « L’excellence scolaire entre compétence et conformisme. Analyse du livre de P. Perrenoud, La fabrication de l’excellence scolaire », In Pratiques : Linguistique, Littérature, Didactique, Collection Pédagogie différenciée, n°53/1987, p.117-120 : https://www.persee.fr/docAsPDF/prati_0338-2389_1987_num_53_1_1428.pdf 27.09.2021.
Miguel-Addisu, Véronique. « Dynamiques sociolinguistiques dans une communauté plurilingue : des lycéens éthiopiens entre conformisme et émancipation », In Lidil, Revue de Linguistique et de Didactique des Langues, n°44/2011, p. 93-110 : http://journals.openedition.org/lidil/3143 27.09.2021.
Vigner, Gérard. L’exercice dans la classe de français, Paris, Hachette, Coll. LAL, 1984.
Comment citer cet article :
MLA : Diallo, Moussa Mamadou. «L’intervention grammaticale : avant ou après la production de l’apprenant ? ». Uirtus 1.2. (décembre 2021): 248-259.
§ Université Félix Houphouet Boigny / [email protected]
[1] Nous sommes également enseignant-chercheur dans ledit centre. Les données sur les enseignants et les apprenants sont consultables au CUEF, à l’UFR Langues, Littératures et Civilisations, de l’université Félix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire).
[2] Les apprenants non francophones du CUEF sont issus de formations différentes et ont des objectifs d’acquisition diversifiés qui tiennent comptent de leurs motivations à apprendre la langue française.
[3] Nous devons entendre par « fait habituel de grammaire (de façon improvisée) », des éléments de description de la langue française inspirés d’une grammaire normative très peu soumis aux influences des recherches en linguistique générale et française depuis 1950 jusqu’aux grammaires pédagogiques des années 1980 et destinées aux apprenants.
[4] Nous devons entendre par « fait habituel de grammaire (de façon improvisée) », des éléments de description de la langue française inspirés d’une grammaire normative très peu soumis aux influences des recherches en linguistique générale et française depuis 1950 jusqu’aux grammaires pédagogiques des années 1980 et destinées aux apprenants.