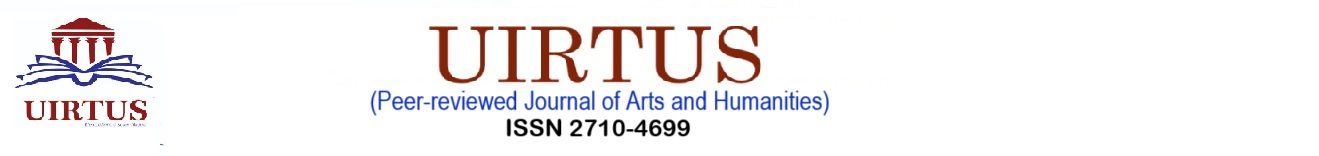Bili Douti§,
Lardja Kanati,
&
Etienne Kimessoukié Omolomo
Résumé : La gestion efficace de l’hypertension (HTA) exige une implication de la personne malade. Cette capacité à prendre soin de soi est de l’autosoin. Plusieurs facteurs influencent l’autosoin au rang desquels le soutien social. Les auteurs ne s’accordent pas sur la contribution du soutien social dans le processus d’autosoin. L’objectif de cette recherche est d’identifier les facteurs sociaux qui influencent l’autosoin des personnes vivant avec l’HTA. Une recherche corrélationnelle a été menée avec 603 personnes malades. La collecte a eu lieu dans les régions sanitaires du Togo de décembre 2019 à mars 2020. Le soutien social varie en fonction de l’âge, du genre et du niveau d’instruction. Il a une contribution factorielle relativement faible (31%) dans le processus d’autosoin. Même si la personne malade a besoin de son réseau de soutien pour surmonter ses difficultés, l’intervention des proches doit être contrôlée pour éviter un soutien envahissant et intrusif susceptible de nuire à l’autosoin.
Mots-clés : HTA, personne vivant avec l’HTA, soutien social et autosoin
Abstract: The effective management of hypertension (hypertension) requires involvement of the sick person. This ability to take care of oneself is self-care. Several factors influence self-care, one of which is social support. The authors disagree on the contribution of social support to the self-care process. The objective of this research is to determine the place of social support in identifying the social factors that influence the self-care of people living with hypertension. Correlational research was conducted with 603 sick people. The collection took place in the health regions of Togo from December 2019 to March 2020. Social support varies according to age, gender and level of education. It has a relatively small negative factor contribution (31%) in the self-care process. Even if the ill person needs their support network to overcome their difficulties, the intervention of loved ones must be controlled to avoid overwhelming and intrusive support capable of interfering with self-care
Keywords: HTA, person living with hypertension, social support and self-care
Introduction
L’hypertension est une maladie chronique multifactorielle dont la gestion exige un engagement de la personne malade. Elle est la première cause de mortalité et de morbidité dans le monde (Padwal et al., 2016). L’autosoin est la capacité d’une personne à prendre soin d’elle-même en adoptant des comportements de santé. Il est influencé par plusieurs facteurs liés à la personnalité, à la connaissance et au soutien social.
L’observance thérapeutique est un défi pour la personne vivant avec l’HTA. Dans ce processus, il est difficile pour elle de respecter scrupuleusement les prescriptions médicamenteuses le reste de sa vie (Eymard, 2007). Elle se donne du repos par moment. Elle subit également des ruptures liées au manque d’argent, d’indisponibilité du médicament, etc. Au Togo, il est démontré que la plupart des personnes vivant avec une pathologie chronique en général et du VIH en particulier ne respectent pas la prise des médicaments (Kanati). En plus, dans une évaluation consacrée à l’observance thérapeutique, un taux de 53 % de mauvais observant a été révélé au sein d’une population de personnes vivant avec l’HTA au Togo (Pio et al., 2013).
De même, bien que certaines personnes sachent que le régime alimentaire peut améliorer les chiffres tensionnels, ce comportement de santé n’est pas aisé. L’alimentation étant une habitude construite depuis l’enfance, est difficilement modifiable (Dubois). Au Togo en 2010, une étude portant sur la connaissance des employés d’une société sur l’HTA, 28 % des participants avaient une alimentation riche en graisse ; 20,3 % consommaient du sel sans modération et 6,8 % étaient tabagiques. Parmi les travailleurs dont le diagnostic d’HTA était connu, 60 % ne suivaient aucun régime, 52 % avaient abandonné leur traitement et le principal motif d’abandon du traitement était la disparition des symptômes (61,5 %) (Yayehd et al.). Face à ces défis, le Togo a mis en place plusieurs stratégies pour améliorer l’accompagnement des personnes vivant avec l’HTA. D’abord il est créé un programme de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Ensuite, une enquête d’envergure nationale faite en 2010 a permis de faire l’état des lieux de l’HTA. Il s’agit de STEP Wise dont le rapport est disponible et constitue un document de référence (Agoudavi). Enfin, le Togo a adopté l’approche WHOPEN depuis 2012. Cette approche permet de faciliter la prise en charge intégrée des maladies non transmissibles au niveau des soins de santé primaire selon le protocole de l’OMS.
Les difficultés des personnes malades dans leur autosoin passent également par les activités physiques. En réalité les activités physiques améliorent la santé des personnes vivant avec l’HTA (Sosner et al.). Par contre, beaucoup sont victimes de la sédentarité à travers leurs activités professionnelles ou dans les moyens de transport. Certains étant à la retraite tombent facilement dans la sédentarité. La combinaison d’une alimentation saine et des activités physiques conduit à une gestion efficace du poids. Une autre difficulté à laquelle sont confrontées les personnes vivant avec l’HTA est l’abandon de la consommation du tabac ou de l’alcool. La remédiation à l’addiction aux substances psychoaffectives demande assez d’effort et de ténacité. Pour finir, la personne vivant avec l’HTA peut avoir du mal à s’adapter à sa maladie. La confiance en soi et la détermination à prendre soin de soi augurent une gestion efficace de l’HTA par la personne. Toutefois, des variables intermédiaires (Biologiques, sociales, économique, etc.) peuvent perturber la stabilité émotionnelle de cette dernière.
Devant l’ampleur de l’HTA (19 %) au Togo, et de la nécessité d’autonomisation des patients, il s’avère indispensable de se pencher sur la recherche des variables manifestes et latentes en lien avec l’autosoin des personnes vivant avec l’HTA. Dans une étude menée dans une entreprise au Togo, la prévalence de l’HTA était de 54,1 % (Yayehd et al.). Aucun employé n’avait un bon niveau de connaissance et 87,4 % avaient un faible niveau de connaissance. Le peu d’information qu’ils avaient sur l’HTA provenait des autres personnes malades (39,1 %), des proches (30,9 %) et des médias (25,6 %). Aucun employé, même les personnes malades n’a pas évoqué le personnel soignant comme source d’information. Cette situation dénote l’insuffisance dans l’accompagnement des personnes vivant avec l’HTA. Si la situation est ainsi dans cette entreprise, qu’en sera-t-il alors au plan national ? Cette situation est décriée par Baragou et al. En effet, en milieu urbain, les résultats de leur étude ont démontré que les facteurs de risque comportementaux sont élevés même au sein des personnes vivant avec l’HTA.
Nous avons effectué une recherche exploratoire en 2018 dans le cadre de la délimitation du problème empirique, dont l’objectif était de décrire la perception de l’autosoin des personnes vivant avec l’HTA. Six personnes ont participé à l’entretien. Les résultats révèlent leur motivation à l’autodétermination. Certains prétendent que les soignants leur cachent beaucoup d’information sur leur maladie et les moyens de la gérer. Pourtant, le premier responsable de la gestion de l’HTA « c’est le malade lui-même » ont-ils déclaré. Puisque, « c’est le malade qui avale les comprimés, qui consomme les aliments favorables ou non à la maladie, c’est surtout le malade qui vit le mal et qui souhaite vivement une amélioration ». (Entretien avec un patient, enquête 2020). Ils découvrent que l’HTA est tellement imprévisible que le malade doit être informé et formé pour cerner ce mal qui surprend plus d’un. La motivation de ces personnes à prendre le contrôle sur la maladie se comprend mieux sous le prisme de la théorie du développement écosystémique de l’autosoin dans l’HTA. Certaines personnes atteintes d’HTA au Togo sont surprises de constater que même les paysans qui vivent des travaux champêtres ne sont pas épargnés. Si l’HTA semble être la maladie des riches et des inactifs, en quoi ces braves paysans sont-ils concernés ? Les données actuelles au Togo n’indiquent pas la prévalence de l’HTA en milieu rural. Cette difficulté est due au transfert de ces personnes en milieu urbain (hôpitaux de référence) pour une meilleure prise en soin. Alors, « si c’est comme ça [même les paysans qui sont victimes d’HTA], la maladie ne dépend plus de nous, mais de la volonté de Dieu », tels sont, les propos désespérés et fatalistes de certaines personnes. Ce cri de désespoir peut être compris comme une démission, un désarmement face à la prévention et la gestion de l’HTA. Cette situation est ressentie dans le taux d’abandon du traitement de 52 % après deux à trois ans (Yayehd et al.).
Contrairement à ces personnes, d’autres ont pris résolument l’engagement d’impliquer toute leur famille dans les mesures hygiéno-diététiques afin de réduire le risque d’HTA de leur progéniture. Pouvait-on les entendre verbaliser, « si mes parents avaient ces informations je ne serais pas ici ». En effet, en s’appuyant sur la théorie de l’autosoin des maladies chroniques de Riegel, même si les interventions sont focalisées sur la personne malade, elles n’épargnent pas sa famille (Riegel et al., 2012). C’est dans ce sens que le soutien de la famille est indispensable dans l’autosoin des personnes vivant avec l’HTA (Arda Sürücü et al.; Eslami et al.; Gao et al.; Yunus & Sharoni). En outre, d’autres personnes ont perdu l’estime de soi, en déclarant, « je constitue une charge pour mes enfants et quand je leur parle maintenant ils ne m’écoutent plus. La maladie m’a rendu bébé », ces personnes se sentent inutiles. Elles ont besoin d’entretien motivationnel et d’éducation pour s’adapter à cette nouvelle identité afin de développer des capacités pouvant les rendre autonomes. La diversité de ces résultats montre à suffisance que la motivation à l’autosoin varie d’une personne à l’autre et d’un temps à l’autre en fonction de l’environnement social. De tout ce qui précède, l’objectif de cette recherche est d’identifier les facteurs qui influencent le soutien social dans l’autosoin des personnes vivant avec l’HTA dans les régions sanitaires du Togo. L’implication des proches renforce la gestion des symptômes et améliore la qualité de vie de la personne malade (Gatherat et al.). Cette position est partagée par Strom et Egede qui soutiennent que les participants ayant un soutien élevé ont moins de dépression et ont un niveau élevé d’autosoin avec amélioration des signes cliniques. Pour les hommes, la première source de soutien c’est leur femme. Par contre pour les femmes, la première source de soutien vient d’autres personnes (Stopford et al.; Strom & Egede). Plusieurs moyens sont utilisés pour soutenir les patients (téléphone, internet et les groupes de visite médicale). L’un des défis dans les maladies chroniques est la maîtrise des symptômes et des données paracliniques où seuls 50% des patients atteignent cet objectif grâce au soutien des proches (Gao et al.). L’atteinte de cet objectif passe par l’autosoin. Il est également prouvé que le comportement de santé permet de stabiliser les données cliniques et paracliniques (Ibid). Le soutien social est le plus souvent focalisé sur l’alimentation et les activités physiques (Rintala et al.; Stopford et al.; Strom & Egede). Ce sont des activités de vie quotidienne et constituent le cœur des mesures hygiéno-diététiques. Le soutien social renforce l’autosoin des signes cliniques plus que d’autres choses (Rintala et al.). En plus, un soutien social efficace permet à la personne de surveiller et gérer le bien-être physiologique et la surveillance des symptômes (Graven & Grant). Selon ces auteurs, certaines fois, la prise de décision de consulter un professionnel de santé sur un symptôme récurrent est influencée par la famille et les proches. Le soutien social constitue un facteur de protection contre le stress lié à la maladie (Strom & Egede). En plus, il permet aux personnes malades de combattre la dépression. Le soutien social renforce l’estime de soi et l’auto efficacité (Hahn et al.). Pour améliorer le bien-être mental des personnes malades, les études ont montré qu’il faut des interventions ciblées sur le réseau de soutien (Strom & Egede). Par ailleurs, la croyance collective des partenaires sur les comportements de santé facilite l’autosoin et renforce leur motivation à contrôler les effets de la maladie (Rintala et al.). Il est prouvé que le soutien familial augmente l’adhérence à l’autosoin des maladies (Chacko & Jeemon). Les premières personnes en qui la personne malade doit avoir confiance dans cette aventure, ce sont les membres de la cellule familiale. Ils partagent le quotidien de la personne malade, ses peines et ses inquiétudes et font tout pour la soutenir dans l’atteinte de ses objectifs. Le soutien social est prédicteur d’un comportement de santé (Graven & Grant; Jo et al.; Stopford et al.; Strom & Egede). Ce soutien pousse la personne malade à une alimentation saine appuyée par des activités physiques et une adhérence thérapeutique (Strom & Egede). L’alimentation saine est au cœur des comportements de santé, son adoption est très difficile et demande un soutien des proches.
Ce soutien malgré sa contribution positive dans le processus d’autosoin, a également des limites et doit être contrôlé. Ainsi, le soutien social mal géré constitue un obstacle à l’autogestion des personnes malades. Ces perturbations sont d’ordre physique, social et psychologique (Pun et al.).
Le soutien est parfois non adapté sur le plan alimentaire et physique. Certaines personnes malades voient le soutien inadapté qu’apportent les proches pour son régime alimentaire (Oftedal). En effet, toutes les familles ne sont pas capables de fournir le régime recommandé au patient, mais trouvent des arguments pour le convaincre à prendre le plat familial. Certaines fois les informations sur le régime alimentaire ne sont pas d’actualité, mais chacun veut avoir raison sur la personne malade (Neufeld et al.). En plus, les patients ont besoin de faire des activités physiques, mais le soutien des proches reste insuffisant ou trop exagéré (Oftedal). Les proches ne maitrisent souvent pas l’accompagnement dans les exercices physiques. Soit, ils ne font rien pour aider le malade ou pousser par le zèle, ils demandent trop d’efforts à celui-ci. Le soutien social peut affecter les rapports avec la personne malade. En effet, la plupart des personnes malades chroniques ont des responsabilités sociales. Elles ont des difficultés à combiner les responsabilités professionnelles, familiales et les soins de santé (Fort et al.). Au plan professionnel, les collègues et la hiérarchie attendent de la personne malade des résultats sauf en cas de congé maladie. Certaines fois les exigences professionnelles ne sont pas compatibles avec les mesures hygiéno-diététiques. Au plan familial, la personne malade doit assumer ses responsabilités en tant que père ou mère de famille. Cette position dans la famille engendre aussi des réactions exagérées, voire une surprotection des proches (Oftedal). Certaines fois, lorsqu’un autre membre de la famille tombe malade, la personne malade chronique doit se sacrifier pour faire face à cette dernière.
Les antécédents de rapports conflictuels entre la personne malade et les membres de la famille affectent également le soutien (Fort et al.). La personne malade étant en situation de vulnérabilité, cherche toujours à protéger sa dignité en refusant l’intervention de certaines personnes avec qui, elle avait des différends. Il arrive des fois que les échanges entre la personne malade et les proches soient conflictuels ou marqués par des intrusions dans la vie privée du patient (Neufeld et al.). Ces auteurs soutiennent aussi que la personne malade est victime des conseils non adaptés et des promesses non tenues voire même des conflits de valeurs, de croyance ou culturels. Certaines fois les proches affichent des émotions de découragement ou font semblant en cachant des informations graves. Par conséquent, le soutien peut être négatif ou inefficace (Neufeld et al.). Il est négatif lorsqu’il est marqué par de l’incompréhension, un manque de confiance, des blâmes, du refus d’aider, de l’intimidation et même du manque de respect à la personne malade. Le soutien est inefficace quand l’information est inadéquate, des conseils inappropriés avec des gestes des aidants inappropriés. Le soutien social affecte également le mental de la personne malade. Les interactions entre le patient et ses proches peuvent créer des émotions non constructives (Neufeld et al.; Oftedal). Certains malades subissent les attitudes négatives et des accusations de la part des proches. En effet, certaines personnes malades devant la dégradation de leur état ou dans leur vulnérabilité, font face aux attitudes dédaigneuses voire aux accusations et discriminations des proches (Teixeira & Budd). Certains ne font que lui rappeler continuellement son état de malade, ce qui devient agaçant et frustrant (Oftedal). Cette situation engendre une perte d’estime de soi et de dépression (Teixeira & Budd). Quelle est la part du soutien social dans la prise en charge des personnes vivant avec l’HTA ? Quels sont les facteurs sociaux qui influencent l’autosoin en cas d’HTA ? Quelles sont les ressources sociales mobilisées pour vivre avec le mal ? Le soutien social en cas d’HTA n’a-t-il que des avantages ? Quelles sont les limites auxquels est confronté ce processus ?
1. Méthodologie
La collecte des données a eu lieu dans toutes les régions sanitaires du Togo de Décembre 2019 à mars 2020. Six cent trois personnes vivant avec l’HTA ont participé à l’étude dont 56,2 % de femmes et 43,8 % d’hommes. 100 personnes hospitalisées, 240 en consultation ambulatoire et 263 étaient à domicile. Les participants sont âgés de 26 à 90 ans (M = 56,32 ; ET = 13,5 ; IC95 % [52,95 ; 56,65]. Ils ont été recrutés en zones urbaines et rurales avec des niveaux d’éducation et d’occupation professionnelle divers.
Les régions Lomé Commune et Kara ont les plus grandes tailles de participants. En effet, ce sont ces régions qui abritent les plus grandes villes du Togo. La région Maritime qui a le plus faible participant pouvait tendre vers la taille des autres régions compte tenu de sa proximité avec la région Lomé Commune. Au cours d’une enquête de terrain que nous avons faite en collaboration avec les élèves de l’École Nationale des Auxiliaires Médicaux (ENAM), un questionnaire semi-structuré portant sur les caractéristiques sociodémographiques, l’appartenance à une Association de personnes malades, la personnalité du malade et soutien familial et le type de soutien social obtenu par les patients. Au cours des entretiens, un guide d’entretien a été utilisé afin de recueillir des données qualitatives.
Tableau nᵒ1 : Répartition des enquêtés par région sanitaire Effectif des participants par région sanitaire
| Régions | N | Genre | Moyenne d’âge | Écart-type |
| Savanes | 86 | M = 41 (47,7) | 57,02 | 13,44 |
| F = 45 (52,3) | ||||
| Kara | 184 | M = 77 (41,8) | 57,95 | 11,01 |
| F = 107 (58,2) | ||||
| Centrale | 72 | M = 29 (40,3) | 56,83 | 12,41 |
| F = 43 (59,7) | ||||
| Plateaux | 101 | M = 46 (45,5) | 53,46 | 12,40 |
| F = 55 (54,5) | ||||
| Maritime | 48 | M = 23 (47,9) | 55,81 | 14,36 |
| F = 25 (52,1) | ||||
| Lomé Commune | 112 | M = 48 (42,9) | 55,59 | 12,50 |
| F = 64 (57,1) | ||||
| Total | 603 | M = 264 (43,8) | 56,32 | 13,5 |
| F = 339 (56,2) |
Source : Données de terrain, 2019
Sont incluses dans l’étude, toute personne atteinte d’HTA connue, sous traitement depuis au moins six mois. La personne est capable d’assurer ses besoins de base. Elle a accepté volontiers de participer à l’étude après avoir pris connaissance de la note d’information. Les personnes vivant avec l’HTA, mais victimes d’AVC avec séquelles importantes sont exclues de l’étude. Les personnes présentant une pathologie chronique grave patente sont également mises de côté. Cette exclusion s’explique par le fait que l’autosoin est considéré comme les soins réalisés par la personne elle-même. Or, ces personnes malades grabataires sont fortement dépendantes des proches aidants.
Les participants ont été sélectionnés par une technique d’échantillonnage non probabiliste (de convenance). Ce choix est dû au fait que les participants ont réuni un certain nombre de critères et qu’aucune liste n’est disponible. Les personnes vivant avec l’HTA rencontrées lors de l’enquête dans les différents hôpitaux (CHU, Hôpitaux Régionaux et préfectoraux) et districts sanitaires de l’ensemble du pays ont été invitées à participer à l’étude.
La taille étant représentative pour la validation de l’Évaluation de l’Autosoin dans le cadre de l’HTA (EVA-H) à travers l’approche de Corbière et Larivière, elle l’est également pour la suite des analyses. En effet, l’analyse la plus complexe et qui exige la plus grande taille est la modélisation par équations structurales avec son approche LISREL. Selon Mourre, une taille d’au moins 200 est suffisante pour la validité de ces résultats. La taille actuelle de 603 couvre largement ces exigences.
L’analyse des données est faite avec le logiciel SPSS version 21. Certaines données sont exportées dans Excel pour confectionner les graphiques. Plusieurs tests statistiques sont utilisés. Pour Fiabilité de l’échelle, le test de cohérence interne (α Cronbach) est utilisé pour évaluer la fidélité des échelles. Pour déterminer les facteurs sociaux associés à l’autosoin, une corrélation bivarée a été menée. Pour l’analyse de nos résultats, nous nous inspirons de la perspective ouverte par Renée Fox, le terme « ressources » est employé dans une acception large pour rendre compte de l’ensemble des moyens mobilisés et mis en œuvre par les personnes pour vivre avec l’HTA. Elles sont d’ordre social et individuel, physique et psychique, et mêlent tout à la fois les aspects matériels, cognitifs, émotionnels et relationnels. Dans cet article, nous nous intéresserons à l’ordre social.
- Résultats
- Caractéristiques sociodémographiques
2.1.1. Répartition des enquêtés en fonction de l’âge
La Figure 1 présente la variabilité de l’autosoin en fonction de l’âge. Le test de Levene montre une homogénéité des variances [F(2, 600) = 0,17; p = 0,84]. Ceux-ci révèlent une différence significative entre les classes d’âge [F (2, 600) = 3,32; p = 0,037; d = 0,002]. La Figure 16 montre ainsi une relation linéaire entre les scores moyens d’autosoin des classes d’âges pour l’échelle totale. Les comparaisons a posteriori attestent que les personnes de moins de 40 ans prennent plus soin d’eux-mêmes (54,91) que les personnes de 40 à 59 ans (54,1) et celle de 60 ans et plus (53,48). Les personnes de 40 à 59 prennent également plus soin d’eux-mêmes que les 60 ans et plus. Ces résultats montrent que l’autosoin diminue avec l’âge.
Figure 1 : Répartition des enquêtés en fonction de l’âge
Source : Données de terrain, 2019
2.1.2. Répartition des enquêtés en fonction du niveau d’instruction
La Figure 2 présente la variabilité de l’autosoin en fonction du niveau d’instruction. Le test de Levene est significatif [F (3, 598) = 3,52 ; p = 0,015]. L’ANOVA montre une différence entre au moins deux moyennes des sous-groupes de niveaux d’instruction [F(3, 598) = 5,41; p = 0,001; d = 0,033]. Les comparaisons de moyennes à posteriori attestent que les personnes de niveau secondaire prennent plus soin d’eux-mêmes (55,17) que les personnes non scolarisées (51,75; p = 0,001). Par contre, il n’y a pas de différence significative entre les personnes de niveau secondaire et primaire (53,55; p = 0,200), ni universitaire (56,01; p = 1,00). En plus, il n’y a pas de différence significative entre les personnes non scolarisées et celle du niveau primaire (p = 1,00), ni celle du niveau universitaire (p = 0,197). Ces résultats montrent que l’autosoin augmente avec le niveau d’instruction.
Figure 2 : Répartition des enquêtés en fonction du niveau d’instruction Variabilité de l’autosoin en fonction du niveau d’instruction
Source : Données de terrain, 2019
2.1.2. Répartition des enquêtés en fonction de la taille de la famille
Le Tableau 2 montre que les personnes de 44 à 64 ans sont majoritaires (58%) et c’est la même tranche d’âge qui a plus d’enfants à charge. Les participants ont entre 0 et 15 enfants (M = 4; ET = 2 ; IC95 % [2; 3]) et ont à charge entre 0 et 10 enfants (M = 2; ET = 2 ; IC95 % [2; 3]). Que ce soit nombre d’enfants ou enfants à charge, c’est entre 44 à 64 que les participants atteignent le maximum. En plus, les personnes âgées (65 à 90 ans) font 26% des participants et dépassent la proportion des jeunes (23 à 43 ans) qui sont de 14%. Pendant que certains n’ont pas d’enfant, d’autres en ont jusqu’à 15.
Tableau nᵒ2 : Répartition des enquêtés en fonction de la taille de la famille Nombre d’enfants et nombre de personnes à charge en fonction de l’âge
| Critères | Classe d’âge | N | % | M (ET) | Min | Max |
| Nombre d’enfants | 23 à 43 ans | 90 | 14 | 4 (2,00) | 0 | 7 |
| 44 à 64 ans | 351 | 58 | 4 (2,00) | 0 | 15 | |
| 65 à 90 ans | 162 | 26 | 4 (2,00) | 0 | 15 | |
| Total | 603 | 100 | 4 (2,00) | 0 | 15 | |
| Nombre de personnes à charge | 23 à 43 ans | 90 | 14 | 2 (2,00) | 0 | 10 |
| 44 à 64 ans | 351 | 58 | 2 (2,00) | 0 | 10 | |
| 65 à 90 ans | 162 | 26 | 2 (2,00) | 0 | 10 | |
| Total | 603 | 100 | 3 (2,00) | 0 | 10 |
Source : Données de terrain, 2019
Du Tableau 3, il ressort que la majorité des participants (75%) sont mariés dont 25% de polygames.
Tableau nᵒ3 : Répartition des enquêtés en fonction de la situation matrimoniale et type de famille
| Situation matrimoniale | Type de famille | Total | ||
| Monogamique | Polygamique | |||
| Célibataire | 27 (4 %) | 27 (4 %) | ||
| Marié | 305 (50 %) | 156 (25 %) | 461 (75 %) | |
| Veuve/Divorcé | 114 (18 %) | 114 (18 %) | ||
| Total | 602 (97 %) | |||
Source : Données de terrain, 2019
2.2.1. Croisement entre niveau d’instruction et être membre d’une association et participation à l’ETP
Les participants sont majoritairement instruits jusqu’au niveau secondaire (36,21%). Le Tableau 16 montre que presque tous les participants (98,5%) ne sont pas membres d’une association et la majorité (63,62%) n’ont jamais participé à une sensibilisation sur l’HTA. Le peu de participants membres d’une association des malades sont plus du niveau secondaire et ceux qui ont participé aux séances de sensibilisation sur l’HTA sont également du niveau secondaire. Parmi ceux qui ont participé aux séances de sensibilisation, les non scolarisés viennent en deuxième position soit 25%.
Tableau nᵒ4 : Croisement entre niveau d’instruction et être membre d’une association et participation à l’ETP
Source : Données de terrain, 2019
2.2.2. Répartition des enquêtés selon la personnalité du malade et soutien familial
Les statistiques de fiabilité de la sous-échelle Ouverture (α = 0,85), ainsi que celles de l’échelle totale (α = 0,75) sont bonnes. Par contre, celles des sous-échelles Extraversion (α = 0,2), Agréabilité (α = 0,26), Stabilité émotionnelle (α = 0,36) et Conscienciosité (α = 0,64) sont faibles.
Tableau nᵒ5 : Personnalité du malade et soutien familial
Source : Données de terrain, 2019
D’après le Tableau 6, les statistiques de fiabilité de l’échelle totale (α = 0,90) est bonne de même que celles des dimensions Attachement (α = 0,79), Matériel (α = 0,90), Conseil (α = 0,88), Intégration sociale (α = 0,79). Par contre, celles de la dimension Assurance (α = 0,58) est faible.
Tableau nᵒ6 : Répartition des enquêtés en fonction du type de soutien
Source : Données de terrain, 2019
2.2.3. Données relatives à la dimension socio-affective
100% (n=603) de personnes interviewées ont partagé avec les proches parents leur état d’hypertension. Tous les enquêtés ont noté de la compassion de la part de leurs proches et ont été encouragés par leurs proches. Après la mise sous traitement, les 603 personnes interrogées déclarent être soutenues moralement et disent avoir été accompagnées au moins une fois par leurs parents dans une structure de prise en charge. Pour 100% des personnes interrogées, les parents considèrent l’HTA comme un mal chronique et silencieux. 92% (n=555) des patients reçoivent de la part des parents un soutien financier et matériel lors que ceux en ont les moyens tandis que 95% (n=573) des enquêtés se voient rappeler les heures de prise des médicaments et se voient suivre le régime alimentaire. Tous les patients ont partagé leur secret de leur maladie avec les amis. Ils disent obtenir des soutiens moral et même financier de la part des amis en cas de crise et surtout d’hospitalisation.
- Discussion
Les résultats du terrain montrent que lorsque la personne avance en âge, son niveau d’autosoin diminue. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Avec un âge plus avancé, les facultés physiques et mentales commencent par lâcher la personne malade et son implication dans l’autosoin prend un coup. Dans les pays en développement, et dans les villes d’Afrique, la plupart des personnes de plus de 60 ans sont admises à la retraite et vivent souvent des moments difficiles de leur existence. Elles vivent des fois des situations familiales complexes. Si elles n’ont pas perdu leur conjoint (e), ce sont les enfants qui habitent loin pour des raisons d’emploi ou d’étude. Elles perdent ainsi la motivation à s’engager dans l’autosoin. Par contre, le jeune de moins de 40 ans qui se retrouve dans une situation de maladie chronique met tout son potentiel pour maintenir sa vigueur. Ils sont compliants dans l’espoir de mettre fin à la maladie. Ils ont souvent assez de motivation pour gérer leur poids, mener des activités physiques et à surmonter les adversités (Lafontaine & Ellefsen ; Riegel et al.). Toutefois, certains jeunes ont du mal à respecter le régime et d’éviter les excitants.
- Limites du processus d’autosoin
L’autosoin est influencé par l’environnement social. Plusieurs auteurs ont reconnu la place du soutien social dans le processus d’autosoin. Lafontaine et Ellefsen ont mis en évidence que le soutien social contribue à la motivation et est au cœur de l’autosoin. De même, Asri et Afifah reconnaissent que le soutien familial et des proches sont importants pour augmenter la capacité d’autosoin des personnes malades. Dans ce sens, Graven et Grant ont reconnu que le soutien familial favorisait un comportement d’autosoin positif et de gestion efficace des symptômes. Certes, le soutien social n’affecte pas directement les signes cliniques, mais indirectement en améliorant le comportement d’autosoin (Gao et al.). Selon Pun et al., le soutien concerne à la fois la famille, le groupe des amis et les soignants afin de renforcer l’engagement de la personne malade dans le processus d’autosoin. Il n’existe réglementairement pas d’association de patients vivant avec l’HTA connu au Togo. Ce soutien collectif fait défaut dans l’accompagnement des personnes malades. Les soignants étant des agents d’autosoin (Orem & Vardiman) développent à leur tour toutes les stratégies proposées par Audulv et al. pour assister la personne malade à hisser son comportement d’autosoin. Ces stratégies se focalisent autour de quatre points : la recherche de stratégies d’autogestion efficaces, l’examen des coûts et des avantages, la création de routines et de plans d’action, et la négociation d’un autosoin adapté à la vie. Dans le cadre de cette étude, le soutien social est négativement corrélé à l’autosoin. Ainsi, même si le soutien social est important, la personne malade n’a pas besoin d’un soutien envahissant. Un soutien excessif nuit gravement à l’autonomie de la personne et de ces décisions dans le cadre de son autosoin. De même, la personne malade qui a un score d’autosoin élevé n’a besoin que d’un faible soutien de la part de ses proches.
2.2. Inconvénients du soutien social
Par ailleurs, certaines personnes malades perçoivent le soutien des proches non bénéfique (Oftedal). En effet, il n’est pas facile d’adapter le régime alimentaire aux plats familiaux. Il faut avoir suffisamment de moyens pour faire le plat personnel de la personne malade. Aussi, certaines personnes succombent au désir et aux harcèlements des proches à prendre des aliments qui leur sont proscrits. Leur processus de changement de comportement se voit hypothéquer à répétition. Ainsi, selon Oftedal, le réseau familial ou amical est parfois non-aidant et peut remettre en cause l’effort de la personne malade dans le processus d’autosoin. D’autre part, la famille est hypersensible à la moindre inquiétude soulevée par la personne malade. Cette tendance à la surprotection met mal à l’aise la personne malade qui finit par se recroqueviller sur elle-même pour éviter le stress émotionnel.
En plus, le rôle et l’implication de la personne malade dans la famille ont été identifiés par Fort et al. comme des situations rendant plus complexe la gestion de la maladie. En raison des responsabilités et des rôles qu’occupe la personne malade, son engagement dans l’autosoin sera perturbé. Dans le cadre de cette étude, le soutien social a un effet négatif sur le processus d’autosoin. Ces résultats semblent donner raison à ceux qui pensent que l’autosoin nuit plus qu’il n’apporte de bénéfice à la personne dans son processus d’autosoin. Pourtant, la théorie soutenant l’échelle de soutien social utilisée dans cette étude postule que son score élevé est fortement corrélé aux indicateurs de santé (Caron). Le postulat de cette théorie se comprend, car, lorsque la famille s’investit dans le soin de la personne malade, ses indicateurs de santé devraient s’améliorer. Dans ce cas, ce n’est pas la personne qui fait le soin, mais c’est la famille. Or, la théorie niveau pratique du développement d’autosoin ne considère que le soin fasse par la personne elle-même. D’où la difficulté d’établir une corrélation positive entre le soutien social et l’autosoin de la personne malade.
Conclusion
La personne malade a besoin du soutien des proches pour s’engager efficacement dans l’autosoin. Les avis sont partagés sur l’intervention des proches dans la mobilisation des ressources pour faire face à l’adversité liée à l’HTA. L’autosoin étant une forme d’autonomie et d’autodétermination, l’intrusion des proches doit se faire sur mesure pour éviter d’être envahissant. Dans le cadre de cette recherche, le soutien a une contribution factorielle négative. Ce résultat donne raison aux auteurs qui incriminent le soutien social dans la difficulté de conduire à terme le processus d’autosoin. Nous avons pu découvrir que l’autogestion de l’HTA est complexe et demande aux personnes malades au quotidien un soutien social. De plus, nous avons pu constater, que l’autogestion est influencée par le soutien social.
En définitive, la prise en charge globale a eu une incidence positive et significative sur les conditions de vie des personnes infectées et par conséquent sur la qualité de leur vie. Les patients estiment que l’implication des parents et amis dans la gestion de leur mal a considérablement amélioré leurs conditions de vie. Cette amélioration n’a été possible que grâce à la mobilisation des ressources qui sont d’ordre socio-affectif. Étonnamment, au début de nos recherches, nous avons une vision très positive du soutien social et à l’avancement de notre travail, nous avons pu nous apercevoir que le soutien social pouvait aussi avoir des influences négatives.
Travaux cités
Ahra, Jo, Eun Ji SeO, and Young-Jung Son. The roles of health literacy and social support in improving adherence to self‐care behaviours among older adults with heart failure. Nursing open, 7.6 (2020): 2039‑2046. Https://doi.org/10.1002/nop2.599
Åsa, Audulv, Kenneth, Asplund and King Gustaf Norbergh. “The Integration of Chronic Illness Self-Management.” Qualitative Health Research, 22.3 (2012): 332‑345. Https://doi.org/10.1177/1049732311430497
Asri, Dahlia Novarianing and Dian Ratnaningtyas Affiah. “Social support to improve the self-care ability of people with mental disabilities : A qualitative study in the “Kampung Tunagrahita””. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 8.1 (2020): 48. https://doi.org/10.29210/139000
Bouchard, Collard Isabelle. Le rôle du soutien social dans la capacité d’autonomisation des femmes âgées de 55 ans et plus atteintes de multimorbidité [Masters, Université du Québec à Chicoutimi], 2011. Https://constellation.uqac.ca/2402/
Caron, Julie. Une validation de la forme abrégée de l’Échelle de provisions sociales : L’ÉPS-10 items. Santé mentale au Quebec, 38.1 (2013): 297‑318.
Chacko, Susanna, Jeemon. “Role of family support and self-care practices in blood pressure control in individuals with hypertension : Results from a cross-sectional study in Kollam District, Kerala.” Wellcome open research, 5, 180, 2020. Https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.16146.1
Egede, Leonard, Deyi Zheng, Kit Simpson, Strom. ” The Impact of Social Support on Outcomes in Adult Patients with Type 2 Diabetes : A Systematic Review”. Current Diabetes Reports, 12.6 (2012): 769‑781. Https://doi.org/10.1007/s11892-012-0317-0
Fort, P Meredith et al., Barriers and facilitating factors for disease self-management : A qualitative analysis of perceptions of patients receiving care for type 2 diabetes and/or hypertension in San José, Costa Rica and Tuxtla Gutiérrez, Mexico. BMC Family Practice, 14.1 (2013): 131. Https://doi.org/10.1186/1471-2296-14-131
Gao, Junling, et al. “Effects of self-care, self-efficacy, social support on glycemic control in adults with type 2 diabetes”. BMC Family Practice, 14 (2013): 66. Https://doi.org/10.1186/1471-2296-14-66
Gatherat, Camille, Jennifer Mathis et Joanne Studer. “Chez les adolescents l’autogestion de la maladie sur la qualité de vie?” [phd Thesis]. Haute École Arc atteints d’asthme allergique, quel est l’impact de l’éducation thérapeutique liée à Santé, 2019.
Graven, Lucinda et Joan Grant. “Social support and self-care behaviors in individuals with heart failure: An integrative review.” International Journal of Nursing Studies, 51.2 (2014) 320.
Hahn, Elizabeth A., et al. “Impact of Health Literacy and Social Support on Self-Efficacy Regarding Self-Care among Patients with a Left Ventricular Assist Device (LVAD) : Findings from the Mechanical Circulatory Support: Measures of Adjustment and Quality of Life (MCS A-QOL) Study.” The Journal of heart and lung transplantation, 39.4 (2020): S435‑S436. Https://doi.org/10.1016/j.healun.2020.01.236
Lafontaine, Sarah and Édith Ellefsen. “Difficultés liées à l’autosoin chez les personnes vivant avec le diabète de type 2 : Une revue de la littérature narrative basée sur le modèle d’Audulv”, Asplund et Norbergh. Recherche en soins infirmiers, N° 128.1 (2017): 29. Https://doi.org/10.3917/rsi.128.0029
Neufeld, Anne, et al. “Non-supportive interactions in the experience of women family caregivers : Non-supportive interactions while caregiving. Health & Social Care in the Community”, 15.6 (2007): 530‑541. Https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2007.00716.x
Oftedal, Bente. “Perceived support from family and friends among adults with type 2 diabetes”. European Diabetes Nursing, 11(2), 43‑48. Https://doi.org/10.1002/edn.247
Orem, Dorotha and Evelyn Vardiman. “Orem’s Nursing Theory and Positive Mental Health : Practical Considerations”. Nursing Science Quarterly, 8.4 (1995): 165‑173. Https://doi.org/10.1177/089431849500800401/j.1365-2702.2008.01000.x
Riegel, Barbara, Tiny Jaarsma and Anna Strömberg. “A Middle-Range Theory of Self-Care of Chronic Illness”. Advances in Nursing Science, 35.3 (2012): 194‑204. Https://doi.org/10.1097/ANS.0b013e318261b1ba Nursing, 19(1), 3‑28. Https://doi.org
Stopford, Rosanna and Khalida Ismail Winkley. “Social support and glycemic control in type 2 diabetes : A systematic review of observational studies”. Patient Education and Counseling, 93.3 (2013): 549‑558. Https://doi.org/10.1016/j.pec.2013.08.016
Teixeira, Elizabeth and Geraldine Budd. “Obesity stigma : A newly recognized barrier to comprehensive and effective type 2 diabetes management: Obesity Stigma. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners,” 22.10 (2010): 527‑533. Https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2010.00551.x
Comment citer cet article :
MLA : Douti, Bili, Lardja Kanati et Etienne Kimessoukié Omolomo. ” Place du soutien social dans l’autosoin des personnes vivant avec l’hypertension arterielle.” Uirtus 1.1 (août 2021): 305-324.
§ UCAC/ESS, Cameroun, [email protected]