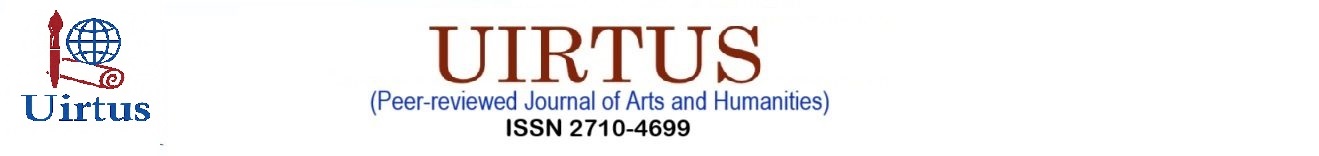Résumé : L’homogénéité linguistique constitue un phénomène assez rare qu’on peut observer entre les locuteurs d’une seule et même langue. La pratique sociétale d’une langue comme le kabiyè laisse place à une hétérogénéité linguistique caractérisée par une variation lexicale assez dynamique entre certaines catégories de locuteurs. Ainsi, quels sont les facteurs qui sous-tendent une telle variation lexicale ? Pris dans le grand ensemble des phénomènes de contact de langue mais décrit sous l’angle lexicologique, cet article a pour substrat la diversité des procédés néologiques et stylistiques dans toutes les catégories observées. Il considère la variation diastratique comme un des aspects de la variation lexicale et le soubassement même de la dynamique linguistique. Plusieurs variables à la fois internes et externes aux langues et aux locuteurs interviennent dans cette variation. Les données qui sous-tendent la présente réflexion ont été collectées dans la préfecture de la Kozah auprès des différentes catégories socioprofessionnelles de la population.
Mots-clés : variation diastratique, création lexicale, kabiyè.
Abstract: Linguistic homogeneity is a rare phenomenon that can be observed among speakers of a single language. The societal practice of a language such as Kabiye leaves room for linguistic heterogeneity characterised by a rather dynamic lexical variation between certain categories of speakers. So, what are the factors underlying such lexical variation? Taken as a whole of language contact phenomena but described from a lexicological perspective, this article takes as its substrate the diversity of neological and stylistic processes in all the categories observed. It considers diastratic variation as one aspect of lexical variation and the very basis of linguistic dynamics. Several variables both internal and external to languages and speakers are involved in this variation. The data underlying the present study were collected in the prefecture of Kozah from the different socio-professional categories of the population.
Keywords: Diastratic Variation, Lexical Creation, Kabiyè.
Introduction
Dans les pratiques langagières, il est aisé de constater une variation des lexies à l’intérieur d’une même langue, tant sur le plan diachronique que synchronique. Comme le souligne Jean Dubois (504), la variation linguistique est le « phénomène par lequel, dans la pratique courante, une langue déterminée n’est jamais à une époque, dans un lieu et dans un groupe social donnés, identique à ce qu’elle est à une autre époque, dans un autre lieu, dans un autre groupe social ». Elle reflète le cosmopolitisme langagier d’une société et la manifestation concrète de la nature éminemment sociale de la langue. Il est généralement distingué cinq types de variations – en lexicologie et en sociolinguistique – liées au temps, au lieu, à la dimension sociale et à la situation : la variation diachronique, la variation diatopique, la variation diaphasique, la variation diamésique et la variation diastratique. C’est justement ce dernier type qui nous intéresse dans une suite d’études que nous comptons réaliser afin de rendre compte du dynamisme et de la vitalité linguistiques dont jouit la langue kabiyè, langue gur, de la branche orientale des langues gurunsi, parlée au Togo et au Bénin. La langue kabiyè, faut-il le rappeler, est parlée par une population de 1 423 964 locuteurs soit 22,9% de la population résidente, en considérant les chiffres du dernier Recensement général de la population et de l’habitat de 2010 et publié en 2015. Plusieurs travaux ont été réalisés sur le kabiyè mais aucun de ces travaux n’a jusqu’ici touché les différents phénomènes de variation linguistique en général et encore moins la variation diastratique en particulier. L’objectif de la présente étude est de relever et de décrire les différentes variations langagières selon les classes sociales des enfants, des jeunes, et des personnes âgées. Les questions principales auxquelles s’attèlera à répondre cette étude sont les suivantes : Comment se manifeste la variation diastratique en kabyè ? Quelles sont les structures de la variation diastratique en kabyè ? Nous postulons que la variation diastratique se manifeste par divers facteurs à savoir : l’âge, le sexe, la classe sociale. Elle s’observe ensuite à travers diverses couches à savoir : couche enfantine, couche des jeunes et couche des personnes âgées. Cette étude se situe dans une perspective à la fois lexicologique et sociolinguistique et abordera trois points principaux. Le premier présentera le cadre théorique et la méthodologie utilisés dans le cadre de ce travail. Il s’agira, dans le second point, d’examiner les facteurs de la variation diastratique en tant que partie intégrante de la variation sociale et démographique. Enfin, le troisième point analysera les structures des diverses lexies utilisées selon les différentes classes d’âge afin de ressortir les bases de différenciation.
1. Cadres théorique et méthodologique
Nous déclinons dans les lignes qui suivent les orientations théoriques de cette étude et la méthodologie qui nous a permis de réunir les données soumises à l’analyse.
1.1. Cadre théorique
La variation linguistique est au centre de l’étude de l’utilisation de la langue. En effet, il est impossible d’étudier les formes linguistiques utilisées dans les textes naturels, par exemple, sans être confronter aux problèmes de la variabilité linguistique. François Gadet (7) disait d’ailleurs à ce sujet qu’« il n’est pas de langue que ses locuteurs ne manient sous des formes diversifiées ». Il ajoute que les linguistes « saisissent cette différenciation en parlant de variétés pour désigner différentes façons de parler, de variation pour les phénomènes diversifiés en synchronie, et de changement pour la dynamique en diachronie ». La variabilité est inhérente au langage humain, un seul locuteur utilise plusieurs formes linguistiques à différentes occasions et différents locuteurs d’une même langue expriment les mêmes significations en utilisant des formes différentes. La plupart de ces variations sont hautement systématiques, les locuteurs d’une même langue choisissent la prononciation, le choix des mots et la grammaire en fonction d’un certain nombre de facteurs non linguistiques. Ces facteurs inclus le but du locuteur de communiquer suivant les relations entre lui et son interlocuteur, les conditions de la production et les diverses appartenances sociales le concernant.
La présente étude sur la variation diastratique en kabiyè s’inspire de la théorie de la variation panlectale développée dans le cadre des travaux de la sociolinguistique. Cette théorie s’appuie principalement sur les travaux de Robert Chaudenson approfondis et enrichis successivement par Meyerhoff et Nagy, d’une part et Gudrun Ledegen et Isabelle Leglise, d’autre part. Cette théorie considère le contact de langues comme l’un des facteurs explicatifs des variations observées dans une langue. Selon Gudrun Ledegen et Isabelle Leglise (6), les travaux dans le cadre de cette théorie « se focalisent sur la nature et l’importance respective des facteurs extrasystémiques, intrasystémiques et intersystémiques qui déterminent les variations observées ».
Les phénomènes qui retiennent l’attention du chercheur dans le cadre de cette théorie sont résumés ainsi qu’il suit dans le tableau ci-après :
| Changements relevant pour l’essentiel de l’intrasystémique dans lesquels l’interférence n’aurait au mieux qu’un rôle de renforcement (ex. : aller au docteur, laver ses mains) | Changements où il y aurait convergence de l’intrasystémique et de l’intersystémique, l’interférence conduisant à des restructurations du même type que celles qui pourraient être opérées par la seule voie intrasystémique (ex. aller au docteur, laver ses mains) |
| Changements se manifestant dans des zones de variabilité potentielle du français et constituant des variantes spécifiques directement issues du modèle non français par transfert intersystémique (ex. retourner back, chercher pour …) | Changements apparaissant dans le diasystème mais hors du F0 et relevant d’un aménagement individuel de la double compétence d’un bilingue, pour pallier une « défaillance » dans la langue dominée (ex. partir sur un voyage). |
1.2. Cadre méthodologique
La collecte des données s’est entièrement faite à Kara, dans la commune de la Kozah. Nous avons, dans un premier temps, procédé par observation semi-directe où nous avons assisté à des discussions à bâton rompu entre des personnes de différentes classes d’âges à la maison et dans d’autres endroits (tchakpalodrome, fontaines publiques et marchés du quartier). Nous intervenions par moment pour en introduisant certains sujets, histoire de mieux percevoir la variation entre les différentes classes.
Il a paru utile d’élaborer un questionnaire, en addition des données déjà collectées, comportant 70 mots en français. Le choix des mots a été fait de sorte qu’on ressente la variation conformément aux situations habituelles entre enfants, jeunes et personnes âgées. Nous passions les questions aux informateurs et eux nous les rendaient en kabiyè. Ces données, entièrement enregistrées par un dictaphone, ont été ensuite transcrites et analysées.
2. Facteurs de la variation diastratique en kabiyè
La variation diastratique de la langue est la variation sociale et démographique, c’est-à- dire la variation linguistique liée aux groupes sociaux et à la vie en société. Elle explique la différence entre les usages pratiqués par les diverses couches sociales, intégrant de ce fait les sociolectes. En effet, à une même époque et dans une même région des locuteurs différents, par des caractéristiques démographiques et sociales ont une différente façon de parler. L’étude de cette variation rend compte par exemple, des différences entre le langage des jeunes et celui des personnes âgées, entre le langage des groupes ruraux et celui des groupes urbains, elle rend compte encore des différences linguistiques entre les groupes professionnels ou, en fin, les différences selon les niveaux d’études des locuteurs. La variation diastasique se manifeste à travers plusieurs facteurs à savoir : le sexe, l’âge et les classes sociales.
2.1. L’âge
L’âge est le facteur le plus susceptible d’affecter la variation linguistique. Elle est considérée comme le facteur qui démontre le mieux s’il y a un changement au sein d’une communauté pour le même discours. Les études ont montré que les adultes emploient les variantes standard et traditionnelles tandis que les jeunes favorisent les formes non standard. Terry Nadasdi et al. démontrent une association de la variante auto parlée des locuteurs de moins de 30 ans et de la variante automobile au parler des locuteurs « d’âge moyen » (92). L’âge est le principal facteur dans la disparition de la variante traditionnelle. Nous notons également que le comportement linguistique de quelques groupes de locuteur dépend de leurs catégories d’âges.
En kabiyè, on constate les différentes ci-après :
| Enfants | Jeunes | Age mûr | ||
| 1 | chaise | kpéya | kpelaɣ́ | abalãkó |
| 2 | (le) manger | mam-mam | tɔkɩyɛ | tɔ́ɔ́náɣ |
| 3 | matière fécale | puuú | pɩ́ndʋ | awayɩ́ |
| 4 | igname | hɛyɛ | hɛyɛ | hɛyɛ |
| 5 | radio | radiiyo | aradiyo | wɛlɛsɩ |
| 6 | stylo | bik | bik | tɔlíɩm cɩ́kaɣ |
Comme ce tableau le montre, la notion de chaise est exprimée certes, de différentes manières mais le parler jeune et celui des enfants sont proches alors que celui de l’âge mur est totalement différent. De même, les lexies utilisées par les jeunes et ceux de l’âge mûr pour exprimer l’idée du manger sont proches alors que celle des enfants est totalement différente. La troisième lexie (matière fécale) est, par contre, très différente. Il est constaté des cas d’emprunts rendus différemment même si les lexies des enfants et des jeunes sont proches alors que les personnes de l’âge mûr utilisent carrément une autre lexie. Dans l’exemple 5, toutes les catégories d’âge utilisent des emprunts à la seule différence que les enfants et jeunes utilisent un emprunt d’origine française alors que la troisième catégorie utilise un emprunt d’origine anglaise. L’exemple 6, emprunt également, est rendu par un lexème totalement différent. Les enfants et les jeunes utilisent une même lexie qui n’est autre qu’une marque de stylo répandu en Afrique francophone et plus précisément au Togo. Les personnes d’âge mur ont une lexie issue d’un processus de création interne à la langue. Dans tous les cas de figure, il est observé une variation lexicale entre les trois catégories d’âge. La seule exception est observée dans l’exemple 4 où toutes les catégories ont la même lexie. Dans la partie 3, nous reviendrons amplement sur les lexies spécifiques à ces différentes catégories selon l’âge non plus pour expliquer mais pour donner la structuration des lexies utilisées.
2.2. Le sexe
Dans leurs pratiques courantes, il est observé également des différences de parler entre les hommes et les femmes parce qu’ils n’ont pas toujours les mêmes représentations linguistiques. Certaines des représentations peuvent être perçues positivement par les hommes alors qu’il n’en sera pas ainsi chez les femmes. Selon donc ces représentations qui ont un encrage socioculturel, l’utilisation des lexies variera d’un sexe à un autre. Anne Violin-Wigent (12) conclut déjà que « la tendance des femmes de plus de 40 ans de garder davantage de vocabulaire régional que les hommes du même âge est inversée pour les femmes de moins de 40 ans, qui montrent une plus forte tendance à abandonner le vocabulaire régional que les hommes du même âge ». Cette situation, même si elle indique cette variation entre les sexes, n’est pas identique dans la société kabiyè où, généralement, le comportement linguistique des femmes est le plus conservateur ou plus proche de la norme que celui des hommes. Cela est beaucoup plus remarquable lorsqu’il s’agit de s’exprimer sur des sujets liés à la sexualité ou aux parties du corps humain.
A titre illustratif, pour dire ‘’rapport sexuel’’, ‘’sexe’’, ‘’derrières de la femme’’, ‘’faire la cour’’ les femmes vont utiliser les lexies, kʋzʋʋ (7a), taŋnʋ́ (8c), pʋyʋ (9a), ɖánʋʋ (10a) là où les hommes diront plutôt yalaɣ (7b), ladɩyɛ/kodíye (8b), tɔbɩŋ (9b),ɖaʋ́ tʋʋ (10b) …
Les plus jeunes femmes semblent rejeter le vocabulaire ancien et préfèrent de plus en plus prononcer les mêmes lexies que les hommes du même âge. L’on entendra donc les lexies comme akpadɩyʋ́ (11), hilúu (12) ou mɩlʋ́ʋ (13) pour dire ‘’personne âgée, gourmandise ou voler.
2.3. Les classes sociales
Les classes sociales contribuent le plus à la variation linguistique, chacune ayant sa terminologie et ses expressions. Qu’ils soient forgerons, tisserands, menuisiers, prêtres, couturiers, guérisseurs, commerçants… ou cultivateurs/fermiers, les différents groupes socioprofessionnels contribuent énormément à l’enrichissement lexical puis, par la même occasion, à la variation linguistique. Même à l’intérieur d’un même groupe socioprofessionnel, il n’y a nullement d’homogénéité linguistique entre les différents lectes. Nous entendons par lecte, un parler spécifique réservé aux spécialistes d’un seul et même domaine voire sous-domaine. Il est donc un sous-ensemble d’un sociolecte. Un médecin, par exemple, utiliserait un premier lecte pour converser avec ses collègues médecins, un second pour échanger avec ses assistants et, enfin, un troisième lecte pour discuter avec ses patients.
Ainsi, un forgeron distinguera hakuu (14) de agooza hakuu (14a) et de hakuu kɩwasʋʋ (14b) alors que le citoyen habituel dira simplement hakuu. De même, un couturier, pour désigner habit, manteau, soutien-gorge, manche de vêtement et boubou, il utilisera tóko (15), niŋkaɣ tóko (15a), hɩla toko (15b), toko hamʋ́ʋ (15c) et tóko waa (15d) alors que le citoyen lambda dira simplement tóko (15). L’un des exemples le plus illustratif de la variation lexicale relève du domaine de la médecine traditionnelle. Les personnes enquêtées ont utilisé à 92% la lexie kɔ́yɛ (16) pour parler du produit alors que l’un des guérisseurs que nous avons interrogé nous a clairement dit que la lexie kɔ́yɛ est très vague et ne renvoi finalement à rien chez lui. Nous reprenons ci-après, les différentes occurrences avec leurs significations.
(16a) Heu taa kɔ́yɛ : espèce de plante herbacée à fleurs roses, à tiges et feuilles pileuse qu’on utilise pour faire une infusion au nourrisson
(16b) Kelá kɔ́yɛ : espèce de plante légumineuse et médicinale pour le soin des dents
(16c) Kɔ́yɛ kɩ́ɖaɣlɩyɛ : clou de girofle
(16d) Kɔ́yɛ kɩmɩzɩyɛ́ : produit qu’on pulvérise
(16e) Kɔ́yɛ kpooloo : espèce d’épice semblable à « kɔyɛ kɩ́daɣlɩyɛ » mais plus gros.
(16f) Tɛtɛ wondu kɔ́yɛ : insecticide
(16g) Ɛlɛyɛ kɔ́yɛ : espèce de plante médicinale entrant dans le traitement du vertige et de l’épilepsie
(16h) Limiye kɔyɛ : produit contre la phlébite
(16i) Ladɩhoka kɔyɛ : produit contre la hernie
Il est donc indéniable que tous les locuteurs n’utilisent pas les mêmes lexies et ne peuvent donc pas les maîtriser toutes ; l’utilisation et la technicité des lexies dépendront forcément des besoins que l’on ressent.
3. Structuration de la variation selon les classes d’âges
Ce troisième point a pour vocation d’analyser les structures des diverses lexies utilisées selon les différentes classes d’âge. Le peuple Kabiyè distingue fréquemment trois niveaux de classes d’âges au niveau des vivants : les enfants, les jeunes et les personnes âgées / personnes mûres. Nous élargirons donc les exemples, pour ensuite les analyser selon les procédés qui les ont fait naître.
3.1. La classe des enfants
Conformément à leur âge et au niveau du développement de leur appareil phonatoire, les enfants ont une manière particulière de s’exprimer. Cette façon n’équivaut nullement pas aux difficultés langagières. Cela est plutôt lié à l’incompétence linguistique, tout de même normal pour leur âge. C’est un acte inné de la faculté de langage qui peut être vue comme une grammaire universelle, c’est-à- dire un ensemble de principes qui guide l’enfant dans son apprentissage de la langue. Etant donné que cette faculté est propre à l’être humain l’enfant peut faire une grammaire de sa langue. Selon Noam Chomsky, si l’enfant ne produit pas certaines phrases à aucun stage de son apprentissage, c’est par ce que les constructions impliquées sont exclues d’emblée par les principes de grammaire universelle. En d’autres termes, il y a bien des phrases logiquement possibles mais qu’on n’observe pas dans les productions de l’enfant apprenant sa langue. Cela justifie donc le niveau de maîtrise de la langue chez les enfants.
Présentons quelques exemples issus des données collectées lors de l’observation et qui serviront d’analyse :
(17) pópó / pimpim ῞motocylette῞
(18) lↄyiyɛ / vúm vúm ῝voiture ῝
(19) ninεtɩ ῞lunettes ῞
(20) yídee ῝argent῝
(21) cuucuú ῞chiot῞
(22) yeyee ῝fleur῝
(23) kokoyikoo ῞poule῞
(24) kɔyɛ ῝produit῞
(25) peyaɣ́ ῞tabouret῝
(26) sʋyʋm ῞boisson῝
(27) puú ῝matières fécales῝
Après l’observation de notre corpus nous constatons que les enfants construisent la grammaire de la langue par imitation, par onomatopée, changement vocalique ou changement consonantique. Le procédé d’onomatopée, interjection émise pour simuler un bruit particulier associé à un être, un animal ou un objet, par imitation des sons, est assez abondant chez les enfants. Les exemples (17), (18), (21) et (23) l’illustrent bien. En effet, pour désigner moto, voiture, chiot et poule, les enfants rencontrés préfèrent imiter le bruit des engins ou l’aboiement du chien et le chant de la poule.
Au plan phonétique, il est constaté des changements vocaliques et consonantiques. Ainsi, la première syllabe de ninεtɩ, emprunté au français ‘’lunette’’ connait une variation vocalique. L’enfant préfère utiliser les voyelles non arrondies au lieu de faire des allers-retours entre les arrondies et les non arrondies. Il prononce donc la voyelle antérieure, non arrondie, de première aperture [i] qui est de même nature que [ε] d’aperture différente en lieu et place de celle antérieure, arrondie, de première aperture. Pareillement, plusieurs consonnes ont subi des changements par rapport à la norme langagière. On note cela essentiellement en position initiale où la consonne labiovélaire sourde [kp] de kpokpo et de kpélaɣ est remplacée par la bilabiale sourde [p] dans les exemples (17) et (25) ; [l] de lynεtɩ et de lidee est remplacée respectivement par la nasale labiodentale [n] dans l’exemple (19) et la semi-voyelle [y] dans l’exemple (20). Aucune variation morphologique n’est observée dans les exemples (22), (24) et (26) mais il y a cependant une variation tonale.
3.2. La classe des jeunes
Les jeunes Kabiyè ont une pratique langagière comparable à celle de plusieurs autres groupes juvéniles dans d’autres cultures. Elle dénote en effet un jargon rempli de mots nouveaux, généralement empruntés, exprimant les notions modernes. Leurs énoncés sont jonchés de plusieurs procédés à tel enseigne qu’ils sont rarement compris par d’autres classes lorsque la discussion se déroule entre eux. Les lexies, que l’on peut qualifier d’authentique, sont réservées aux échanges avec les parents et les autres membres de la communauté à qui ils doivent un respect total. Apprécions les exemples ci-après :
(27) tↄkɩyɛ ῝manger῞
(28) lambᾶndυ ῞sexe masculin῝
(29) fɛtʋ́ʋ ῞avoir des rapports sexuels῝
(30) tόmo ῝motocyclette῞
(31) týva ῝voiture῞
(32) daák ῝lunette῞
(33) cãtána ῝argent῞
(34) dɔɔg ῝chien῞
(35) hέrύυ ῝fleur῞
(36) tɔbʋʋ́ ῝copine῞
(37) gꭇãŋma ῝grand maman῞
(38) ŋma ῞maman῝
L’examen des lexies utilisées par la classe des jeunes permet de relever différents procédés à la fois néologiques et stylistiques. Passons en revue, entre autres, le verlan, l’emprunt et la synecdoque. Le verlan est un procédé argotique consistant à inverser les syllabes de certaines lexies ou de certaines locutions. Dans le corpus soumis à notre analyse, le verlan est observé dans les exemples (30) et (31) où les jeunes utilisent tόmo et tyva en lieu et place de ‘’moto’’ et ‘’voiture’’. On note donc deux procédés : d’abord un emprunt et ensuite le verlan.
L’emprunt est, selon Christian Loubier, « le procédé par lequel les utilisateurs d’une langue adoptent intégralement, ou partiellement, une unité ou un trait linguistique (phonologique, lexical, sémantique, syntaxique, etc.) d’une autre langue » (21). Il est observé dans les exemples (32), (34) et (37) où les lexies daák, dɔɔg et gꭇãŋma sont empruntées respectivement à l’anglais ‘’dark’’ et ‘’dog’’ d’une part et au français ‘’grand maman’’. Bien sûr, la lexie anglaise dark équivaut à noir et non lunettes. Mais dans leur usage, cette lexie signifie ‘’lunettes’’, partie d’abord de ‘’lunettes noires’’ et maintenant utilisée pour tout type de lunettes y compris les verres médicaux. Au plan diachronique, précisons que ŋma dans les exemples (37) et (38) est utilisé par les enfants pour désigner ‘’maman’’. C’est donc une contraction syllabique infantile dans le processus d’acquisition du langage qui a fini par être utilisée par les jeunes voire des personnes mures.
La synecdoque est un procédé stylistique qui consiste à désigner le tout par une partie. Dans les exemples (28), (29) et (36), les lexies lambᾶndυ ‘’prépuce’’, fɛtʋ́ʋ ‘’le geste d’aller et retour’’ et tɔbʋʋ́ ‘’derrière d’une femme’’ ne sont que des parties d’un ensemble.
L’ensemble de ces lexies d’une coloration argotique vient confirmer le caractère non seulement dynamique des pratiques langagières mais aussi leur variation continue.
3.3. La classe des personnes âgées
Les personnes mures utilisent souvent des mots authentiques dans leurs divers énoncés sauf dans des situations d’imitation de leurs enfants ou des jeunes avec l’objectif de les réprimander ou de les corriger. Elles sont les gardiennes du parler traditionnel et favorisent rarement des variations lexicales. Cette classe permet de percevoir les différents changements linguistiques opérés par les autres classes de la société. Dans la société kabiyè, les personnes âgées ne sont pas soumises à l’influence de l’école. Les exemples dont certains ont déjà des synonymes dans les exemples des classes enfants et jeunes nous permettent d’en adjuger.
(39) tɔɔ́wʋ ῞manger῝
(40) hɩ́nɛ ῞sexe masculin῝
(41) awayɩ ῞matières fécales῝
(42) kpόkpό ῞motocyclette῝
(43) lɔɔrɩ́yɛ ῞voiture῝
(44) ɛsɛ́ñɩnɩŋ ῞lunette῝
(45) kόbo ῞argent῝
(46) haɣ́ ῞chien῝
(47) hέtυ ῞fleur῝
(48) ɖooyú ῞poule῝
(49) ɛjam ῝handicapé῞
(50) ekpéni mʋlʋ́m ῞il/elle est décédé.e῞
(51) ɛvɛ́yɩ́ ῝il/elle est décédé῞
(52) pɩsaυ tↄláa ῞le pagne est tombé῝
(53) ɛwɩláyɩ́ níyé ῞il/elle l’a réprimandé῝
Dans l’ensemble, les exemples ci-dessus confirment que les personnes âgées conservent le vocabulaire ou le lexique authentique de la langue. En considérant les données, on peut faire les binômes synonymiques suivants, en mettant en premier lieu les lexies les plus traditionnelles : (39) tɔɔ́wʋ /(27) tↄkɩyɛ pour ῞le manger῞ ; (40) hɩ́nɛ /(28) lambᾶndυ pour ῞sexe masculin῞ ; (41) awayɩ /(27) puú pour ῞matières fécales῞ ; (44) ɛsɛ́ñɩnɩŋ /(32) daák pour ῞lunettes῞ ; (45) kόbo /(33) cãtána pour ῞argent῞ ; (46) haɣ́ /(21) cuucuú pour ῞chien῞ et enfin (47) hέtυ /(22) yeyee pour ῞fleur῝.
Il est également observé, dans l’usage des personnes mures, des expressions connotées non seulement liées aux niveaux de langues mais aussi aux tabous linguistiques comme le démontre Leonard Bloomfield (1933, p. 155). La connotation, faut-il le rappeler, désigne, selon Jean Dubois et al. (2012, p.111) “un ensemble de significations secondes provoquées par l’utilisation d’un matériau linguistique particulier et qui viennent s’ajouter au sens conceptuel ou cognitif, fondamental ou stable, objet du consensus de la communauté linguistique, qui constitue la dénotation”. Ainsi, la lexie (41) awayɩ “matières fécales” désigne littéralement “dehors”. Dans les maisons traditionnelles, les toilettes ne sont pas logées à la maison. Pour satisfaire ce besoin naturel, les membres de la familles vont donc au “dehors” pour se libérer avant de revenir. Il en est de même pour les lexies (50) ekpéni mʋlʋ́m et (51) ɛvɛ́yɩ́ dont les sens dénotés sont littéralement et respectivement “il/elle a apporté la farine” et “il n’est plus” pour signifier “il/elle est décédé.e”.
Les autres lexies notamment (42), (43) et (45) sont pour la première une onomatopée et pour les deux autres des emprunts respectivement de l’anglais et de l’haoussa.
Conclusion
La variation diastratique en tant que phénomène de contact de langues est bien visible dans les pratiques langagières des populations togolaises, notamment dans la communauté Kabiyè. C’est indiscutablement un phénomène qui met en lumière des changements linguistiques selon le milieu social auquel appartient un locuteur (sa classe sociale, son groupe professionnel, son sexe, son âge, etc.). Elle dépend de trois facteurs généraux : intralinguistiques, interlinguistiques et extralinguistiques. Le croisement de ces facteurs nous a permis, dans le cadre de cette étude, de prendre en compte l’âge, le sexe et la classe sociale qui sont assez manifestent dans la société Kabiyè dont la langue est décrite.
L’examen des données a révélé une véritable variation entre les différentes catégories d’âges, les sexes et les secteurs socioprofessionnels. Il en ressort de part et d’autre que l’utilisation de divers procédés à la fois néologiques et stylistiques, enrichie le vocabulaire de la langue et diversifie aussi les usages. Il s’agit, entre autres, de l’onomatopée, l’emprunt, la synecdoque, le transfert de sens et la connotation.
Cet exercice fortement enrichissant et intéressant nous invite à creuser également les autres types de variations pour mieux décrire les différents contours de la variation linguistique.
Travaux cités
Bavoux, Claudine. Le français de Madagascar. Contribution à un inventaire des particularités lexicales, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2000.
Bloomfield, Léonard. Language, New-York, Holt, Rinehart & Winston, 1933.
Chaudenson, Robert. Français avancé, ‘français zéro’, créoles, Provence, Publications de l’Université de Provence, 1985
Chaudenson, Robert, Mougeon Raymond et Béniak Édouard. Vers une approche panlectale de la variation du français, Paris, Didier-Erudition – ACCT, Coll. « Langues et développement », 1993.
Dubois, Jean et al. Le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris : Larousse. 2012.
Francard, Michel. « Décrire la variation en français contemporain. Outils théoriques et méthodologiques », Les Annales de l’Université de Craiova, série Langues et littératures romanes, numéro spécial : Variétés linguistiques et culturelles 7, Craiova, Edition Universitaria, 2005, p. 31-37.
Gadet, Françoise. La variation sociale en français, Paris, Ophrys, Coll. « L’essentiel », 2003.
Gudrun, Ledegen, Isabelle L´eglise. Variations et changements linguistiques. Wharton S., Simonin J. Sociolinguistique des langues en contact, ENS Editions, 2013, p.315-329, <halshs-00880476>
Lafage, Suzanne. Dictionnaire des particularités lexicales du français au Togo et au Bénin, Université d’Abidjan, ILA n° LIII, 1975
Lafage, Suzanne, et al. Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire. Québec, ACCT/AUPELF, 1983.
Loubier, Christiane. Les emprunts : traitement en situation d’aménagement linguistique. Québec : Les Publications du Québec. 2003
Meyerhoff, Miriam & Nagy Naomi. Social Lives in Language – Sociolinguistics and multilingual speech communities, Amsterdam: John Benjamins, 2008.
Mouzou, Palakyém. Terminologie mathématique français-kabiyè. Thèse de doctorat unique. Lomé : Université de Lomé. 2015.
Nadasdi, Terry, Mougeon Raymond, et Katherine Rehner. Expression de la notion de « véhicule automobile » dans le parler des adolescents francophones de l’Ontario. Francophonies d’Amérique, (17), 2004, p. 91–106.
Poirier, Claude. « Les variantes topolectales du lexique français. Propositions de classement à partir d’exemples québécois », Le régionalisme lexical, Michel Francard & Danièle Latin éds, AUPELF-UREF-Universités francophones, Coll. « Actualités scientifiques », 1995, p. 13-56.
Queffélec, Ambroise. « Les parlers mixtes en Afrique francophone subsaharienne », Le Français en Afrique, n° 22, 2007, p. 277-291.
Violin-Wigent, A. « Vocabulaire régional et transmission familiale : le cas du français briançonnais ». Linguistica Atlantica, n°26. 2005, p. 1–19.
- https://www.academia.edu/30898051/Variations_et_changements_linguistiques [consulté le 02/11/2021 à 16h46]
- https://www.erudit.org/fr/revues/fa/2004-n17-fa1812672/1005283ar/ [consulté le 02/11/2021 à 23h38]
- https://journals.lib.unb.ca/index.php/la/article/view/22525 [consulté le 03/11/2021 à 08h32]
- https://academiekabiye.org/download/dictionnaire-kabiye-francais/ [consulté le 03/11/2021 à 13h13]
- https://www.webonary.org/kabiye/ [consulté le 04/11/2021 à 09h13
Comment citer cet article :
MLA : Mouzou, Palakyém. « Variation diastratique en kabiyè, langue gur du Togo ». Uirtus 1.2 (décembre 2021): 233-247.
§ Université de Kara / [email protected]