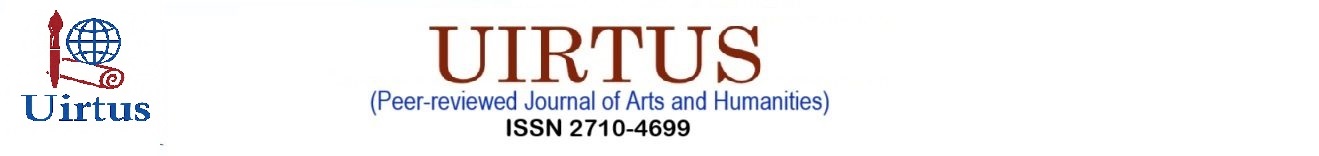Résumé : L’avènement de la COVID-19 a plongé le monde dans une vulnérabilité manifestement surprenante. Les conséquences s’étendent à tous les secteurs de la vie. Face à ce climat délétère, l’humanité tente de réagir. Dès lors, des mesures sont prises aussi bien à l’échelle mondiale notamment par le canal de l’OMS, que nationale. Ainsi, le Burkina Faso, à l’instar des autres pays, a entre autres développé des stratégies de riposte pour tenter d’endiguer la pandémie. Il s’agit notamment de la déclinaison des gestes ou mesures barrières et de l’exhortation à leur respect censé mettre fin à long ou court terme à la chaine de contamination de la maladie. Pour parvenir à une large diffusion de ces mesures, plusieurs supports médiatiques ont été mis à contribution parmi lesquels peuvent être cités, la télé, la radio, l’internet, l’affiche. Au nombre de ces supports, la télévision, l’affiche mais également l’internet, dans bien de cas, présentent la particularité, dans leur(s) contenu(s) sur la COVID-19, de donner à voir de façon simultanée, concomitante et interactive le signe iconique ou l’image et le signe ou lettrage linguistique[1]. La réflexion engagée dans le cadre de cet article est, ce faisant, de se demander si une telle configuration faisant cohabiter image et lettrage linguistique n’a pas une plus-value particulière en termes de « moyens d’action »[2] efficace sur le public.
Mots-clés : Pragmatique, pratiques sémiotiques, affichages urbains, COVID-19
Abstract: The advent of COVID-19 has plunged the world into manifestly surprising vulnerability. The consequences extend to almost all walks of life. In the face of this deleterious climate, humanity is trying to react. Consequently, measures are being taken both globally, notably through the WHO, and nationally. Burkina Faso, like other countries, has, among other things, developed response strategies to try to contain the pandemic. This concerns in particular the declination of gestures or barrier measures and the exhortation to respect them, supposed to put an end in the long or short term to the chain of contamination of the disease. To achieve wide dissemination of these measures, several media supports have been used, among which can be cited, TV, radio, Internet, billboards. Among these media, television, display but also the Internet, in many cases, have the particularity, in their content (s) on COVID-19, of showing simultaneously, concomitant and interactive image and linguistics. The reflection initiated within the framework of this article is, in doing so, to ask whether such a configuration, which brings together image and language, does not have a particular added value in terms of effective “means of action” on the public.
Keywords: Pragmatics, semiotic practices, urban displays, COVID-19
Introduction
Depuis 2019, le monde entier est frappé de plein fouet par la pandémie de la COVID-19. Le Burkina Faso, pour y faire face, a pris un certain nombre de mesures[3] et développé des stratégies de riposte[4] pour tenter de l’endiguer. Pour y parvenir, plusieurs supports médiatiques ont été mis à contribution parmi lesquels l’affiche matérialisant la particularité, dans son contenu sur la COVID-19, de donner à voir de façon simultanée, concomitante et interactive le signe iconique et le signe ou lettrage linguistique. L’on peut alors se demander si une telle configuration faisant cohabiter les deux types de signes, iconique et linguistique, a une plus-value particulière en termes de « moyens d’action »[5] efficace sur le public.
Au demeurant, la matérialisation singulière de l’occupation spatiale de l’affiche, sa configuration hétérogène dans l’espace urbain, etc. ne semblent pas neutres, anodines. Ce faisant, il ne paraît pas fortuit d’analyser ses configurations morphosyntaxiques, ses modifications (mutations) et les interactions entre elle et les lecteurs[6].
Dans cette perspective, les questions spécifiques ci-après peuvent être posées : les supports médiatiques alliant le signe iconique et le lettrage linguistique ne manifestent-ils pas une stratégie axée sur l’accentuation redondante ? Ne prennent-ils pas en compte, sur le plan culturel, tous les types de publics ? Leur emplacement spatio-temporel stratégique[7] ne fait-il pas d’eux des canaux de large diffusion ?
Ce travail s’inscrit de façon englobante dans la sémiotique ouverte [8] et de manière spécifique dans la sémiotique des pratiques[9]. De façon générale, cette dernière appréhende les « corps », les objets en qualité « de médiateur entre l’habitus et la praxis énonciative ». Un des intérêts de cette approche théorique est qu’elle permettra d’appréhender les éléments aussi bien linguistiques, iconiques, que plastiques de l’affiche comme un tout cohérent, signifiant et stratégiquement articulé.
Dès lors, le décryptage de cette entité signifiante devra permettre d’accéder à ses différentes configurations stratégico-pragmatiques manifestes et implicites. Prenant théoriquement appui sur la sémiotique des pratiques, ce travail se fonde sur les hypothèses ci-après : les supports médiatiques alliant le signe iconique et le signe linguistique manifestent une stratégie axée sur l’accentuation redondante ; ils prennent en compte, sur le plan culturel, tous les types de publics ; leur emplacement spatio-temporel stratégique les érige en des canaux de large diffusion ;
Se basant sur ces hypothèses, il s’agira pour nous d’essayer d’appréhender les effets illocutoires et perlocutoires des supports retenus sur le public, en l’occurrence, le public construit par le texte et les actes de langage indirects y configurés pragmatiquement. Ces effets pragmatiques sont d’autant importants qu’ils conditionnent les résultats escomptés de l’affichage. Dès lors, nous tentons de contribuer à une utilisation efficiente des affiches dans la sensibilisation et la lutte contre la COVID-19 dans le contexte du Burkina, un pays à fort taux d’analphabétisme.
Pour ce faire, nous avons parcouru la ville de Ouagadougou[10] et avons photographié toutes les affiches liées à la COVID-19. La ville de Ouagadougou a été choisie pour plusieurs raisons. Primo, après que les premiers cas de malades de la COVID-19 y sont déclarés, la ville a connu une floraison d’affiches ayant trait aux mesures barrières. Secundo, elle trône en tête des villes les plus contaminées au Burkina Faso, etc.
Se moulant théoriquement dans la sémiotique des pratiques, ce travail s’articulera suivant l’architecture ci-après : dans un premier temps, nous mettrons le curseur sur la médiation entre le linguistique et l’image et sa portée ; dans un deuxième temps, nous chercherons à mettre au-devant de la scène la gamme de publics configurés ; dans un troisième temps, nous nous pencherons sur les enjeux stratégiques des emplacements spatio-temporel de ces supports de communication.
Ce qui précède tient lieu d’aspectualisation schématique du plan de ce travail. Les lignes qui suivent consacreront l’amorce de notre analyse.
1. Aspectualisation pragmatico-énonciative des affiches
Dans cette rubrique, nous nous emploierons à l’analyse des différentes configurations signifiantes des différentes affiches du corpus. Le point inaugural se focalise sur l’emplacement du signe linguistique par rapport au signe iconique et vice versa dans l’espace du cadran de l’affiche.
1.1. Linguistique-iconique : localisation sur le cadran et ostentation
L’essentiel des affichages ayant trait à la COVID-19 matérialise par la cohabitation le signe linguistique et le signe iconique. Ces deux types de lettrage s’amalgament de manière symbiotique pour faire office de texte de chacune des affiches concernées. Sur le cadran de l’affiche, ils figurent dans des configurations diversifiées et se prêtent à la lecture tant sur l’axe syntagmatique que paradigmatique[11] ; activant, ce faisant, des jeux de vedettisation. La mise en emphase se fait principalement autour des couples /avant/arrière/ ; /haut/bas/, où les places /avant/ et /haut/ sont celles en vedette. Le lexème /avant/ employé en solidarité sémantique avec le terme /paradigmatique/ aura valeur sémantique de /haut/ dans les lignes ci-après consacrées à l’analyse statistique des différents contenus des affiches dévolues à ce travail.
Au demeurant, de manière pratique, sur seize (16) affiches que compte le corpus de cet article, il y a deux qui mettent en /avant/ le signe linguistique, et ce, sur le double plan syntagmatique et paradigmatique. Toutefois, il y a trois affiches qui sont impliquées dans ce faire. Et chacune de ces dernières englobe plusieurs lettrages linguistiques. Elles totalisent cinq lettrages linguistiques emphatiques en syntagmatique et trois occurrences linguistiques en paradigmatique. Il en émane que le signe ou lettrage linguistique est mis en vedette aussi bien syntagmatiquement que paradigmatiquement avec une légère préférence pour le plan syntagmatique.
Cependant, toutes les affiches photographiées n’articulent pas un tel schéma. D’autres matérialisent une architecture inverse : le signe iconique est positionné /avant/ le signe linguistique et se hisse dès lors en posture vedette. A l’instar du signe linguistique, cette posture se déploie aussi bien syntagmatiquement que paradigmatiquement.
Sur le plan syntagmatique, sur les 16 affiches photographiées, douze (12) vedettisent le signe iconique. Il se constate par ailleurs que six (06) affiches parmi les seize contiennent plus de deux signes iconiques. Dans cette dynamique, il apparaît que le total des affiches comptabilise vingt-huit (28) figurations en vedette du signe iconique.
Sur l’axe paradigmatique, sur les seize (16) affiches que compte le corpus, onze (11) emphatisent le signe iconique. À cela s’ajoute le fait que sur les onze (11) qui vedettisent paradigmatiquement le signe iconique, sept (07) matérialisent plusieurs signes iconiques vedettisés. En conséquence, sur ce même total de onze (11), quarante-et-un (41) signes iconiques sont mis en relief ; situation rendue possible évidemment par le fait que certaines affiches contiennent plusieurs signes iconiques mis en emphase[12]. Il en découle que les affiches du corpus, pour l’essentiel, privilégient la mise en vedette bâtie autour du signe iconique.
Pour récapituler, sur les affiches, le signe iconique et le signe linguistique se partagent les positions vedettes sur l’axe syntagmatique avec une prégnance de l’iconique. Le même scenario se répercute sur l’axe vertical avec le couple /haut/bas/. Cependant, la médiation entre le signe iconique et le lettrage linguistique ne se borne pas à cet aspect. Elle se définit par ailleurs par la nature de leur(s) lien(s).
1.2. Linguistique-iconique : types d’interactions
Au-delà des types de configurations données à voir ci-dessus et portant sur l’interaction du signe linguistique et du signe iconique, notamment sur leur posture spatiale, l’un par rapport à l’autre, il existe d’autres types d’interactions toujours focalisées sur le lettrage linguistique et le signe iconique. En effet, dans bien des cas, à chacune des mesures barrières édictées, correspond un signe iconique. Dans une large mesure, c’est la charge sémantique du signe iconique qui se trouve à l’identique répercuté au niveau du linguistique. Ce qui met le signe linguistique dans une situation de redite. Le signe linguistique réitère le message véhiculé par le signe iconique.
Ainsi, sur les seize (16) affiches du corpus, il se donne à voir cinquante-et-un (51) cas de redite du lettrage linguistique contre quatorze cas du signe iconique. Il en émane qu’il y a une prégnance de cas tautologique du signe linguistique. Ces résultats peuvent être davantage détaillés. Dans cette perspective, ils revêtent l’architecture ci-après. Sur le total des affiches, le signe linguistique présente vingt-sept (27) cas de pléonasme syntagmatiquement contre vingt-trois (23) cas paradigmatiquement. Il se perçoit que le plan syntagmatique est plus utilisé que celui paradigmatique.
Quant au signe iconique, il est dévolu à la redite dans neuf (09) cas sur le plan syntagmatique contre cinq (05) cas sur le plan paradigmatique. Ici, à l’instar du lettrage linguistique, le plan syntagmatique est plus sollicité.
Toujours dans la médiation entre le lettrage linguistique et le signe iconique, une autre configuration se livre à la perception. Il s’agit du cas de tautologie du signe linguistique où dans chacune des occurrences, deux signes iconiques ont été mis à contribution pour égaler le contenu sémantique du signe linguistique.
Dans cette optique, le corpus compte sept (07) cas repartis entre trois affiches : trois s’articulent syntagmatiquement et quatre, paradigmatiquement. L’analyse du contenu du corpus a permis de s’apercevoir également qu’il y a des cas de redite du signe iconique où dans chacune des occurrences deux signes iconiques ont été mis à contribution pour égaler le contenu sémantique du signe linguistique que ceux-ci reprennent. Sur ce plan, trois cas entrent en ligne de compte, en l’occurrence, deux syntagmatiquement et un, paradigmatiquement.
Un autre type d’interaction se donne à percevoir en marge de celui qui vient d’être évoqué. Il s’agit d’un cas de figure où le contenu sémantique du signe linguistique, contrairement au cas précédent, intervient en termes de complément d’information par rapport à la charge sémantique de l’iconique : ce n’est non plus une redite, mais une plus-value, une information additive.
En la matière, il se dégage dix-sept cas de figure où le signe linguistique est porteur d’information additive dans sa cohabitation avec le signe iconique alors qu’il se donne à observer trois (03) cas pour le signe iconique. On le voit, la redite est essentiellement dévolue au signe linguistique.
Il en découle que le signe linguistique est dévolu à un emploi multiple et multiforme sur le cadran des différentes affiches. La rubrique d’analyse suivante se penchera sur la distribution spatiale des affiches en milieu urbain qu’est la ville de Ouagadougou.
1.3. Emplacement des affiches dans l’espace urbain
Nous écrivions plus haut que l’enquête réalisée dans le cadre de cet article a consisté en une double opération : l’observation participante et la photographie des affiches ayant trait à la COVID-19 dans la ville de Ouagadougou. Il en a découlé que les espaces ci-après se partageaient les sites d’affichage ou d’implantation des différentes affiches du corpus.
Il s’agit essentiellement des voies notamment bitumées de la ville de Ouagadougou, de l’entrée des pharmacies, des cliniques, des centres d’imagerie médicale, des sièges d’opérateurs de téléphonie mobile, des institutions financières et des Gabs. La grande majorité des affiches photographiées l’ont été sur ces lieux.
Illustrativement, une des affiches du corpus, à contenu portant évidemment sur la COVID-19 et accolée à plat sur un panneau d’affichage, a été photographiée dans la ville de Ouagadougou notamment au bord de la voie bitumée passant devant l’entrée du bâtiment abritant le ministère des affaires étrangères et se dirigeant vers l’archevêché de Ouagadougou. Géographiquement, c’est une route qui se trouve quasiment au centre-ville. Plusieurs autres affiches du même type existent sur la même voie, en l’occurrence, du côté de la voie opposée à l’emplacement du ministère ci-dessus cité. Une observation attentive permet d’avancer que cela est dû au fait que ce côté de la voie recèle de plus d’espace et donc plus propice à l’implantation des panneaux que les différentes affiches ont pour support. Ce sont de grosses affiches occupant tout le cadran de ces panneaux géants. Comme on le voit, les affiches ont été essentiellement implantées à des lieux précis dans la ville de Ouagadougou. À travers cette séquence d’étude et avant elle, les deux premières portant respectivement sur l’interaction entre le lettrage linguistique et le signe iconique dans l’espace du cadran, suivi du type de liens qui les lient, il a été procédé à l’aspectualisation des différentes facettes des affiches du corpus. L’étape ci-après sera une tentative d’explicitation des implicites, des actes de langage indirects arrimés aux différents aspects du corpus décrit et les enjeux praxéologiques qui en découlent.
2. De l’encodage au décodage des affiches
Il s’agira ici de cerner les implications profondes des différentes séquences décrites précédemment.
2.1. Jeux de prégnance iconique/linguistique et public(s) configuré(s)
Au niveau de la première rubrique d’analyse de cet article, il a été relevé que la plupart des affiches du corpus apparaissaient dans des combinaisons variées. Par la suite, il a été noté dans un premier temps que sur les seize affiches du corpus, il y a deux qui vedettisaient le signe linguistique. Les deux plans, syntagmatique et paradigmatique, ont respectivement bénéficié de deux mises en emphase. Nous précisions finalement que cette parité s’expliquait par le fait que ce sont trois affiches qui sont concernées par la vedettisation du lettrage linguistique sur les deux axes donnés.
Ce bilan partiel qui vient d’être fait concernant le lettrage linguistique a trait à chaque affiche prise individuellement et globalement, en l’occurrence, les trois affiches valorisant le lettrage linguistique. Or, comme nous l’écrivions, la quasi-totalité des affiches, en l’occurrence quinze sur seize, contiennent au moins deux signes iconiques et deux lettrages linguistiques. Dans cette lancée, et toujours avec les trois affiches en propos, il a été retenu en termes de bilan que le signe linguistique est vedettisé tant sur le plan syntagmatique que paradigmatique à hauteur respectivement de cinq lettrages linguistiques emphatiques et trois occurrences linguistiques vedettisés. Ce qui matérialise une légère longueur d’avance pour le plan syntagmatique.
Dès lors, il est à retenir deux aspects. Le premier est que quinze affiches sur seize englobent au minimum deux signes iconiques et deux lettrages linguistiques. Autrement dit, une seule affiche se borne à un signe iconique et un lettrage linguistique. Le second point à ne pas perdre de vue est que sur les seize, et dans une appréhension englobante n’entrant pas dans les détails, deux affiches sont en tout mises en emphase syntagmatiquement et deux autres, paradigmatiquement, lorsque focalisation est uniquement faite sur le signe linguistique.
Il en émane en première instance que l’ensemble des affiches, du fait de la présence du signe linguistique, configure un public, un lectorat lettré. En effet, un public ne sachant pas lire et/ou écrire ne pourra pas en principe accéder à la charge sémantique de l’affiche portée par sa dimension linguistique.
Toutefois, la minoration statistique de la vedettisation de la linguistique donne à entendre que ce public lettré n’est pas celui qui est privilégié. Et quand est pris en compte le détail du cadran de ces trois affiches, en rappel, il se constate que cinq lettrages linguistiques sont vedettisés syntagmatiquement et trois paradigmatiquement. Ce qui constitue une poussée statistique dans la vedettisation du lettrage linguistique. Toutefois cette progression reste marginale eu égard à l’effectif des affiches qui s’élève à seize. Ce qui confirme ce qui a été dit précédemment à savoir que, certes le public lettré est visé, mais il n’est pas le privilégié.
Nous parlions sous peu de cinq lettrages emphatiques pour le plan syntagmatique contre trois pour le paradigmatique et nous en avions conclu que cela manifestait une préférence relative pour le plan syntagmatique. Si cet axe est le plus dominant ici, trajectoire classique voire dominante de la lecture en français, cela insinue que les destinateurs de ces affiches sont restés dans le schéma populaire, plus connu, non sophistiqué et à la portée non seulement du lecteur lettré mais également du lectorat alphabétisé et censé être en termes de compétence linguistico-culturel du niveau du lecteur basilectal. Ce faisant, il se trouve configuré et privilégié les lecteurs lettrés et les lecteurs alphabétisés.
Ce qui précède a trait au linguistique utilisé syntagmatiquement et paradigmatiquement. Toutefois, on l’a vu, les affiches n’abritent pas que le signe linguistique de manière manifeste. Ce dernier partage l’espace du cadran de l’affiche avec le signe iconique. Plus exactement, il a été conclu que certaines affiches, a contrario du schéma ci-dessus évoqué, mettent en posture emphatique le signe iconique. Un déploiement qui se projette sur le double plan syntagmatique et paradigmatique.
Sur l’axe syntagmatique, en rappel, douze affiches sur seize mettent en exergue d’un point de vue global le signe iconique contre onze sur le plan paradigmatique. Il est détectable que c’est la quasi-totalité des affiches du corpus qui optent pour la mise en emphase du signe iconique, qui lui font la part belle. Il est largement plus mis en vedette que le signe linguistique dans leur cohabitation.
Il en découle que l’occurrence du signe iconique en tant que séquence du texte configure un public illettré. En d’autres termes, à travers le signe iconique est contextuellement lorgné un public illettré et le canal utilisé ici pour parler à cette couche est l’analogie. Le signifiant partageant certaines qualités du référent permet au lecteur illettré de reconnaître à travers ce signifiant le référent concerné. Myriam Dumont parle d’iconique fonctionnel[13]
On le voit, l’affiche à travers le signe iconique configure un public illettré. Or le corpus dans sa quasi-totalité met en emphase le signe conique. Ce qui pousse à la compréhension que les affiches du corpus privilégient un lectorat illettré par la vedettisation statistiquement prépondérante du signe iconique.
Privilégiant le signe iconique, il y a comme une volonté doublée d’une stratégie de ratisser large en termes de lectorat. La stratégie se comprend bien et semble prendre en compte le contexte africain et burkinabè où la population est essentiellement analphabète.
2.2. Linguistique-iconique : redondance et complémentarité
La séquence précédente a gravité autour de la posture spatiale du signe linguistique et du signe iconique et vice versa sur le cadran de l’affiche. En marge de cela, d’autres types d’interaction existent entre les deux comme il a été vu dans la séquence de l’analyse. Là, il en est ressorti que, dans nombre de cas, à chacune des mesures barrières énoncées, était arrimé un signe iconique. Pour l’essentiel, c’est le contenu sémantique du signe iconique qui est à l’identique repris linguistiquement.
Concrètement, il est apparu que sur les seize (16) affiches du corpus, il a été dénombré cinquante-et-un (51) cas de figure où le lettrage linguistique reprend la charge sémantique du signe iconique. L’inverse s’exprime dans quatorze (14) cas. Il en émane que le signe linguistique est le plus dans la redite. Syntagmatiquement, il en affiche vingt-sept (27) contre vingt-trois (23)paradigmatiquement. Quant au signe iconique, il en comptabilise neuf (09) syntagmatiquement et cinq (05) paradigmatiquement. Dans ce dernier cas, à l’exemple du signe linguistique, l’axe syntagmatique est le plus usité. Il y a dès lors indication que certes tout type de lectorat est lorgné, mais manifestement c’est le lecteur illettré et analphabète qui sont avant tout privilégiés.
Les redites évoquées ci-dessus portent le nom de fonction de redondance chez Barthes[14] et de fonction autonymique chez V. Lucci[15] : le lettrage linguistique ou le signe iconique « vient doubler l’appellation »[16] du message transmis. Il y a une sorte de massification du contenu informatif ; un désir de mise en vedette, de pousser au-devant de la scène l’information. Ce qui tend à reléguer au second plan la description identitaire du virus agent pathogène. Il y a davantage insistance sur le message transmis. Cette catégorie d’iconicité ou de signe linguistique, en l’occurrence autonymique, est sans ambages la matérialisation d’un vouloir de mettre le curseur avant tout sur l’information, une quête de vedettisation redondante : « Elle fonctionne un peu comme une sorte de soulignage d’un genre particulier […]. »[17] Il en émane que l’iconicité ou le signe linguistique autonymique pousse à percevoir l’information et à y adhérer.
En résumé, dans leur interaction sur le cadran de l’affiche, le signe linguistique et le signe iconique se partagent la fonction de redondance avec une nette prégnance du signe linguistique et de l’axe syntagmatique. Cette redondance n’a pas une configuration homogène sur toutes les affiches.
Il s’observe[18] des cas de redite du signe linguistique où dans chacune des occurrences, deux signes iconiques sont mobilisés pour égaler le contenu sémantique du signe linguistique. Le corpus en matérialise sept (07) cas partagés entre trois affiches. L’axe syntagmatique recèle trois cas et le plan paradigmatique, quatre. Si la redite avec mobilisation de deux signes iconiques concerne ici le lettrage linguistique, le signe iconique n’est pas en reste. Autrement dit, il y a des cas où c’est le signe iconique qui est dans une posture de redite et à l’instar du cas précédent, il y fait figure sous la forme de deux signes iconiques et réédite le contenu sémantique du signe linguistique. Totalisant trois cas, deux se déclinent syntagmatiquement et un, paradigmatiquement.
Dans cette séquence où deux signes iconiques sont sollicités pour matérialiser le contenu sémantique du lettrage linguistique, il y a une volonté de faire en sorte que chacune des mesures barrières édictées linguistiquement, et lorgnant de ce fait les lettrés et les alphabétisés, soient de façon précise et maximale, exhaustive comprises des illettrés et des analphabètes. La condensation se bornant par principe aux traits saillants, il a été jugé plus efficient de recourir à deux signes iconiques dans une perspective méthodico-pédagogique pour rendre compte du contenu sémantique du lettrage linguistique portant sur chacune des mesures barrières. Ce besoin dénote de l’ampleur de l’enjeu qui est de briser la chaîne de contamination de la COVID-19 au sein d’une population essentiellement analphabète.
Au regard de ce qui précède, le lettrage linguistique mais également le signe iconique assument la fonction de redondance sur nombre d’affiches. Dans son rôle de redite ou non, le signe iconique se mue en deux pour sémantiquement rendre compte du contenu du signe linguistique. À côté de cette forme de médiation entre le signe iconique et le signe linguistique, une autre d’un tout autre aspect prend corps entre les deux.
Il s’agit d’une figuration où la charge sémantique du lettrage linguistique, a contrario des cas précédents, se matérialise sous forme de complément d’information à la charge sémantique du signe iconique : ici il ne s’agit plus d’une redite, mais d’une plus-value, une information additive. Dix-sept (17) cas ont été comptabilisés dans le corpus au niveau de l’analyse où le lettrage linguistique ne répercute pas le contenu sémantique du signe iconique qui le précède et avec lequel il partage l’espace du cadran ; il est plutôt porteur d’une information additive, supplémentaire à la charge sémantique du signe iconique. Il y a trois (03) autres cas où c’est le signe iconique qui est dans ce rôle d’apport d’information additive au contenu sémantique du lettrage linguistique.
Il apparaît dès lors que le rôle de supplément d’information est principalement l’apanage du signe linguistique.Cette fonction porte le nom de relais ou de complémentarité chez R. Barthes. La fonction de complémentarité conjoint ici au signe linguistique vise à pallier les insuffisances inhérentes au signe iconique. En effet, le signe conique fait montre souvent de plusieurs faisceaux sémantiques, de plusieurs parcours sémémiques et dans ce cas le signe linguistique vient canaliser et diriger le lecteur vers le sens voulu et virtualiser du même coup les autres parcours sémémiques restants. Il en émane que cela répond à des objectifs d’efficience et d’efficacité dans la lecture des affiches dans un contexte de pluralité de publics lorgnés et modes de communication.
Au demeurant, il émerge que le signe linguistique est par excellence le mode d’expression des subtilités et le signe iconique, celui qui permet de s’adresser aux illettrés et aux analphabètes et permet par conséquent d’atteindre un large public.
2.3. Implantation spatio-urbaine des affiches : un déploiement stratégique
L’enquête réalisée dans le cadre de cette étude a consisté en la photographie des affiches portant sur la COVID-19 dans la ville de Ouagadougou. Ce travail d’enquête a permis de dresser un certain nombre de constats. Au nombre de ces derniers, on pourrait noter le fait que l’implantation des affiches dans l’espace urbain fait la part belle à un certain nombre de lieux. Il s’agit notamment des artères[19] de la ville de Ouagadougou, de l’entrée des pharmacies, des cliniques, des centres d’imagerie médicale, des sièges d’opérateurs de téléphonie mobile, des institutions financières et dérivés, en l’occurrence, des Gabs. La quasi-totalité des affiches photographiées l’ont été sur ces lieux.
Cela peut être expliqué en partie par le fait que ce sont des lieux assez fréquentés par les citadins. On le sait, dans l’espace urbain, les voies constituent quasi exclusivement les canaux de mobilité des citadins. Permettant la mobilité urbaine, elles sont quotidiennement prises d’assaut par toutes les couches socioprofessionnelles de manière quasi ininterrompue et dans les deux sens. Ce qui justifie a posteriori l’implantation des affiches tout au long de ces voies pour se donner les chances d’assurer leur visibilité et par conséquent leur lecture par un grand nombre de citadins.
La présence des affiches à l’entrée des pharmacies obéit au même impératif de visibilité. En effet, les pharmacies sont des lieux habilités à la vente des médicaments de sorte que l’affluence y est toujours de mise. C’est un nombre important de citadins qui y afflue à longueur de journée et même la nuit pour y acheter des médicaments. Ce faisant, elles font office de lieu de grande visibilité pour un pan substantiel de la population urbaine. A l’instar des routes, les pharmacies sont nombreuses et disséminées à travers la ville.
Ce sont les mêmes raisons de visibilité qui sous-tendent l’implantation des affiches à la devanture des hôpitaux : les centres hospitaliers publics et privés. Certes, l’automédication est une pratique courante en Afrique noire en générale, et au Burkina en particulier. En conséquence, il arrive qu’un citadin prenne la route d’une pharmacie sans passer par la consultation à l’hôpital. Toutefois, il est assez habituel que les patients passent d’abord par la case hôpital avant de se rendre dans une pharmacie munie généralement d’une ordonnance. Il en émane que les affiches s’implantent aux abords, voire à l’entrée des hôpitaux pour des besoins de visibilité.
Tout comme les centres hospitaliers, les sièges d’opérateurs de téléphonie mobile abritent des affiches portant sur les mesures barrières à leurs entrées. Le choix de ces lieux répond non seulement à la volonté de l’entreprise occurrente, pour autant que faire se peut, de se prémunir contre la maladie, mais également à un besoin de visibilité dû au fait que les maisons de téléphonie mobile sont des lieux de grande fréquentation.
Au nombre des lieux privilégiés par les affiches, il y a l’entrée des institutions financières. Ce fait répond non seulement à la volonté des institutions concernées de casser la chaine de contamination de la maladie, de mettre leur(s) personnel(s) à l’abris de contamination, mais également, pour des besoins de visibilité de ces affiches par un grand nombre de personnes, de citadins vu que ce sont des lieux d’affluence, des lieux assez fréquentés par les citadins pour des préoccupations gravitant autour de la téléphonie mobile. Cet état de fait est non seulement vrai pour les banques mais également pour les gabs qui font partie intégrante des banques.
Il en émane que la visibilité est une des raisons essentielles des différents emplacements cités. Une autre raison arrimée à celle de la visibilité pour une large part peut être citée : une opération de communication en lien avec l’image de marque des institutions concernées ou le gouvernement. Donner à voir qu’ils sont socialement responsables, se souciant de la santé des clients (institutions bancaires) ou de la population (gouvernement) de sorte qu’ils prennent la menace de l’épidémie qu’est la COVID-19 à bras le corps. Un tel message se dégage sur le plan du paraître.
Conclusion
Au total, l’avènement de la COVID-19 dans le monde et au Burkina a eu pour corollaire une flopée d’implantations des affiches y afférentes dans la ville de Ouagadougou. Situées dans des lieux stratégiques, elles amalgament sur leurs cadrans respectifs, le lettrage linguistique et le signe iconique. Une telle configuration n’est pas anodine. Elle vise l’efficience praxéologique des affiches sur les coénonciateurs et par ricochet sur la population de Ouagadougou. Cette efficacité est recherchée sur une palette d’échelles. En premier lieu, elle est portée sur le cadran par le positionnement du signe linguistique par rapport au signe iconique et vice versa activant ainsi des jeux de vedettisation à la base en partie de la configuration des différents types de coénonciateurs. En deuxième lieu, elle est manifestée par le type de lien(s), redondance ou complémentarité, existant entre signe linguistique et signe iconique sur le cadran de l’affiche offerte à la lecture et manifestant partiellement l’insistance par la redondance. En troisième lieu, elle est matérialisée par la distribution spatiale stratégique des affiches dans l’espace urbain, aspect qui par ailleurs n’est pas sans lien avec la recherche de visibilité. Une telle recherche d’efficience dans le dire des affiches vise des effets escomptés. Ces effets perlocutoires escomptés sur les citadins se discriminent au moins en deux ordres. Le premier, à valeur d’objet modal, est de prendre en compte, de cibler toutes les couches de la population sans distinction de niveau culturel. Plus exactement, les énonciateurs des affiches s’adressent par le truchement de l’affichage aux lecteurs de tous les niveaux culturels : de l’analphabète au lecteur de niveau acrolectal en passant par les strates basilectale et mésolectale. Le second ordre est de réussir subséquemment le faire-persuader et le faire-adhérer des populations au respect des mesures barrières édictées par l’organisation mondiale de la santé (OMS) afin de stopper ou de briser la chaîne de contamination de la pandémie. Il en émane que la question fondamentale de cet article qui tâchait de savoir si la cohabitation du signe linguistique et du signe iconique sur le cadran de l’affiche avait une plus-value spécifique en termes de « moyens d’action » efficaces sur le public se vérifie avec les hypothèses y afférentes. Il est alors à retenir que l’exégèse de l’affiche faite sur la base de son aspectualisation a permis d’avoir accès à ses différentes configurations pragmatico-tactico-stratégiques manifestes et implicites. Toute chose qui donne à percevoir que les objectifs initialement fixés dans le cadre de cette étude ont été atteints. Ce qui paraît entériner du même coup la pertinence de la sémiotique des pratiques, orientation théorique choisie, pour ce sujet sur les affiches portant sur la COVID-19.
Travaux cités
Denis, Vernant. Introduction à la philosophie contemporaine du langage : du langage à l’action. Paris : Armand Colin. 2010.
Dominique, Maingueneau. Analyser les textes de communication. Paris : Armand Colin, 2e édition. 2009.
Erik, Bertin ; Couégnas, Nicolas et alii. « Des outils sémiotiques pour la pensée stratégique », in Solutions sémiotiques. Limoges : Lambert-Lucas. 2005.
Fontanille, Jacques. « Stratégies doxtiques, Explorations stratégiques », in Actes sémiotiques-Bulletin. VI. 1983.
Fontanille, Jacques. Pratiques sémiotiques. Paris : PUF. 2008.
………… Sémiotique du visible. Paris : PUF. 1999.
Jean-Jacques, Boutaud ; Eliseo Veron. La sémiotique ouverte. Itinéraires sémiotiques en communication. Paris : Lavoisier. 2007.
Jean-Jacques, Boutaud. « Sémiotique et communication. Un malentendu qui a bien tourné », in Hermès, n° 38, 2004, p. 96- 102.
Jean-Michel, Adam et Marc Bonhomme. L’argumentation publicitaire. Rhétorique de l’éloge et de la persuasion. Paris : Armand Colin. 1997.
Karine, Berthelot- Guiet. Analyser les discours publicitaires. Paris : Armand Colin. 2015.
Maxime, Drouet. « De ‘‘la communication’’ à ‘‘la conversation’’ : vers un nouveau paradigme en publicité ? », in communication et langage, n°169, 2011, p.39 – 50.
Patrick, Charaudeau. Le discours d’information médiatique. La construction du miroir social. Paris : Nathan. 2004.
Roger, Odin. « La question du public. Approche sémio-pragmatique », in Réseaux, Volume 18, n°99, 2000.
Roland, Barthes. « Rhétorique de l’image », in Communication, n°4. 1964.
Comment citer cet article : MLA : Kabore, Ibraogo. «Praxéologie des affiches de la COVID-19 : le cas de Ouagadougou». Uirtus 1.2 (décembr
§ Université de Ouagadougou / [email protected]
[1] Les études sémiotiques portant sur les affiches distinguent deux ou trois composantes de l’icône visuelle : le signe iconique, le signe plastique et le signe linguistique. Le signe iconique est une unité visuelle qui permet de reconnaître un objet parce qu’il a avec celui-ci des similitudes, des ressemblances. Quant au signe linguistique, il correspond au lettrage linguistique sur l’affiche. Le signe plastique réfère à la texture, à la forme des images et à la chromatique ou jeux des couleurs. Le signe plastique se mue généralement en composante du signe iconique. Pour évoquer ces signes en termes de contenu de l’affiche, Jacques fontanille parle d’« icono-texte » (Fontanille 179).
[2] Karine Bertholet-Guiet, Analyser les discours publicitaires, Paris, Armand Colin, 2015, p.9.
[3] Entre autres, la fermeture des frontières terrestres, aériennes[3] et des marchés sur un certain temps[3], des tests de dépistage.
[4] Port des masques, utilisation du gel hydro-alcoolique, lavage des mains, etc.
[5] Karine Bertholet-Guiet, Analyser les discours publicitaires, Paris, Armand Colin, 2015, p.9.
[6] Idem.
[7] Dans les lieux à trafic humain important doublé de leur caractère permanent (durée dans le temps).
[8] Jacques Fontanille, Pratiques sémiotiques, Paris, PUF, 1ère édition.
[9] Idem.
[10] Du 16 octobre 2020 à partir de 09 heures 12 minutes au 18 novembre 2020 à 13 heures 58 minutes.[10]
[11] L’axe syntagmatique correspond à l’axe horizontal, l’axe de lecture le plus répandu en français. L’axe paradigmatique, quant à lui, réfère à l’orientation verticale.
[12] Notons que quinze affiches sur les seize englobent au moins deux iconiques chacune et il en est de même du signe linguistique.
[13] Dumont (Myriam), op. cit., p. 76-78.
[14] R. Barthes
[15] Lucci (Vincent), Millet (Agnès), Billiez (Jacqueline), Sautot (Jean-Pierre).-Des écrits dans la ville. Sociolinguistique d’écrits urbains : l’exemple de Grenoble.-Paris, Harmattan, 1998.
[16] Idem.
[17] Lucci
[18] Voire séquence de l’analyse
[19] De préférence celles bitumées.