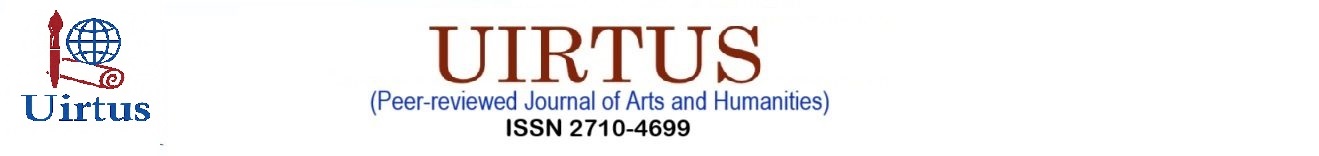&
Piyabalo Nabede
Résumé : La poésie est, dans son essence mystique, une co-naissance, une rencontre entre le monde intérieur du poète et celui extérieur débouchant sur une métamorphose féconde. Sur le chemin de l’exploration du monde réel et fictif, Victor Hugo et Koutchoukalo Tchassim se retrouvent dans le champ du grand travail par l’usage du rythme, des images d’un lexique exubérant de désignation de paysages exotiques. Tous deux ont acquis une conscience cosmique où il n’y a pas de séparation entre le grand moi, homo maximus, et le monde. D’un côté, de Les Plaies (2016) en passant par Je ne suis pas que négatif (2017) et débouchant sur Elle (2019), l’auteure Koutchoukalo Tchassim, témoin d’un monde de paradoxes, convie le lecteur à la table d’un menu de mots qui le conduit dans un univers baroque, reflet de la postmodernité. De l’autre, Victor Hugo, monument de la poésie romantique croise dans Les Orientales, les civilisations occidentales et orientales par la peinture des cultures orientales imaginées. Les approches géopoétique[1] (Kenneth White) et sémiotique (Charles W. Morris), dans une perspective comparatiste, ont permis de découvrir la perception cosmoculturelle[2] des deux auteurs à travers leur langage poétique militante et humaniste.
Mots-clés : comparatiste, humaniste, géopoétique, paradoxes, parole poétique, sémiotique
Abstract: Poetry is, in its mystical essence, a co-birth, a meeting between the poet’s inner world and the outside world, leading to a fruitful metamorphosis. On the path of the exploration of the real and fictional worlds, Victor Hugo and Koutchoukalo Tchassim stand in the field of great work with the use of rhythm, images of an exuberant lexicon of exotic landscape designations. Both poets have acquired a cosmic consciousness where there is no separation between the great self, homo maximus, and the world. On the one hand, beginning with Les plaies (2016) through Je ne suis pas que négatif (2017) and leading to Elle (2019), Tchassim, by witnessing a world of paradoxes, invites the reader to the table of a menu of words that leads them in a baroque universe, reflection of postmodernity. On the other hand, Hugo, one prominent figure of the romantic poetry, crosses in Les orientales, the western and eastern civilizations with the painting of the imagined oriental cultures. From a comparative perspective, Kenneth White’s geopoetic[3] and Charles W. Morris’ semiotic approaches have permitted to discover both authors’ cosmocultural[4] perception through their activist and humanistic poetic words.
Keywords: Comparative, Humanist, Geopoetics, Paradoxes, Poetic Speech, Semiotics
Introduction
La poésie n’est ni la simple versification ni des constructions complexes et hermétiques de phrases, elle est plutôt mélodie, suggestion, évocation et transmutation de sens des mots sous l’effet de l’inspiration et du travail. Vain est l’effort de vouloir définir la poésie, car « elle n’est jamais déjà là, elle est toujours à retrouver ou à réinventer» (Blanchot 273) Et chaque poète a son expérience originale. La saisie de la poésie écrite n’est possible que lorsqu’il y a une entente mystique ou une complicité entre le lecteur et le poète pour l’érection d’un nouveau code parallèle à celui de la langue ordinaire de communication. D’une part, Cette forme de communication crée un cadre d’espérance de vie à ceux qui courbent l’échine sous le poids de l’ignorance et de la paresse les conduisant à une sorte de situation d’anomie ou de mort, et, d’autre part, elle représente les espaces fictifs et réels où se déroulent des scènes horribles ou romantiques. Ce dernier aspect de l’alternative est la quintessence de Les orientales de Victor Hugo.
Si la poésie est invention d’une autre forme de langage, cette étude se veut une analyse comparative des formes de la construction des poèmes de Koutchoukalo Tchassim et celles de Victor Hugo, dans Les orientales, en vue de vulgariser le langage poétique de l’auteure[5] togolaise. Composer un poème est une façon différente d’écrire, un acte qui consiste à imposer à la langue ordinaire une rupture qui fait naître un langage qui dit plus que la communication ordinaire, un acte d’écriture qui présente un monde opposé à celui du réel. Comment les deux auteurs sont-ils arrivés à décrire et à représenter les paysages peints ? Si la parole poétique de Koutchoukalo Tchassim sourde du sirop amer de l’existence humaine, c’est qu’elle a fait sienne, comme une mère de famille-humanité, de toutes les joies et peines, et ceci sans distinction de race, de genre, d’espace et de temps. Il nous a semblé que l’auteure, par la puissance de son verbe, a su dompter l’espace et le temps en les réduisant en des points, pour mieux transcrire des existences individuelles et des cultures. De même, à l’époque romantique, l’exotisme répond à un besoin d’évasion, à un désir de changer de cadre et de condition de vie. Victor Hugo est l’un des écrivains qui ont parlé de l’Orient sans l’avoir vu. Comment les deux auteurs ont pu représenter l’ailleurs à travers leur parole poétique ? Quel en est l’enjeu ? Pour ce faire, les approches comparatiste, géopoétique et sémiotique nous ont servi pour ressortir la manière dont les deux auteurs, très distants dans le temps et l’espace, décrivent leur projet de société.
1- Désignation des civilisations
La parole est l’acte individuel par lequel s’exerce la fonction du langage, la faculté d’exprimer sa pensée par des mots à l’écrit ou à l’oral ; elle charrie notre discours mental, la succession de nos pensées, sensations, imaginations, rêves et souvenirs. Ainsi, les paroles poétiques des deux auteurs ont désigné des espaces, des lieux et des endroits par l’entremise des images allégorique, métaphorique, métonymique, symbolique, voire fabulique. C’est par ces techniques stylistiques de désignation et de symbolisation qu’ils ont transcrit leurs rêves à travers la peinture des peuples et des êtres, des existences individuelles et collectives, des civilisations et des cultures de par le monde. Les personnalités et des endroits du monde (l’Orient, l’Occident l’Afrique, Chine et USA) désignés à partir des noms des célébrités, des pays et villes du monde symbolisent des idéologies, des philosophies, des civilisations et cultures. Les techniques stylistiques précitées ont permis de circonscrire des espaces géographique et historique dont l’étude dans cet article est heuristique. Toutes les techniques stylistiques offrent des opportunités de réflexion dont le dénominateur commun est l’espace, en référence à l’Espace littéraire de Maurice Blanchot.
1.1. Espace et exotisme
L’approche géopoétique appliquée à notre corpus résulte essentiellement de la consultation et de l’appropriation des travaux de trois auteurs[6] portant sur le traitement de l’espace dans les œuvres littéraires. La notion d’espace comme champ d’investigation scientifique en littérature, trouve ses racines dans les années 1990 à travers les écrits de Maurice Blanchot. Le terme géopoétique est un néologisme inventé par Kenneth White. Elle est devenue un vaste champ interdisciplinaire de recherche à la suite de Bertrand Westphal, et les études littéraires ne sont pas en reste. C’est ainsi que Michel Collot (2014 ) énonce comme concept la géographie littéraire et la subdivise en deux autres concepts : la géographie de la littérature qui étudie le contexte spatial dans lequel est produit l’œuvre (lieux ou endroits visités où l’écrivain a vécu et qui ont suscité la rédaction de l’œuvre) et la géographie dans la littérature qui analyse les référents géographiques réels ou imaginaires auxquels renvoie l’œuvre.
À cet effet, Michel Collot attribue même l’origine du concept géopoétique en littérature, plus précisément en poésie, au poète Michel Deguy qui lie, de façon indissociable, « ce dont lepoème est l’expérience » et le langage de cette expérience (Collot 109). C’est pour cela que notre approche géopoétique s’intéresse à l’étude de l’espace, des lieux, des endroits et de leurs cultures, inscrits dans les poèmes des deux auteurs. Le concept géopoétique constitue alors, pour nous, un outil pour comparer Les Orientales de Victor Hugo et l’œuvre poétique de Kouctoukalo Tchassim.
Au XIXe siècle, nombreux sont des écrivains qui ont évoqué l’Orient dans leurs écrits sans l’avoir exploré ; tel est le cas de Victor Hugo. Pour une raison de satisfaction du besoin exotique, Victor Hugo se tourne vers l’Orient qu’il n’a jamais connu dans la réalité. Quant à Koutchoukalo Tchassim, elle a voyagé plusieurs fois en Chine: «ville montagneuse, Chongquing», «Beijing 12933 » «Sur le bateau Manjianhong, mon âme/Par le génie orientalemportée/Dans un songe soudain suffoqué/Pour pareils richesses sans monnaies et perles/Au pays de l’oncle Soleil.»(Tchassim 14 ; 19 ; 21). En s’appuyant sur Michel Collot) qui considère la géopoétique comme « une science étudiant les rapports entre l’espace et les formes/genres littéraires tout en articulant une “poétique” », « une étude des formes littéraires qui façonnent l’image des lieux», et « une “poïétique”, réflexion sur les liens qui unissent la création littéraire à l’espace», nous combinons l’approche géopoétique et l’approche sémiotique pour établir un lien entre les deux auteurs. Ces deux approches posent la problématique de la désignation de l’espace dans les œuvres de notre corpus où il s’agit de faire l’économie de mots : Victor Hugo et Koutcoukalo Tchassim ont désigné des endroits, des lieux, des régions du monde, des célébrités pour exprimer le dialogue des civilisations et des cultures à travers des symboles.
1.2. Des symboles aux civilisations croisées
En considérant la parole poétique de Koutchoukalo Tchassim contenue dans les trois recueils de poèmes, Les Plaies (2016), Je ne suis pas que négatif (2017) et Elle (2019), on découvre qu’elle embrasse toutes les zones culturelles du monde par la technique de désignation. Pendant ce temps, l’œuvre de Victor Hugo fait dialoguer l’Occident et l’Orient. Pour mieux comprendre la technique de désignation, nous distinguons, à partir des travaux de Charles W. Morris, trois aspects ou dimensions d’un signe que nous considérons ici comme symbole[7].
L’aspectpragmatique favorise, dans notre développement, l’interprétation en contexte des mots-symboles qui désignent des philosophies, des idéologies, des immortels (des célébrités), des pays, des villes, des périodes de l’histoire universelle que nous avons considérés comme des espaces référentiels ayant abrité et codifié des cultures. Dès lors, nous distinguons le lieu, comme «partie déterminée de l’espace» (Larousse de poche 472), de l’espace comme « étendue indéfinie qui contient tous les objets et étendue de l’univers hors de l’atmosphère terrestre » (Ibid.).
D’une part, le lieu se présente comme une dimension concrète de l’espace, l’espace étant pris dans sa dimension abstraite et illimitée. En conséquence, chez Koutchoukalo Tchassim, les lieux sont des pays et des villes du monde désignés: « Irak, Egypte, Ethiopie Somalie, Libye/ Le jardin d’Eden naturellement étendu /Sans racisme ni dégueulis prétendus » (Tchassim, p.68). Nous avons aussi désigné comme lieux des personnalités d’identités diverses: artistes, philosophes, écrivains religieux et spiritualistes qui ont marqué leur période en des lieux ou endroits du monde :
Mourir et vivre comme Martin Luther King Nelson Mandela /
Mourir et vivre en guide spirituel Gandhi Karamchand Mohandas/
Mourir et vivre en holocauste convaincu du sacrifice vrai mandat/
Jeanne d’Arc «La Pucelle d’Orléans sur le bucher morte en ana/
Mourir et vivre en héros solitaire comme Patrice Emery Lumumba/
Je veux mourir et vivre comme Jawaharla Nerhu le flambeau para (Elle, p. 62)
Aussi avons-nous, par analogie, supposé que durant leur existence individuelle, ces personnalités ont façonné la conscience de leurs contemporains et érigé, par endroits, des idéologies du quotidien (M. Bakhtine: 1977). D’autre part, le lieu, dans les vers, est aussi le terme ou le mot dans son sens dénotatif (le lieu), mais s’étend à une dimension polysémique (l’espace). Cette appréciation implique que les mots désignés peuvent avoir autant de sens par rapport à la compétence culturelle du lecteur, en dehors du sens référentiel concret dans le poème. Cela sous-entend que dans les œuvres de notre corpus, les mots désignant des endroits ou des lieux sont des symboles qui ont un sens polysémique en procédant par la métonymie, du particulier au général.
En somme, à partir des trois approches, il s’est agi de construire un cadre d’acte de lecture pragmatique selon l’orientation de Charles W. Morris. La caractéristique de cette approche est la dimension géographique de la lecture, le fait que nous avons abordé les textes à partir d’un ancrage singulier, celui d’un rapport aux endroits, aux lieux et au monde représentés, à la langue et à la culture qui lient lesdeux auteurs, même s’ils sont originaires des zones géographiques différentes. L’intérêt réside dans le projet d’aborder la problématique du dialogue des cultures. Les trois approches combinées constituent le cadre méthodologique qui a permis de dévoiler les subtilités de l’œuvre poétique des deux auteurs.
2. La mosaïque des endroits et des lieux
Le mot mosaïque est utilisé ici dans le sens de variété ; les différentes manières de configurer les endroits et les lieux reflets des formes de civilisations et cultures. Il s’agit surtout de l’usage du matériel linguistique par métonymie, métaphore et images en général. Victor Hugo fignole les vers en les marquant avec des rimes alternées (aa, bb) et par endroits des rimes embrassées (abba). En prenant uniquement la disposition des rimes, on peut dire que Victor Hugo a, dans ce recueil de poèmes de sa jeunesse, son projet d’auteur, rapproché les peuples, les civilisations et les cultures. Il y est mis en lumière la thématique de l’exotisme, la découverte d’autres réalités que celles de sa culture et civilisation. Chez Koutchoukalo Tchassim, elle a pris appui sur l’idéologie de la mondialisation où aucun endroit du monde n’est plus enclavé. À travers les technologies de l’information et de la communication, tous les endroits du monde sont aisément montrés ; on est loin de l’époque de Victor Hugo et la description des endroits et des lieux qui portent des cultures représentées est fonction d’un écart historique.
2.1. Mode de configuration des lieux
Charles W. Morris appelle désignationce à quoi le signe ou le symbole se réfère. Par ce mécanisme, les endroits et les lieux sont constitués, par désignation, d’abord, des noms propres de personnalités influentes dans l’histoire, ensuite, des noms de ville, de pays et, en fin, des faits et événements comme nous l’avons signalé en amont. Les signes étant empreints de symboles, il est pertinent de les ordonner dans le cadre de notre analyse. Ainsi les lieux sont-ils, d’abord, des pays, des villes, des endroits du monde, ensuite, des philosophies, des idéologies, des faits et événements, enfin, des noms d’écrivains, de philosophes, d’artistes et de politiciens. En termes d’illustration, nous relevons :
Irak, Somalie, Soudan, Afghannistan
Kossovo nord, Kossovo Sud convalescents
Des morts à bave sans mors incandescents
Des vivants ambulants prisonniers et apatrides
Des squelettes en vie sans vie triomphante
Lire et vivre la mort sans entremetteur
Compter ses deux cent six os sans clameur
Sous les obus faméliques des ustensiles creuses
D’une guerre insensée interminable et vaniteuse.
Ni basanée ni sombre n’est la barbarie
Libye, Irak, Afghanistan, Syrie ….
(Je ne suis pas que négatif, « La barbarie »76)
Empires, Royaumes, Tribus
Grand’ ouverts sur mes muscles tendus
Gbéhanzin, Guézo, Samory Touré
Askia Mohamed, Osséi Tutu
Chaka, Sony Ali Bert, Reine Pokou
(Les Plaies, ‟Mon Royaume” 29)
Dans le poème «La barbarie» la désignation de ces pays énonce deux idées :
– la première est relative aux lieux de guerre où l’Autre est considéré comme une bête qu’on assomme ; cela suggère la barbarie, l’expression de la jungle ;
– la seconde renvoie aux lieux qui rassemblent des populations Arabo-Berbères dont la vision du monde est façonnée par l’idéologie religieuse musulmane.
Enfin, ce sont des endroits en crise des valeurs humaines que dénonce Koutchoukalo Tchassim. L’ambition de l’auteure est de promouvoir l’instinct de vie contre celui de mort relaté dans les extraits suivants : « Et je pousse, je pousse, et je pousse, je pousse fort et plus fort. / Je veux une progéniture, une progéniture féconde sans renfort/Virile, à bousculer, défendre, arracher sauvagement mes droits» (Tchassim 26). Après la dénonciation de la guerre et ses ravages, de la violence en général, l’auteure procède à la revendication des droits humains. De même, Victor Hugo, dans certains poèmes de Les Orientales dénonce certains faits réels et politiques de son temps. Dans ce recueil de poèmes, treize sur quarante-et-un sont consacrés à la guerre entre les Grecs et les Turcs. Les poèmes les plus célèbres du recueil, « Les Têtes du sérail » (III), « Navarin » (V), « L’Enfant » (XVIII), présentent un paysage de violence et de guerre. Particulièrement dans le poème « L’Enfant », Victor Hugo montre les ravages que les Turcs ont infligés à la Grèce. Il y évoque à propos de la Grèce, le souvenir d’une île grande et riche où l’on trouvait « de nombreux palais ». Ce poème évoque le désir de ressusciter le passé de cette île. « La ruine et le deuil » ont pris la place de « la beauté flamboyante ». Il en résulte que la littéraire, et la poésie en particulier, a pour mission non seulement de célébrer la vie à travers les belles formes, mais essentiellement de l’engendrer dans des espaces intérieurs appauvris par le désarroi, la violence, l’ignorance, la peur d’oser, l’immobilisme. Tout part de l’espace intérieur de l’homme. L’ambition du poète est d’instaurer l’espérance. Ainsi, dans le poème qui suit, les noms désignés des différentes personnalités énoncent des philosophies, des idéologies qui suggèrent des instances ou des modèles de vie à imiter :
Ce poème instaure un lieu de philosophie de la non-violence, par le truchement de la spiritualité fondée sur le sacrifice suprême de soi en vue d’instaurer un cadre de bonheur collectif La philosophie pragmatiste de la non-violence a engendré, en matière d’influence sociétale, la théorie et la pratique de la communication non violente (CNV). Cet espace de CNV regroupe d’éminents praticiens de la communication sociale. Dans la deuxième strophe, les noms suggèrent successivement l’humanisme (Léopold Sédar Senghor, Jean de La Fontaine, Albert Camus et Aimé Césaire) et le travail d’individuation ou encore l’instauration du champ degrand travail[8], pour promouvoir la vie communautaire (Victor Hugo). Où pouvons-nous situer l’Orient dans Les Orientales? Est-ce un réalismeou une vérité ? Dans les faits Victor Hugo semble atteindre très tôt l’unité de son être de poète puisque, d’abord, Les Orientales paraissaient en janvier 1829. Ensuite, la description de l’Orient correspond à la mise en place de deux concepts de Carl Gustave Jung, dans la perspective de la psychologie analytique, anima et animus, la charge féminine et masculine qui sommeillent en chaque être humain ; dans ce cas précis l’Occident est animus et l’Orient anima. Car chez Victor Hugo en ce moment-là l’Orient c’est l’Autre, une certaine ipséité selon Paul Ricœur[9]. La représentation de l’Orient est floue. Ainsi Victor Hugo à travers Les orientales sensibilise le lecteur sur des rapports anciens, intimes, complexes, que l’Europe occidentale entretient avec l’Orient et l’Afrique méditerranéens: « Au Nil je le retrouve encore/L’Égypte resplendit des feux de son aurore […] Les vieux scheiks vénéraient l’émir jeune et prudent/La tente de l’Arabe est pleine de sa gloire. » (« Lui » XL) Enfin, Les orientales constituent la quête de l’Autre ou mieux le dialogue avec l’autre comme gage de richesse culturelle. Eu égard à tout ce qui précède quant à Les Orientales de Victor Hugo et à le langage poétique de Koutchoukalo Tchassim, nous pouvons affirmer que le langage poétique des deux auteurs suggère une culturanalyse[10], la présentation ou description de l’espace, une sorte de poésie de spatialité.
2.2. Une poésie de spatialité
La spatialité, ce qui est dans l’espace ou s’y organise; c’est alorsl’expérience de l’espace et de la condition spatiale de l’existence. La parole poétique des deux auteurs constitue tout: elle couvre toutes les dimensions de l’existence humaine sur la terre et au-delà, par le fait que les deux auteurs ont su aborder les préoccupations de leur temps. Horace ne disait-il pas « ut pictura poesis ». En conséquence, à travers leur parole poétique, nous pouvons affirmer que la poésie, une expression humaine, se donne le pouvoir qui lui permet de transcender notre monde étriqué et d’exprimer l’ineffable en dehors de ce qui nous entoure.
La spatialité est circonscrite dans la forme du corpus : les images, les mots utilisés, la syntaxe et surtout dans la désignation des noms de ville, de pays, de personnalités ont permis de décrire des endroits, des lieux dans l’histoire. Si chez Victor Hugo sa géographie littéraire, pour une raison donnée, s’est limitée à l’Orient et à l’Afrique méditerranéens, pour Koutchoukalo Tchassim elle s’est étendue à toutes les zones culturelles par désignation métonymique. La désignation des noms de ville, de pays et de personnalités influentes qu’on pourrait appelés des immortels, artistes, écrivains, politiciens, et spiritualistes, a permis à l’auteure de faire d’économie de mots. L’auteur a voulu tout dire, mais en peu de mot ; une sorte de litote implicite qui, en réalité, est, aussi et fondamentalement, une métonymie en considérant l’axe paradigmatique. Et ceci s’est réalisé par le choix de substantifs, des noms propres et communs qui appartiennent à des civilisation et cultures précises. La mise en page des poèmes est soumise à un travail de fragmentation de juxtaposition inattendues comparables à celles qu’on rencontre dans la poésie contemporaine où la continuité typographique masque le plus souvent les discontinuités sémantiques et syntaxiques. Les blancs et les alinéas remplacent la ponctuation graphique.
La poéticité des vers libres est d’autant plus marquée quand il s’agit des métaphores ; en exemple de deux titres de poèmes avec quelque vers chacun : le premier poème intitulé « Mon temple naturel » avec les quatre premier vers qui suivent : « Le menu de ma tente naturellement onctueux, riche et embelli /Aiguiser l’appétit de grands dévoreurs de ma peau verdie /Misérablement dénuder, éroder ma charpente/Mes fondements saccagés, ruinés. » (Tchassim 72), le groupe de mots « Mon temple naturel » désigne à la fois la matrice féminine, la mère et l’Afrique mère. Du coup le tout premier vers se comprend aisément, en conséquence, le mot « dévoreurs et « fondements » signifient respectivement les colons et les richesses minières du sous-sol africain. Le deuxième titre est « L’arc-en-ciel » et le premier vers est « Arc-en-ciel je suis, je demeurerai arc-en-ciel » (Tchassim 18) ; cette métaphore exprime à la fois le métissage culturel et le désir profond de l’auteure de n’appartenir à aucune race mais à toutes les races.
Ces métaphores sont renforcées par des recherches de rythme et de sonorité finale semblable à ceux de slam ; en voici un exemple dans le poème « La précieuse », « Elle n’est pas vile / Elle est précieuse /Elle n’est pas rugueuse/Elle est moelleuse/Elle n’est pas acre/Elle est suave… » (Tchassim55). L’auteure déshabille la langue française et lui faire porter des habits des langues africaines qui fonctionnent par images.
En définitive, les lieux sont des endroits construits dans l’espace, des cadres de l’expérience humaine. Le caractère mosaïque de cette composition résulte de ce que nous pouvons appeler le projet de société que Koutchoukalo Tchassim et Victor Hugo veulent promouvoir et instaurer : une société arc-en-ciel (Tchassim 18-19). Cette expression est chère à Koutcoukalo Tchassim par la récurrence du mot « arc-en-ciel » dans les trois recueils de poèmes. Quant à Victor Hugo, son Orient est une région imaginée :
La sultane regarde, et la mer qui se brise,
Là-bas, d’un flot d’argent brode les noirs îlots.
[..] Se mouvoir dans leurs flancs comme une forme humaine…
La lune était sereine et jouait sur les flots.
« La lune », Les orientales.
Nous l’avons déjà suggéré, la poésie est description ; elle utilise des couleurs, des formes et des sons. Ainsi, les couleurs orientales sont venues à Victor Hugo comme des pensées et rêveries; elles l’ont emporté dans des couleurs hébraïques, turques, grecques, persanes, arabes, espagnoles et son Orient c’est l’Espagne. Consécutivement, l’Espagne est proche de l’Afrique, l’Afrique est proche de l’Asie.
3. Poésie cosmique et militante
Cette rubrique nous permet de qualifier l’écriture des deux auteurs d’épique. Elle l’est d’un côté, en considérant la période de publication du recueil Les orientales (1829) de Victor Hugo la thématique et la révolution au niveau de la forme et de l’envergure de la thématique et, de l’autre avec Koutchoukalo Tchassim, une écriture à rythme chevaleresque, une écriture caustique par des mots à forte résonnance vis-à-vis de la déchéance de l’homme postmoderne. Ainsi, ce qui les unit est le militantisme au service d’une nouvelle forme d’humanisme fondée sur la sensibilisation ou la promotion des valeurs cardinales de la vie dont la base est l’ouverture à l’autre : le dialogue. L’intensité de cet élan chez Koutchoukalo Tchassim a eu une influence considérable sur la forme de son langage poétique. En conséquence, les deux auteurs par leurs œuvres favorisent le dialogue entre les cultures : poésie cosmique et militante.
3.1. La poésie cosmique
La poésie cosmique repose, dans cet article, sur la poésie épique. L’écriture épique, elle se réfère à des éléments fondamentaux du monde, utilisés dans des comparaisons, métaphore et amplification touchant l’eau le feu l’air et la terre. Les occurrences de ces éléments sont nombreuses chez les deux auteurs. D’abord les quatre groupes fondamentaux d’éléments sont évoqués d’une manière subtile. La Terre est respectivement désignée par les monts « ville montagneuse Chongqing» (Tchassim14). L’eau, le vent et le feu sont évoqués par un champ lexical exubérant dans les trois recueils de poèmes de Koutchoukalo Tchassim. On les retrouve aussi chez Victor Hugo dans le paysage représenté dans « Extase » (XXXVII) :
J’étais seul près des flots, par une nuit d’étoiles.
Pas un nuage au ciel ; sur les mers pas de voiles.
Mes yeux plongeaient plus loin que le monde réel.
Et les bois, les monts, et toute la nature,
Semblaient interroger dans un confus murmure
Les flots des mers, les feux du ciel.
Après avoir célébré les grandes figures de l’histoire littéraire française du seizième et dix- septième siècle, Koutchoukalo Tchassim est passée par un assassinat symbolique pour faire dialoguer la culture littéraire française avec celle africaine pour se retrouver tout simplement dans la francophonie :
J’assassine Montaigne
Je maudis Rabelais
Je piétine Molière
…Mon indépendance langagière exprimée
Les plaies (51).
Le caractère épique de la poésie de l’auteur se lit notamment à travers la convocation des noms de célébrités d’autres domaines de la vie en dehors de la littérature. Il y a aussi la dérivation lexicale des adjectifs. Ainsi, pour marquer son désir de conquérir l’espace de la langue de communication, l’auteur passe par la composition de façon inattendue des adverbes que voici : « Des sangsues extravagamment survitaminées / Sur le dos de ma misère de franc / […] / Une colonisation incommensurablement implantée / […]/ En faire déshonorablement un nègre en course/ » (Tchassim 35) ; et d’autres encore : « Ma grand-mère mélancoliquement retenue/ Des manipulations rageusement orchestrées et convenues […]/Goulûment constiper égoïstement leurs parois » (Tchassim 37). De manière implicite elle érige une autre forme de collaboration sociétale. S’agit-il d’une nouvelle forme d’humanisme ? Nous ne saurions le dire. De toutes les façons, aucune région, aucune idéologie, aucune zone de culture n’est laissée intouchée par la verve poétique de l’auteurepar la technique dedésignation. À travers le poème « Danube en colère » (XXXV) qui est une prosopopée, Victor Hugo, pour sa part, dénonce la manière dont les religions révélées, en l’occurrence le Christianisme et l’Islam, de manière dogmatique s’approprient de la justice universelle qui, normalement, n’est ni d’Occident ni d’Orient :
Une croix, un croissant fragile,
Changent en enfer ce beau lieu.
Vous échangez la bombe agile
Pour le koran et l’évangile?
« Danube en colère », Les orientales.
Enfin, concernant de la thématique, on assiste à des réseaux concentriques de thèmes. De nouveaux thèmes comme ceux de l’immigration et de la déchéance spectaculaire de l’homme sans distinction de race, de religion, d’idéologie et de culture caractérisent plus particulièrement la poésie de Koutchoukalo Tchassim sous un aspect antiphrasique comme moyen de sensibilisation.
3.2. Une poésie militante
En quoi la poésie des deux auteurs est-elle militante ? C’est d’une part, chez Koutchoukalo Tchassim par la poésie iconoclaste de défense des valeurs cardinales de l’existence humaine, de célébration de la richesse du cosmos , de dénonciation des incongruités de certaines pratiques africaines supposées être des valeurs culturelles, mais qui n’en sont pas , d’autre part Victor Hugo par la destruction des frontières artificielles entre l’Occident et l’Orient. À la place, il instaure une altérité, altérité que le poète vit à travers le poème « Extase ». Il y a une certaine cohérence entre les poèmes du recueil qui prouve le militantisme de Victor Hugo. En effet, il est à constater que le « je » dans le poème « Extase » est un « je » à la fois « je » et « l’autre »: la communication entre le poète et le monde qui l’entoure; le poète Victor Hugo étend à l’infini cet environnement, c’est-à-dire l’inspiration du poète dépasse le paysage auquel il pense et sonde l’univers visible et invisible :
J’étais seul près des flots, par une nuit d’étoiles.
Pas un nuage, aux cieux, sur les mers pas de voiles.
Mes yeux plongeaient plus loin que le monde réel.
Et les bois, et les monts, et toute la nature,
Semblaient interroger dans un confus murmure
Les flots des mers, les feux du ciel.
« Extase », Les orientales
Cet élan répond aux impératifs du romantisme : découvrir d’autres réalités de l’existence humaine par le truchement de la sensibilité et de l’imagination que de s’enfermer dans la tour de la raison qui façonnait les idéologies depuis le dix-septième siècle. Victor Hugo est le pionnier et d’ailleurs le chef de file du mouvement romantique. Le poème ‘’Mazeppa’’ vient amplifier le caractère épique de son élan :
Ainsi, quand Mazeppa, qui rugit et qui pleure,
A vu ses bras, ses pieds, ses flancs qu’un sabre effleure,
Tous ses membres liés
Sur un fougueux cheval, nourri d’herbes marines,
Qui fume, et fait jaillir le feu de ses narines
Et le feu de ses pieds ;
Quand il s’est dans ses nœuds roulé comme un reptile,
Qu’il a bien réjoui de sa rage inutile
Ses bourreaux tout joyeux,
Et qu’il retombe enfin sur la croupe farouche,
La sueur sur le front, l’écume dans la bouche,
Et du sang dans les yeux, »
« Mazeppa XXXIV » Les orientales
En effet, il s’agit dans ce poème d’une allégorie désignant le poète nomade conquérant l’espace en luttant dans la contrariété, l’incompréhension comme chez Charles Baudelaire ‘Albatros’. Dans cette allégorie, le pouvoir du poète est mis en relief ; du sens le plus simple au sens le plus complexe on peut dire que le lecteur assiste à une triple conquête de l’auteur : conquête de l’espace environnementale, de l’espace textuel et de l’espace de la langue française ; pour ce dernier type d’espace ; comme on le remarque aussi chez Koutchoukalo Tchassim qui, conduite sur son cheval, la muse, elle plie l’espace du langage poétique à son désir de conquérante. Les deux auteurs se retrouvent dans les vers suivants de Victor Hugo:
Et l’homme et le cheval, emportés, hors d’haleine, […]
Volent avec les vents ![…]
Ils vont l’espace est grand.
Dans le désert immense,
Dans l’horizon sans fin qui toujours recommence,
Ils se plongent tous deux.
Leur course comme un vol les emporte, et grands chênes,
Villes et tours, monts noirs liés en longues chaînes,
Tout chancelle autour d’eux.
Et si l’infortuné, dont la tête se brise,
Se débat, le cheval qui devance la brise,
D’un bond plus effrayé,
S’enfonce au désert vaste, aride, infranchissable [.]
Mazeppa XXXIV, Les orientales
Cette exploration n’a qu’un seul but: atteindre l’autre, communiquer avec l’autre en détruisant les barrières artificielles de l’histoire, de la géographie des civilisations des cultures, de l’idéologie et de la langue. C’est pour cela que du côté de Koutchoukalo Tchassim on ne peut pas parler de poésie engagée. La notion de littérature engagée comme courant littéraire a fait son temps. Le langage poétique de Koutchoukalo Tchassim est, d’abord, militante par le mode de tissage des réseaux de thèmes qui parsèment les trois recueils de poèmes, ensuite, par la forme des vers, enfin, par le choix du lexique. Ceci se remarque à travers l’énonciation. Tous les thèmes anciens sont traités et les nouveaux thèmes générés par la mondialisation, l’idéologie du genre, le capitalisme outrancier, la sexualité dévergondée, la dégradation de l’environnement, l’exercice du pouvoir social, politique et économique sous le diktat du capitalisme outrancier: l’homme est devenu un produit marchant.
Conclusion
En somme, Koutchoukalo Tchassim n’est pas le premier poète qui s’est profondément inspiré des mœurs de son temps pour construire son langage poétique. Mais l’auteur en a fait plus en embrassant dans sa totalité, l’existence humaine dans sa complexité inouïe. C’est ce qui explique son voyage dans l’espace de différentes manières. Les approches géopoétique et sémiotique dans une perspective comparatiste nous a essentiellement permis de cerner le langage poétique des deux auteurs. L’analyse est essentiellement focalisée sur les indices textuels qui suggèrent l’exotisme des deux auteurs. Comparer Koutchoukalo Tchassim au monument de la poésie romantique française Victor Hugo est une occasion d’évaluer sa production poétique à cette étape de son parcours d’auteure. Les deux, à travers la représentation de l’espace ont la même ambition : promouvoir homo maximus, le grand moi. De plus Koutchoukalo Tchassim a subtilement créé un mariage entre la poésie dans sa forme originelle en tant que chant et le slam un genre nouveau proche de la poésie moderne. Ce caractère composite de la parole poétique de l’auteur fait de son œuvre un drame épique dont la substance est incrustée dans les signifiants devenus symboles ; le tout donne l’aspect d’un jeu dramatique et tragique. Il s’agit d’un tragique social et des mœurs. L’auteure en a donné le ton à travers l’usage des mots symboles auxquels elle a fait subir une métamorphose dans leurs aspects de signifiant et de signifié de deux ou trois manières : changement de classe grammaticale aux mots, une formation sauvage des adverbes, c’est-à-dire de manière inattendue et les verbes sont plus à l’infinitif que conjugués. C’est un style poétique mosaïque qui correspond au mobile de la naissance d’un poème, selon l’affirmation de Denis Diderot que nous adaptons à ce contexte: « La poésie veut quelque chose d’énorme, de barbare et de sauvage. C’est lorsque la fureur (folie) de la guerre civile ou du fanatisme arme les hommes de poignards, et que le sang coule à grands flots sur la terre, que le laurier d’Apollon s’agite et verdit.» (De la poésie dramatique, chap18 : des mœurs.)
En somme, le langage poétique de l’auteur résulte du reflet brisé des mœurs de notre temps. Désir d’évasion et réalité idéalisée, tels qu’on les trouve chez Victor Hugo. Sur cet aspect Koutchoukalo Tchassim en a fait plus que cela : son écriture procède d’une atopie, un espace dégagé des codes, proche de la réalité.
Travaux cités
Benac, Henri. Guide des idées littéraires, Paris, Hachette Education, 1988..
Bigeard, Stéphane https://www.institut.geopoetique.org./fr/dictionnaire
Bouloumié, Arlette, Trivisani-Moreau Isabelle, Le génie du lieu, des paysages en littérature, Paris, Editions Imago, 2005.
Canetti, Eliias. La conscience des mots, Paris, Albin Michel, 1984.
Bisenius-Penin, Carole. Création littéraire en résidence : une approche géopoétique et géoculturelle de l’espace, Colloque international. Espaces littéraires et Territoires critiques. Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal); Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa (Portugal), Jun 2017, Porto, Portugal. p. 45-65, ⟨10.21747/21832242/litcomp38a3⟩ consulté le 28/11/2021
Collot, Michel. Pour une géographie littéraire, Paris, José Corti 2014, 2014. p. 280
……« La spatialité littéraire au prisme de la géographie » dans L’Espace géographique 2016/4.Tome 45 | p. 289-294, consulté le 28/11/2021
Joubert, Jean-Loius. La poésie, Paris, Armand Colin, 2003.
Hugo, Victor. Les Orientales, 1829. http://fr.wikisource.org consulté le 03/03/2021 à16h16
Tchassim, Koutchoukalo. Elle, Lomé, Editions Continents, 2019.
…….Je ne suis pas que négatif, Lomé, Editions Continents, 2017.
……Les plaies, Lomé Editions Awoudy, 2016.
Westphal, Bertrand. “Lecture des espaces en mouvement : géocritique et cartographie”, Études de lettres, 1-2, 2013. [http://edl.revues.org/478 ; DOI : 10.4000/edl.478] consulté le 28/11/2021
Comment citer cet article :
MLA : Nouvlo, Koffi Dodzi et Piyabalo Nabede. « Poétique et exotisme chez Victor Hugo et Koutchoukalo Tchassim ». Uirtus 1.2. (décembre 2021): 208-226.
§ Université de Lomé / [email protected]
[1] “La géopoétique est une théorie-pratique transdisciplinaire applicable à tous les domaines de la vie et de la recherche, qui a pour but de rétablir et d’enrichir le rapport Homme-Terre depuis longtemps rompu, avec les conséquences que l’on sait sur les plans écologique, psychologique et intellectuel, développant ainsi de nouvelles perspectives existentielles dans un monde refondé”, (site www.kennethwhite.org).
[2] Interculturalité mais l’accent est mis sur les endroits au monde qui portent les cultures peintes.
[3] “Geopoetics is a transdisciplinary theory-practice applicable to all the domains of life and research. Its aim is to re-establish and enrich the Humanity-Earth relationship long since deteriorated when not totally destroyed, with consequences now well documented on the ecological, psychological and intellectual plane. Geopoetics presents new existential perspectives in an open world.” (www.kennethwhite.org)
[4] Interculturality but the focus is on places in the world that carry painted cultures
[5] Ce mot a un sens particulier dans cette étude ; ce sens provient de cette anecdote : vers la fin du 19e siècle la civilisation occidentale connaissait une grande crise, une esquisse d’une nouvelle cartographie mentale s’ébauchait et le poète Arthur Rimbaud s’écriait « Beaucoup d’écrivains peu d’auteurs » ; il employait le mot auteur au sens fort qui dérive du latin augere auctum (augmenter) augmenter la sensation de vie, la compréhension des choses, l’appréhension du cosmos.
[6] Carole Bisenius-Penin Création littéraire en résidence: une approche géopoétique et géoculturelle de l’espace. Carole Bisenius-Penin est Maître de conférences de Littérature Contemporaine à l’Université de Lorraine, elle est devenue depuis le 31 décembre 2020, chevalier dans l’ordre des arts et des lettres.
Marta Baravalle, Michel Collot, Pour une géographie littéraire, Corti, Paris, 2014, p. 280.
[7] Pour rappel, il faut noter ; d’abord, l’aspect syntaxique qui porte sur les relations des symboles entre eux, les règles de combinaison légitimes donnant lieu à la construction de la syntaxe; ensuite, l’aspect sémantique porte sur les relations entre les symboles et les objets auxquels ils s’appliquent il l’appelle la désignation ; et enfin, l’aspect pragmatique qui porte sur les relations de l’utilisation et de la fonction affective des symboles sur le lecteur :elle dérive de la relation que nous avons entretenue avec les symboles.
[8] Ce que j’entends par « grand travail » ? D’abord, la continuation de la « culturanalyse. Ensuite, les efforts à fournir pour arriver à un « champ » au-delà des cloisons qui se sont établies entre la poésie, la pensée et la science. Et puis encore, à l’intérieur de ce champ, ce qu’il faut faire pour arriver à l’expression de ce que la tradition chinoise a appelé ta wo (le grand moi, tout le contraire du petit ego mégalomane) et de ce que la tradition occidentale appelle homo maximus“, Dictionnaire de géopoétique.
[9] Ricœur Paul, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990
[10] Culturanalyse : analyse culturelle radicale et profonde