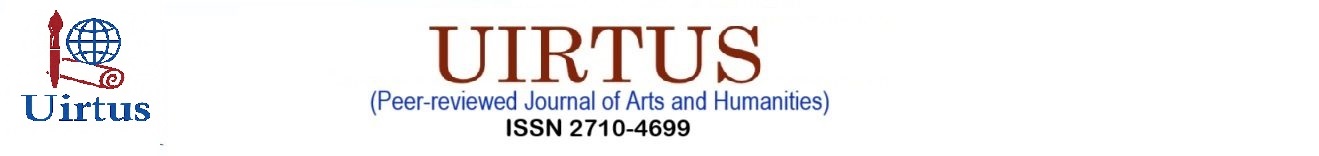Résumé : Les années 2020-2021 ont marqué et continuent de marquer les esprits par la surprenante crise sanitaire dont le monde entier ignore officiellement les causes. Scientifiquement appelé coronavirus par certains et Covid-19 par d’autres, la pandémie qui menace le monde a conduit la plupart des dirigeants politiques à déclarer que leur pays est en guerre contre un ennemi invisible. Depuis, les acteurs politiques du monde ne cessent de filer la rhétorique ou mieux la métaphore militaire pour justifier les mesures urgentes qu’ils prennent pour enrayer cette crise sanitaire. Le présent article a pour objectif de faire comprendre le sens de la notion de guerre sanitaire, la gestion militaire de la pandémie, les champs d’intervention des forces armées et de sécurité mobilisées dans le contexte de la crise sanitaire au Togo et la perception des civils de cette mission sécuritaire. L’approche qualitative mise à contribution a permis de faire ressortir l’usage de l’expression guerre sanitaire comme une rhétorique destinée à inciter le corps social à l’unicité d’action, interdisant donc le traitement démocratique de ce qui le divise pendant la crise. L’émanation en est l’invite à concentrer les efforts sur l’ennemi commun qui veut détruire les habituelles manières de vivre. La recherche est parvenue aux conclusions que si la mobilisation des forces armées a été salutaire pour faire respecter les mesures barrières édictées dans le cadre de l’état d’urgence décrété et, à apporter secours aux sinistrés, nombreuses ont été les violations des droits de l’homme observée par la population civile dont les auteurs sont les éléments de la FOSAP.
Mots clés : Crise sanitaire, Covid-19, Guerre sanitaire, FOSAP- Population civile.
Abstract: The years 2020-2021 have marked and continue to mark the spirits by the surprising health crisis of which the whole world is officially unaware of the causes. Scientifically referred to as coronavirus by some and Covid-19 by others, the pandemic threatening the world has led most political leaders to declare their country at war with an invisible enemy. Since then, political actors around the world have continued to use rhetoric or better still the military metaphor to justify the urgent measures they are taking to stem this health crisis. The objective of this article is to provide an understanding of the meaning of the concept of health warfare, the military management of the pandemic, the fields of intervention of the armed and security forces mobilized in the context of the health crisis in Togo and the perception of civilians of this security mission. The qualitative approach used made it possible to highlight the use of the expression health warfare as a rhetoric intended to incite the social body to uniqueness of action, thus prohibiting the democratic treatment of what divides it during the crisis period. The emanation invites him to concentrate efforts on the common enemy who wants to destroy the usual ways of living. The research came to the conclusions that while the mobilization of the armed forces was beneficial in enforcing the barrier measures enacted within the framework of the declared state of emergency and, in providing disaster relief, there were numerous violations of human rights observed by the civilian population whose authors are elements of FOSAP.
Keywords: Health crisis, Covid-19, Health War, FOSAP, Civilian Population.
Introduction
Depuis décembre 2019, le monde entier traverse une crise sanitaire la plus importante de ces trois dernières générations. A l’origine de cette crise sanitaire, un agent pathogène et contagieux appelé Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SARS-Cov-2), Covid-19 ou Coronavirus selon la communauté scientifique. Dans les milieux institutionnels et politiques, on parle plutôt de guerre sanitaire pour désigner la lutte contre la pandémie à coronavirus qui a pris au dépourvu tous les Etats du monde. Selon (Kacou et Iroco 361) :
En décembre 2019, Li Wenliang, un jeune médecin chinois, lança l’alerte de l’apparition en Chine d’un virus, qui sera plus tard communément dénommé « coronavirus » et covid-19 par la communauté scientifique. Les autorités chinoises indignées par son acte l’arrêtent pour « propagande de rumeurs ». Il mourra lui-même le 7 février 2020 atteint du coronavirus. Très vite, le virus s’étend en Chine, singulièrement à Wuhan, où la population entière est mise en quarantaine. Certains pays, conscients du mal, apportent des soutiens sanitaires à la Chine, d’autres, les plus nombreux, montrent des comportements d’indifférence par les feux d’artifice et d’autres encore se ferment en interdisant l’accès à leur territoire aux voyageurs venant de la Chine par peur d’être contaminés. Mais du fait des échanges et des mouvements démographiques, les uns et les autres vont être infectés durement par le virus.
A partir de ce moment, le virus envahit tous les continents et les morts par milliers se succèdent. Au premier trimestre de l’année 2020, on dénombrait déjà 2.235.934 personnes contaminées du virus aux Etats-Unis avec 20 250 morts. Le Brésil comptait 984.315 infectés avec 7 897 morts, la Russie enregistrait 569 063 patients du covid-19 avec 841 morts, le Royaume-Uni affichait 301 815 infectés avec 42 461 morts tandis que la Chine, le berceau du coronavirus totalisait 83 325 malades et 4 634 morts (European Centre for Disease Prevention and Control 9). Au Togo, le site gouvernemental (covid-19.gouv.tg) affiche 20178 cas de contaminé de covid-19 et 195 décès en 2020.
Le 16 mars 2020, face à la gravité de la maladie, le président de la République française, Emmanuel Macron, s’adresse à son peuple en véritable chef de guerre en ces termes : « Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée ni contre une autre nation, mais l’ennemi est là, invisible, insaisissable et qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale ». Aussi, lors de son déplacement dans la ville de Mulhouse, le Président Macron l’a répété encore plusieurs fois : « La France est en guerre contre le coronavirus et si c’est bien le personnel de santé qui est en première ligne, l’armée aussi peut apporter son aide » (Bissiriou 2).
Aux Etats-Unis, Donald Trump, qui avait initialement minimisé l’épidémie, a adopté, au fil de ses points de presse, un ton de plus en plus martial, en se présentant comme un Président « en temps de guerre face à un ennemi invisible » (AFP du 19 mars 2020).
Depuis, observateurs et politiques du monde entier ne cessent de filer la métaphore militaire : « guerre sanitaire », « conseil de guerre sanitaire », « bataille », « front », « couvre-feu », « tranchées », « Etat d’urgence », « bouclage des villes », « fermeture des frontières », « mobilisation générale » « lutte », « ennemi », « ligne de front ». Pour ces acteurs, le coronavirus s’est présenté en ennemi des nations en faisant des victimes par milliers, en sabotant les finances et en mettant à rude épreuve les relations humaines. En clair, la Covid-19 constitue une menace à la sécurité nationale (Milion) nécessitant le recours aux mesures guerrières.
C’est la raison pour laquelle, l’Espagne où la pandémie a pris des proportions inquiétantes, 2.622 militaires ont été déployé dans 59 villes pour veiller au respect des mesures de confinement, pour participer au désengorgement des structures sanitaires et pour assurer des opérations de désinfection des maisons de retraite, tribunaux, hôpitaux, stations de trains, ports et aéroports (Morel).
La France, de son côté, lance une opération militaire baptisée Résilience au cours de laquelle ses forces aériennes, terrestres et navales sont venues appuyer toute la gamme des réponses de la société civile face à la pandémie que ce soit en France métropolitaine ou partout ailleurs, dans les territoires et départements d’outre-mer, les Antilles et le Pacifique (Ministère des Armées, 2020). L’Allemagne déploie 15 000 soldats chargés d’assurer la protection de ses infrastructures critiques, de distribuer des fournitures médicales et d’installer des hôpitaux (Schmidt ; Braw). Les États-Unis déploient la Garde nationale en Californie, à New York et à Washington à l’appui de la logistique d’approvisionnement pour la lutte anti-covid et dépêche deux navires-hôpitaux vers New York et Los Angeles, afin de soulager la pression sur les hôpitaux locaux (The Economist ; Paris).
En Chine, l’Armée populaire de libération (APL) s’est vue confier, la mission de coordonner les interventions dans l’ensemble du pays et de mobiliser ses ressources pour assurer le contrôle des quarantaines, l’administration des hôpitaux et le transport de matériel à Wuhan, ville qui a vu l’apparition du premier cas de nouveau Coronavirus. En dehors de la Chine, de l’Australie à l’Inde, à travers toute l’Asie, les autorités politiques ont fait appel à leurs armées pour ralentir le coronavirus, alors qu’une seconde vague de contaminations a été enregistrée dans des régions qui pensaient l’épidémie être sous contrôle. Les interventions des forces armées italiennes, espagnoles, françaises, allemandes et américaines illustrent bien les tâches partagées avec le secteur civil que les militaires se voient confier dans le cadre des réponses nationales face à la pandémie de la Covid-19.
Au Togo, comme partout en Afrique, l’apparition du coronavirus a sonné le glas d’une ribambelle de mesures préventives contre une éventuelle explosion de contaminations telle que connue dans les pays « importateurs » de ce virus. Les mesures prises sont d’ordre économique, social, politique et sécuritaire. Elles se sont succédé pour empêcher le pays de vivre la catastrophe sanitaire que prévoyaient les pays occidentaux pour une Afrique démunie, mal équipée et mal organisée (OMS). Une force de sécurité anti-pandémique (FOSAP), une première depuis l’indépendance, a été mise sur pieds. Composée de 5 000 agents (ministère de la sécurité), issus de divers corps des forces de défense et de sécurité, la force de sécurité anti-pandémique coronavirus a principalement pour mission de veiller au respect de l’ensemble des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré dans l’ensemble du pays par les autorités politiques.
Au vu de cette mobilisation générale, peut-on considérer que le monde entier est en proie à une guerre ? La pandémie à coronavirus est-elle assimilable à une attaque sanitaire ? Quelle est la gestion militaire de la pandémie à coronavirus ? Quelles perceptions la population civile se fait de la pandémie et de sa gestion militaire ? Cette étude cherche à apporter des réponses à toutes ces interrogations.
La présente étude, de façon générale, vise d’abord, à apporter des éclaircissements sur l’emploi du concept guerre sanitaire par les décideurs politiques pour mobiliser les populations face à la pandémie à coronavirus. Ensuite, elle s’attelle à expliquer la gestion militaire de la pandémie ainsi que les champs d’interventions des forces de défense et de sécurité. Enfin, l’étude cherche à relayer les perceptions des civils de la gestion militaire du Covid-19 et les leçons à retenir dans l’amélioration des rapports sociaux entre les forces armées et les populations civiles.
1. Support théorique
Pour des fins heuristiques, l’analyse dans la présente étude est essentiellement faite sur la base de la théorie rhétorique des crises majeures (Reboul ; Gosselin) et de la théorie des circonstances exceptionnelles (Foulquier ; Robert). D’après Reboul,la rhétorique est un discours qui vise à influencer le comportement et les croyances des individus en utilisant des arguments aussi bien rationnels que non rationnels, tant logiques que non logiques. En se référant à ces auteurs et à leur théorie, la crise sanitaire a entrainé des prises de décisions tous azimuts : politique, économique, sécuritaire, culturelle, religieuse et sociale.
Les décrets, les déclarations, les appels et les autres résolutions dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire font tous allusion à des situations d’une extrême gravité, nécessitant non seulement une prise de conscience collective mais aussi une réaction prompte et efficace. C’est pourquoi, tous les textes adoptés et exécutés dans le cadre de cette crise sanitaire débutent par une série de constats, vrais pour certains et utopiques pour d’autres, justifiant les uns comme les autres, par des considérations extrêmes du moins dans la forme, les décisions prises. La théorie rhétorique des crises aide à juste titre à comprendre les mobiles de l’usage de la rhétorique comme stratégie de communication politique par la plupart des gouvernants pendant la pandémie à coronavirus dans le monde.
Quant à la théorie des circonstances exceptionnelles, elle postule que dans certaines conditions, de très graves urgences, politiques ou sociales, le pouvoir exécutif peut s’affranchir du respect intégral et pointilleux de la loi afin de préserver les services publics et les intérêts de la Nation (Foulquier). Dit autrement, les circonstances exceptionnelles sont une condition mais aussi une excuse pour appliquer un régime de légalité d’exception des actes administratifs. Ainsi, les actes administratifs en temps normal illégaux deviennent légaux en raison des circonstances exceptionnelles. Cette théorie permet de comprendre la portée des actes administratifs pris par les autorités politiques dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
2. Considération méthodologique
La démarche méthodologique adoptée dans le cadre de cette étude est d’ordre triangulaire, combinant la recherche documentaire, les entretiens individuels semi-directifs et l’observation directe. La recherche documentaire a permis de consulter les ouvrages et articles spécialisés, les résultats des recherches dans le domaine de la crise sanitaire, de participation citoyenne et la mobilisation militaire, les articles sur les stratégies de communication des acteurs politiques dans une situation de crise.
La documentation a consisté à consulter les publications officielles des dirigeants politiques, publics et scientifiques, la presse, les commentaires des organisations de défense des droits humains et ceux des citoyens sur la toile à partir de certaines plateformes WhatsApp notamment.
Cet inventaire documentaire est appuyé par une investigation empirique recourant à la fois à l’observation directe et aux entretiens individuels. Si l’observation a mis en évidence les interactions entre militaires et civils (Lofland ; Friedrich), (Ludtke), (Peretz) lors des patrouilles, des couvre-feux, des bouclages des villes et des fermetures de frontières terrestres, les entretiens ont, de leur côté, fait ressortir les perceptions des personnes ressources.
Les entretiens, à l’aide d’un guide d’entretien, ont été réalisés auprès de 45 personnes (5 membres de la coordination de la riposte sanitaire, 25 éléments de la FOSAP (dont 2 membres du commandement, 8 chefs d’unité, 15 exécutants c’est à-dire soldats, gendarmes et policiers). Outre ces groupes cibles, l’enquête a respectivement interviewé une personne ressource dans 5 différents organes de presse, 5 associations de défense des droits de l’homme et 5 acteurs de la société en général. Le protocole d’interview a tenu compte des thématiques de guerre sanitaire, d’état d’urgence, de la gestion militaire de la pandémie, de champ d’intervention des forces de défense et de sécurité dans la crise sanitaire et perception des acteurs civils vis-à-vis de la mission de la FOSAP.
Tous les enquêtés ont été tirés sur la base de la méthode non probabiliste (Fortin et al.) par choix raisonné, en tenant compte des personnes disposées à nous éclairer sur le fait social en étude. Le traitement manuel des données obtenues a consisté en une analyse qualitative de contenu (Mucchielli ; Bardin) des propos des personnes interrogées et à un croisement des différentes informations obtenues, afin de comprendre et de rendre compte du fait social étudié dans sa totalité. Les tendances dégagées des données qualitatives collectées sont restituées en verbatim au niveau des résultats ci-dessous.
3. Résultats
3.1. Compréhension sociologique de la notion de guerre et de guerre sanitaire
Depuis l’apparition de la pandémie à coronavirus, en Chine, en 2019, chercheurs, acteurs politiques et journalistes du monde, dans leurs analyses ou dans leurs déclarations sur la crise sanitaire que traverse le monde, ne voient qu’une guerre dirigée contre l’humanité. Les discours les plus alarmistes évoquent la thèse d’une « arme biologique » dont avait parlé, quelques années plutôt des chercheurs comme (Taguieff 21-30) et (Bellote). L’utilisation fréquente de la rhétorique militaire durant la crise sanitaire, les discours martiaux ou guerriers des dirigeants politiques, lors de leurs sorties médiatiques font penser à une alerte à l’humanité, menacée par un ennemi invisible et capable de frapper partout sur les continents sans jamais rencontrer une résistance. Il est même qualifié « d’ennemi universel de l’humanité» (Machrouh 3). Ces déclarations sonnent comme une alarme, le temps d’une prise de conscience générale. A en croire certains historiens militaires, le nombre de victime, causé par la pandémie à coronavirus n’est pas loin, de celle de la première guerre mondiale. C’est ce qui fait dire à Momokana que « la première et la deuxième guerre mondiale furent militaires. La 3e quant à elle est sanitaire [1]». Et selon le décompte effectué par l’AFPen date du 10 octobre 2021, sur un total de 200 millions d’infection liés au coronavirus, la pandémie a provoqué le décès de 4,5 millions de personnes à l’échelle de la planète. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) n’ayant pas encore déclaré la pandémie à coronavirus vaincue, ce bilan est loin d’être le définitif.
En effet, depuis le début des années 1990, plusieurs crises sanitaires majeures ont marqué les esprits et sont considérées par les polémologues comme des menaces à la sécurité des Etats. C’est l’exemple de HIV (SIDA), l’EBOLA (FHVE) et le H5H1 pour ne citer que celles-là. À la différence de la peste ou encore de la grippe espagnole du début du siècle dernier, ces crises se caractérisent par la réunion de trois éléments : une origine très incertaine au début, un retentissement médiatique sans précédent ensuite et une déstabilisation complète des systèmes institutionnels de gestion sanitaire enfin.
Aux Etats-Unis, la Stratégie de Sécurité Nationale de 2006 (NSS) après des recherches secrètes et minutieuses est parvenue à la conclusion selon laquelle les pandémies telles que le HIV (SIDA) et le H5N1 (grippe aviaire) ne reconnaissent pas les frontières et devaient provoquer de nouvelles réactions et doivent être traitées grâce à de nouvelles stratégies(ITES 8). C’est la raison pour laquelle la pandémie à coronavirus est considérée par les observateurs avisés comme « un virus militarisé » (Cantwel). Pour s’en convaincre, il importe d’éclairer la notion de guerre, justifier son utilisation dans cette crise sanitaire par les dirigeants politiques et comprendre la suite notre argumentation.
(Bouthoul et Freund) définissent la guerre comme « une mise en œuvre collective et coercitive de l’hostilité, par l’emploi réglé de la force armée, se traduisant par des combats durables portant atteinte aux personnes et aux biens, donc causant des victimes ». Dans cette définition, on peut retenir les éléments significatifs : hostilité, coercition, forces armées, combats, victimes. La guerre renvoie alors au conflit armé, c’est-à-dire le conflit mené avec des armes, soit tout objet conçu, par nature ou par destination, pour tuer, blesser ou détruire ou menacer de tuer, blesser ou détruire. Comme l’a si bien dit, (Clausewitz 703), la guerre possède « sa propre grammaire ».
Ainsi, lorsqu’on parle de « guerre économique », par exemple pour qualifier la compétition industrielle et commerciale ou de « guerre culturelle », pour qualifier les rapports de l’anglais au français, alors qu’il n’y a pas de mort violente infligée aux personnes adverses, ni de destruction violente infligée à leurs biens, il s’agit là, d’une rhétorique. La guerre à coronavirus ou guerre sanitaire s’apparente ici à la guerre économique, à la guerre culturelle, à la guerre des nerfs ou à la guerre d’information (F-B Huyghe).
Sur cet aspect, (Kacou et Irigo 363) sont plus explicitent. Pour ces chercheurs :
Le coronavirus a entrainé inéluctablement et sans ambages, une reconsidération du sens de la guerre. La guerre n’est plus désormais qu’une lutte armée entre États, un moyen de résolution des conflits, mais un déséquilibre qui affecte les institutions sociales, sans nécessairement faire une déclaration préalable de guerre. Il induit également un changement de paradigmes dans l’explication que Gaston Bouthoul a donné à la polémologie, science de la guerre, ou l’étude de ses formes, de ses causes, de ses effets et de ses fonctions. On peut tout de même mobiliser l’armée pour lutter contre un ennemi dans le modèle imposé par le Covid-19, sans avoir besoins d’armes. On peut utiliser les termes du champ sémantique et des stratégies militaires (Etat d’urgence, couvre-feu).
La notion de guerre sanitaire fait ainsi référence à cette situation exceptionnelle durant laquelle, les autorités compétentes prennent des mesures d’urgence pour lutter contre une épidémie (ennemi) qui menace la santé publique de la population (Bissiriou 3). Elle se joue sur de très nombreux fronts que sont : Etat d’urgence, conseil de défense, déclarations politiques, plans d’action, stratégies de confinement, bouclage des villes, fermeture des frontières, couvre-feu, mais aussi des armes sanitaires sophistiquées pour remporter la bataille contre le virus, telles que les masques chirurgicaux, les respirateurs, les vaccins, les hydroxychloroquines, les vitamines D, les azithromycines, les gels hydroalcooliques, les kits de dépistage, les eaux savonnées, les distanciations sociales, les lavages des mains, etc.
Mais on retiendra que la guerre contre le coronavirus déborde le secteur de la santé. Foncièrement anomique, elle met à rude épreuve les fondements de l’ordre social dans la majorité des sociétés (Strauss-Kahn). En effet, (Brustlein) estime que le discours de la guerre que martèlent les décideurs politiques à longueur des journées est une rhétorique qui invite à l’unité du corps social, interdisant le traitement démocratique de ce qui divise la société. A travers les discours rhétoriques mais guerriers, les dirigeants et acteurs institutionnels cherchent à convaincre les citoyens qu’ils dirigent, à concentrer leurs efforts sur l’ennemi commun qui veut détruire les manières de vivre. C’est à juste titre que (Lagrost et Payen 9), deux scientifiques français lançaient un appel à la mobilisation générale en proposant :
Un grand élan national et participatif au travers duquel chacune et chacun, côte à côte et dans l’union, aurait la pleine sensation de participer à la lutte et à l’efficacité du dispositif de riposte. L’heure viendra, a posteriori, d’évaluer si cette démarche participative aura, ou pas, significativement augmenté nos chances de sortie de la crise de la Covid-19 et aura réduit la lourdeur d’un bilan humain qui s’annonce élevé. Il nous semble que ce défi, sans précédent, mérite d’être relevé.
Il y a lieu de rappeler que la guerre contre la pandémie à coronavirus à travers le monde a donné lieu à plusieurs types d’interventions /actions. D’abord, l’intervention des gouvernants pour coordonner la lutte en donnant les directives, montrant la voie à suivre face aux nombreux décès, aux contaminations en cascade et en rassurant la population tétanisée. Ensuite, les scientifiques, le corps médical et les civils, portés à l’avant-garde du combat sanitaire pour les recherches biomédicales et la prise en charge des malades. Enfin, les forces de défense et de sécurité pour des raisons de sécurité, mais aussi leur capacité à porter secours au monde civil en cas de sinistre. Le besoin de sécurité y tend à normaliser la généralisation des restrictions des libertés individuelles, à travers l’imposition des mesures de confinement plus ou moins volontaires en fonction des pays. Cela correspond à l’instauration d’état d’urgence sécuritaire qui justifie les contreventions, les violences policières à l’égard de la violation des mesures de confinement et des gestes barrières dans un contexte de pénurie de moyens. (Fasin & al). La gestion militaire de la pandémie à coronavirus au Togo se situe dans ce cadre. C’est une mission subsidiaire et ne peut être habituellement accomplie au détriment des missions principales des forces armées togolaises qui sont entre autres, la sécurisation des frontières terrestres, maritimes et aériennes contre les envahisseurs extérieurs et la protection de la population civile et leurs biens contre les criminels et les bandits des grands chemins.
3.2. La gestion militaire de la crise sanitaire
C’est en observateur avisé que Jacques Chirac cité par (Hessou 121) définissait les forces militaires comme « un corps spécialisé de protection, de défense, qui évolue au rythme des missions que lui confie la Nation, s’adaptant aux exigences de la sécurité, aux ambitions de son peuple et aux contraintes de son environnement ». A l’analyse des termes de cette définition, l’on peut remarquer que les missions originelles dévolues aux forces de défense et de sécurité et qui sont écrites dans les lois fondamentales, ne sont ni statiques ni figées, mais peuvent évoluer en fonction des circonstances exceptionnelles. C’est pourquoi, (Bonnaud 58) pense que les forces armées doivent s’adapter à toutes les circonstances de menace dans un monde en proie à des conflits asymétriques.
Depuis l’apparition de la pandémie à coronavirus, les nations du monde ont très tôt fait, de confier aux forces armées, des missions exceptionnelles en fonction du niveau organisationnel de l’appareil sécuritaire de chaque pays en de pareil circonstance. Dans les pays développés par exemple, les forces de défense et sécurité participent à la recherche scientifique pour trouver les remèdes à la pandémie, à la construction des hôpitaux, aux transports des malades vers les lieux sûrs et, à même temps, protègent les territoires contre d’éventuels envahisseurs, les centres de recherche et laboratoires contre l’espionnage. A l’heure de la guerre industrielle et commerciale, ce sont les forces armées qui sont plus utilisées pour éviter la fuite des informations et des découvertes scientifiques. Tel n’est pas le cas en Afrique où les forces armées sont encore embryonnaires à l’acception de l’Algérie, le Maroc, l’Egypte et l’Afrique du Sud. Ainsi, pour mener la lutte contre le coronavirus en Afrique, de nombreux Etats se sont limités seulement à l’adoption des mesures de restriction, à la circulation des personnes, la limitation des libertés de mouvement, le droit de réunion et l’interdiction des rassemblements de grande ampleur.
Au Togo, la gestion de la pandémie à coronavirus par la FOSAP s’est faite sur un seul front, celui de faire respecter les mesures barrières édictées par les autorités politiques dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit entre autres mesures, l’interdiction des voyages inter-régions, la contrainte des populations à respecter le couvre-feu et le respect obligatoire des gestes barrières classiques. Les champs d’intervention de cette force militaire sont alors les zones à fortes densités humaines notamment les marchés, les artères, les grands carrefours, les gares routières, les aéroports, le port, les établissements scolaires, les frontières terrestres et les sites sécuritaires névralgiques etc. Toutes les composantes du système de sécurité ont été mises à contribution, notamment, les forces armées nationales, les services de santé des armées, la police, la gendarmerie, les gardes-frontières et les acteurs locaux de la sécurité. Comme l’affirme un chef d’unité de la FOSAP dans la ville de Lomé :
Nous avons pour mission de rendre opérationnelles les dispositions prises par les autorités du pays dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. La mise en application de ces dispositions demande de la discipline et de la rigueur si l’on veut préserver la santé et le bien-être des populations. La mission s’étendait aussi aux lieux de prise en charge des malades à la rue où déroule la contamination en passant par les lieux de quarantaine. La situation est telle qu’il faut très vite arrêter les chaînes de contaminations, et ça se fait dans les lieux publics (les bars, les restaurants, les funérailles, les mariages, les églises et autres lieux de ce genre). La mobilisation urgente des matériels, l’apport en effectifs de soignants et la surveillance des lieux de quarantaines sont autant de tâches dévolues aux agents de la FOSAP. (Source : enquête de terrain).
Mais, la guerre sanitaire de la FOSAP ne s’est pas faite sans résistance de la population civile. La désinformation a rendu complexe l’application des mesures de prévention contre une contamination généralisée au coronavirus. On a assisté à des violations de couvre-feu, le refus de port de masques, l’entêtement des manifestations et des regroupements. Les patrouilles, la surveillance des frontières, le contrôle systématique du respect des mesures barrières, les éléments de la force militaire engagée se sont confrontés à de heurts avec les populations civiles qui ne comprennent pas les enjeux sanitaires des mesures prises. Un officier de la FOSAP dans la région centrale précise :
Le rôle de la FOSAP a été dans la majorité des cas, de participer aux activités préventives. Elle a été déployée pour mettre en quarantaine des communautés, empêcher les sorties et les entrées d’individus dans les communautés infectées ou pour limiter la circulation aux frontières des pays de la région. Il fallait faire avec les injures et le mépris des gens, et l’étonnant c’est que c’est pour le bien de nous tous. (Propos recueillis sur le terrain).
Ainsi, on retiendra de cette bataille contre le coronavirus, l’implication active des forces de défense et de sécurité togolaises[2], sous l’appellation de la FOSAP. Elles ont été chargées de faire respecter les quarantaines, les couvre-feux et de gérer plusieurs points de contrôle, afin de juguler, voire interdire la libre circulation des personnes dans l’espoir d’endiguer la propagation de la maladie. Dans certains cas, l’usage de force ‘’exagérée’’ pour disperser les foules et faire respecter le couvre-feu émanent d’un ordre public, une réaction excessive imputable au fait qu’elles n’étaient ni suffisamment formées ni habituées à des crises de cette ampleur, a alimenté les critiques. Des heurts tragiques, des interactions logiques avec les éléments de la FOSAP ont ainsi eu lieu dans les quartiers, villes et régions, de jour comme de nuit. Les manifestations populaires contre des mesures restrictives (bouclage de villes), la limitation des transports publics, l’organisation des manifestations politiques et traditionnelles ont entraîné des affrontements avec les forces de l’ordre et de sécurité.
3.3. Perceptions de la population civile de la pandémie à coronavirus et de la gestion militaire de la pandémie
Différents points de vue concourent dans le contexte des sociétés africaines à construire les perceptions mitigées des populations sur la question de la pandémie à coronavirus. L’analyse des résultats de l’enquête a permis d’établir des liens de causalité entre la théorie complotiste et le comportement des populations civiles d’une part et les efforts de la force de sécurité anti-Covid-19 pour protéger le peuple d’autre part.
Des communiqués sur les dérives militaires publiés par les défenseurs des droits, aux contre-communiqués des gouvernants, en passant par les publications des vidéos sur les réseaux sociaux et dans les médias, les populations se retrouvent confrontées à la peur, au doute et à l’embarras. Au résultat, nombreux sont ceux qui estiment que les forces militaires en font de trop sur une affaire de virus qui n’est pas aussi tangible qu’on veut en faire croire. En se référant à l’analyse faite par un anthropologue membre de la société civile interrogé, celui-ci estime que :
Toutes ces psychoses savamment entretenues visent à remettre en cause l’ordre social établi, et dans ce contexte de la guerre sanitaire, amener les populations à choisir leur propre voix contre la pandémie. Dès lors que les populations ne croient pas à l’existence du virus ou du moins à sa dangerosité déclarée, elles développent de la réticence, voire de la résistance face à la force militaire chargée de faire respecter les mesures adoptées pour limiter la propagation du virus. (Source : enquête de terrain).
Dans une société dominée par l’information de rue et très peu abonnée aux médias officiels, le mode d’information sur la question joue un rôle très important. Les moteurs d’informations de rue, les conducteurs de taxi moto, colportent et diffusent toutes sortes d’informations glanées çà et là et qui embrouillent la perception générale de la maladie.
On se rappelle qu’à la faveur de la pandémie, les fake-news sur le coronavirus ont proliféré partout au point que l’OMS popularise en avril 2020 le concept « d’infodémie », pour désigner l’émergence d’une épidémie de fausses informations. Un membre de la coordination de la riposte contre le Covid-19, à qui nous avons approché, déplore qu’« il y a beaucoup d’idées reçues et d’incompréhensions sur le Covid-19, à tel point que les populations togolaises n’arrivent plus à faire la part des choses.» (Source : entretien individuel). Il poursuit en disant : «Sur le terrain, nombreuses sont les personnes qui ne croient même pas au Covid-19. Et ce sont les rumeurs qui circulent sur internet et par les réseaux sociaux qui en sont à l’origine. Les gens ne vérifient pas ce qu’ils lisent ».
Les difficultés pour juguler la crise avec l’adhésion des populations à travers le respect des dispositions prises sont en ce sens liées à la perception que les populations se font de la pandémie et le lien fait avec la réalité politique. Or, c’est pour forcer la convergence des mesures que les forces de défense et de sécurité sont mises à contribution.
3.4. Que retenir de la gestion de la FOSAP de la pandémie à coronavirus
Dans le cadre de la guerre sanitaire, il est essentiel de relever les faiblesses du dispositif sécuritaire mise en place pour gagner la bataille contre la pandémie à coronavirus. En effet, faire appliquer les différentes mesures coercitives et les dispositifs d’exception dans le respect des droits de l’Homme et de l’Etat de droit, mais aussi du principe de proportionnalité dans l’usage de la force, ont été des défis majeurs pour l’appareil de défense et de sécurité mis à contribution.
Dès l’entrée en vigueur des diverses dispositions, les accusations contre les forces de l’ordre se sont multipliées, relayées par la presse, les défenseurs des droits de l’homme et amplifiées par les réseaux sociaux. Les médias ont rapporté les bavures des forces de défense et de sécurité dans plusieurs localités du pays. On note, entre autre, les tirs à bout portant sur un jeune laveur de moto dans le quartier d’Avedji à Lomé par un agent de la FOSAP au motif qu’il a refusé d’obtempérer à ses injonctions (LTDH), de l’assassinat d’un garçon à Adakpamé (banlieue de Lomé) pour avoir violé le couvre-feu (CNDH), de la dispersion violente le 26 septembre 2020 d’une cérémonie traditionnelle dans la ville de Niamtougou au nord du pays occasionnant (1) mort, dix-sept (17) blessés dont treize (13) dans les rangs de la police et quatre (4) dans les rangs des manifestants ainsi que des véhicules de la police et une maison incendiée (Ministère de la sécurité et de la protection civile, 2020[3]), sans oublier les bastonnades, les traitements inhumains infligés aux retardataires surpris par les couvre-feu. Toutes ces violations des droits humains ont poussé la population civile, le 23 avril 2020, à descendre dans les rues pour manifester son ras-le-bol contre la gestion militaire du Covid-19. Comme l’a déploré un acteur de la société civile sur sa page Facebook : « C’est quoi cette propension des militaires à faire usage d’armes à feu sur les civils. Le métier des armes est-il devenu un permis de tuer en toute impunité ? (…). Bande de lâches ! Ces types qui assassinent à tout va sont-ils aussi nos frères togolais recrutés dans l’armée ? ».
Le journal satirique Sika’a[4] pense simplement que « militaires et policiers au Togo sont les meilleurs ennemis du peuple ».
Source: Donisen Donald, in Liberté n° 3135, 2020
Face aux bavures, on aura remarqué l’impréparation des forces de l’ordre, surtout sa composante militaire, au maintien d’ordre (M.O.) très indispensable dans le contexte de la mise en œuvre des décisions de l’état d’urgence. Pour combler cette faiblesse, devront être revue, la délimitation de manière aussi claire que stricte les responsabilités respectives des différentes catégories de forces déployées, la mobilisation des militaires comme force de contrôles, le recours éventuel aux services de renseignement pour recueillir un certain nombre d’informations liées aux malades au sein des communautés qui refusent de les déclarer. Toutes ces observations relevées de la gestion militaire de la pandémie à coronavirus se veulent des indicateurs invitant les autorités politico-militaires à inscrire, au menu des défis à relever, la refondation de l’outil de défense et de sécurité pour une consensuelle protection des civils.
4. Discussion
Cette recherche a passé en revue les communications politiques des gouvernants dès la parution de la Covid-19, communications qui insistent sur une attaque sanitaire des pays du monde et nécessite des mesures guerrières pour y faire face. A l’analyse des différentes communications, il apparait que le concept de guerre ou de guerre sanitaire qui revienne dans les discours des gouvernants est une rhétorique destinée à influencer le comportement des populations en les appelant à l’unissons et à justifier les mesures urgentes qu’ils prennent pour enrayer le danger. Le discours rhétorique d’après (Reboul ; Gosselin) est un art politique qui vise à influencer les croyances des individus en utilisant des arguments aussi bien rationnels que non rationnels, tant logiques que non logiques. D’où, les décrets, les déclarations, les appels et les autres résolutions dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui font tous allusion à des situations d’une extrême gravité, nécessitant non seulement une prise de conscience collective mais aussi une réaction prompte et efficace. Et, c’est d’ailleurs, la raison qui a motivé la suspension des lois et textes constitutionnellement établies.
Dans une situation exceptionnelle, comme c’est le cas de la crise sanitaire, (Foulquier) admet que le pouvoir exécutif peut s’affranchir du respect intégral et pointilleux de la loi afin de préserver les services publics et les intérêts de la Nation. Ainsi, la lutte contre le coronavirus est une circonstance exceptionnelle qui a entrainé la mise en quarantaine des populations, le bouclage des villes, les couvre-feux, l’obligation de passe sanitaire, l’interdiction de manifestation publique, fermeture des écoles et des lieux de culte etc. Les bavures, les violations des droits de l’homme et l’obligation faite à toute la population de se faire vacciner relèvent des mesures exceptionnelles qui ne pourront pas être pardonné en temps normal mais excusable en période d’état d’urgence.
Conclusion
La crise mondiale de coronavirus apparue en décembre 2019, à Yuhan, en Chine a porté préjudice à la vie des communautés et au fonctionnement des institutions. La mise en œuvre des mécanismes de riposte contre la pandémie à coronavirus, loin de répondre parfaitement aux menaces que représente ce virus, n’y constitue qu’un palliatif, vu le nombre de victimes de par le monde. La mobilisation des ressources répondait donc à la nécessité de protéger les populations et aussi de garantir la marche de l’appareil économique.
L’engagement des forces de défense et de sécurité dans cette guerre sanitaire, s’il a permis de répondre à cette nécessité à laisser des séquelles et des leçons pour l’avenir. En effet, l’avènement de la pandémie à coronavirus a permis à chaque pays d’évaluer sa capacité de survie face à l’inédit. D’où la réflexion sur les réformes en profondeur de toutes les institutions et surtout l’institution de défense et de sécurité. Il apparaît particulièrement important que l’impératif d’œuvrer en faveur d’une gouvernance plus démocratique des systèmes de sécurité ne passe pas au second plan. De nombreux programmes de coopération doivent en outre être redirigés vers le soutien aux systèmes de santé, réponse tardive et réactive à des appels émis bien avant l’apparition de la pandémie à coronavirus. Pour autant, il sera important de ne pas perdre de vue que les efforts de longue haleine engagés pour œuvrer en faveur de la réforme des systèmes de sécurité nécessitent des initiatives de leur pérennisation.
Trop souvent, les changements de priorité ont été l’un des facteurs explicatifs des faibles progrès accomplis en cette matière. Au cours des dernières années, les processus engagés ont ainsi été fréquemment détournés de leurs objectifs initiaux – notamment en matière de gouvernance démocratique, de respect de l’état de droit et de promotion des droits de l’Homme – par des priorités nouvelles qui ont fini par accaparer l’agenda des réformes (lutte anti-terroriste, prévention de l’extrémisme violent, lutte contre les migrations illégales notamment).
Il sera bien sûr nécessaire de prendre en considération les conséquences et les leçons apprises de la gestion de la pandémie à coronavirus par le dispositif de défense et de sécurité en pleine refondation. Il convient de renforcer l’opérationnalité et sa gouvernance démocratique dont cette pandémie démontre de nouveau le rôle crucial pour l’avenir du pays, au-delà de la seule réponse aux crises de nature sécuritaire. Cette expérience laisse entrevoir le développement des relations de confiance avec les populations et les communautés dont la coopération et la réceptivité seront indispensables pour garantir l’efficacité des mesures édictées dans le contexte de l’état d’urgence.
Enfin, la crise liée à la pandémie du Covid-19 invite plus que jamais à prendre en considération l’approche fondée sur «la sécurité humaine», conceptualisée par le Programme des Nations Unies pour le développement dès les années 1994 et qui appelle à considérer la sécurité, non pas uniquement sous un angle militaire mais aussi dans ses dimensions sociales, politiques, alimentaires, environnementales, communautaires et sanitaires, tout comme dans sa dimension globale et transnationale et non pas uniquement nationale.
Travaux cités
Agent France Presse. « Covid-19 : deuxième vague de contaminations en Asie », (2020) voir : https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/202003/22/01-5265881-covid-19- deuxième-vague-de-contaminations-en-asie.php.
Bardin, Laurence. L’analyse de contenu. Paris, quadrige, PUF. 2007.
Bellot, A. « La grippe A suscite une pandémie de controverses », Rue89. 2009.
Bonnaud, Pierre-Marie. Justifier la guerre. Mécanismes du discours politique occidental de justification de la guerre moderne. In Institut de relations internationales et stratégiques. Paris, France. p 58. 2014.
Braw, Elisabeth. « No Military Has Done More for Corona-Stricken Allies Than Germany, Defense One », 2020. https://www.defenseone.com/ideas/2020/04/no-military-has-done-more-corona-stricken-alliesgermanys/164671.
Brustlein, Corentin. « La défense française contre le covid-19. Quels défis par-delà l’horizon ? » In Centre des études de sécurité, de l’Ifri, Paris. 2020.
Cantwell, Alan. Aids and the doctors of death, an inquity into the origins of the aids epidemic, Aries Rising Press. 1988.
Clausewitz, Carl von. De la guerre. Paris : Éditions de Minuit, p. 703. [1832] 1955.
European Centre for Disease Prevention and Control. Gouverner l’imprévisible, Deloitte Analysis. 2020,
Fassin, Didier et al. « La démocratie à l’épreuve de l’épidémie », Esprit 468 . 2020.
Fortin, Marie-Fabienne et al. Le processus de la recherche : de la conception à la réalisation, Mont-Royal, Déciare Edition. 1996.
Foulquier, Norbert. « La théorie des circonstances exceptionnelles ». Revue Juridoctoria, No 7. 2011.
Friedrichs, Jürgen et Hartmut Lüdtke. Tradition libre de « Participant observation registers perceptible actions in natural situations » in Participant observation : theory and practice, Lexington, Books. 1980.
Gamba, Fiorenza. et al. Covid-19 : Le regard des sciences sociales. Genève et Zurich, Editions Seismo, sciences sociales et questions de société. 2020.
Hessou, F. T., 2007, « Les militaires assis entre deux chaises : entre la société civile et l’armée ». Colloque sous-régional de l’IAJP, Société civile, forces de l’ordre et de défense. Cotonou, Collection Xwefa. p. 121.
Huyghe, François-Bernard. Anthologie de textes sur la polémologie. 2008. téléchargeable sur http://www.huyghe.fr/actu_482.htm.
Kacou, F. P. et Irigo, J. M. G. 2020, « La Société à l’épreuve de la pandémie du Covid-19 », Revue Echange, volume I. p. 363
Lagrost, Laurent et Didier Payen. « L’action publique face à la crise du Covid-19 ». Institut Montaigne, Paris, France. Pp 9. 2020.
Lofland, John. Analysing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis, Belmont Wadworth. 1971.
Machrouh, Jamal. « Coronavirus, risque global et ordre mondial ». Policy Center for the New South. 2020.
Millon, Clément. « De la crise à la paix sanitaire, en passant par la guerre. L’origine d’un état nouveau ». Revue politique et parlementaire. No 1097. 2020.
Ministere des Armées. « France, Opération Résilience ». 2020. https://www.defense.gouv.fr/operations/france/operation-resilience/dossier-de-reference/operation-resilience.
MOREL, Sandrine. « L’Espagne en état d’alerte face au coronavirus : confinement généralisé et militaires déployés ». Le quotidien le Monde (France). 2020.
Mucchielli, Alex. Dictionnaire de méthode qualitative en sciences humaines. Paris, Edition Armand Colin. 2006.
Organisation Mondiale de la Santé. Prise en charge clinique de la COVID-19 : orientations provisoires (No. WHO/2019-nCoV/clinical/2020.5).. 2020.
Peretz, Henri. Les méthodes en sociologie : L’observation, 2e Edition, Paris, La Découverte et Syros (Collection « Repère »). 2006.
Reboul, Olivier. La rhétorique. Michel Meyer (éd.), De la métaphysique à la rhétorique. Bruxelles, Edition de l’Université de Bruxelles. 1984.
Robert, Jacques. « Les situations d’urgence en droit constitutionnel ». Revue internationale de droit comparé, Volume 42, No 2. 1990.
Schmidt, Nadine. « Germany Mobilizes 15,000 Soldiers to Support Coronavirus Effort, » 2020.
Schutz, Alfred. Le chercheur et le quotidien : Phénoménologie des sciences sociales, Paris, Khucksieck. 1971.
Taguieff, Pierre-André. L’imaginaire du complot mondial, Aspects d’un mythe moderne, Milleet Une Nuits. 2006.
Wieviorka, Michel. « Coronavirus : parler de guerre est une faute », in La Tribune (France). 2020.
Comment citer cet article :
MLA : Magnetine, Assindah. «La Force de Sécurite Anti-Pandémique à l’épreuve de la Covid-19 au Togo ». Uirtus 1.2 (décembre 2021): 27-47.
§ Université de Kara / [email protected]
[1] (http://www.sinotables.com › 2020/03/30 ).
[2] Soulignons que c’est un officier des forces armées togolaises, le Colonel-médecin Djibril Mohamed qui dirige la coordination nationale de la riposte du Covid-19 au Togo
[3] Le communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, indique que le Préfet de Doufelgou, pour amener les populations à célébrer dans le respect des mesures anti-covid-19, a convoqué une séance de travail entre les organisateurs de cette cérémonie et la préfecture. Mais les populations de Niamtougou ont refusé de se conformer aux mesures prises au cours de cette réunion. Elles ont posé des barricades pour empêcher la police d’intervenir et ont poursuivi leurs festivités comme si de rien n’était.
[4] New.phxfeeds.com/share ?