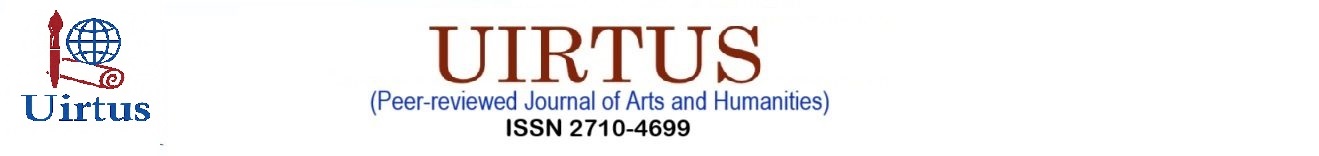Résumé : La thématique de l’échec est rendue actuelle par une littérature du XXe siècle très prolifique qui s’attache à l’analyse de la condition humaine. Et Georges Perec en fait une source qui lui permet d’explorer les spécificités d’une société contemporaine qui se focalise exclusivement sur la matière et la possession. Perception qui nous amène à interroger la notion de l’échec qui expose la vulnérabilité sociale et psychologique de personnages singuliers. Pour nourrir cette réflexion, nous nous sommes appuyés sur la prégnance du discours de l’échec dans son texte Les choses ; ce qui a favorisé l’analyse d’une écriture des objets et des choses assez caractéristiques.
Mots-clés : impuissance, inaction, fatalité, perdant, négation
Abstract: The theme of failure is made current by a very prolific 20th century literature which focuses on the human condition. And Georges Perec makes it a source that allows him to explore the specificities of a contemporary society that exclusively focuses on matter and possession. A perception which leads us to question the notion of failure which exposes the social and psychological vulnerability of singular characters. To nourish this reflection, we relied on the significance of the discourse of failure in his text Les choses; this favored the analysis of a fairly characteristic writing of objects and things.
Keywords : incapacity, inaction, fatality, loser, negation
Introduction
La compétition, la réussite sont les mots et/ou les maux caractéristiques d’une société contemporaine qui ne tolère pas les perdants. Cet environnement de quête de la performance constitue, à rebours, un terreau favorable de construction de la marginalisation et de la mésestime pour une catégorie sociale. Cette perception matérialiste du monde génère l’idée de l’échec qui trouve son expression dans des champs de connaissance aussi divers que la philosophie, la sociologie, la psychologie et la psychanalyse. À l’instar de ces domaines, la littérature aussi fait de cette thématique un objet d’étude par sa représentation d’un phénomène social. Elle s’en fait l’écho dans des productions qui construisent un archétype de personnages totalement désintégrés et ancrés dans un défaitisme très caractéristique.
Anne Simonin aborde la même perspective en affirmant que « La littérature consacrée au génie et au succès est importante, celle de son double malheureux, l’échec, est très réduite. L’échec fait peur. Son « roman vrai » n’intéresse pas, à l’exception notable des psychanalystes » (111).
Ainsi des romans français majeurs sont représentatifs de ce type de personnages. Dans ce cas, les personnages d’Albert Camus sont aux prises avec une existence problématique, ceux d’Olivier Adam ou encore de Primo Levi sont empêtrés dans des situations totalement deshumanisantes d’où ils ne peuvent se soustraire ou semblent s’abandonner tant ils sont annihilés. Ces écrivains définissent des personnages totalement irrationnels et désensibilisés qui se retrouvent de l’autre côté du rideau, comme s’ils étaient soumis à une fatalité. Le problème que cette situation pose est celui de la condition humaine complexe qui contraste avec une littérature contemporaine à relent humaniste qui postule la valeur et la liberté de l’homme.
Cette perspective existentielle paradoxale a conduit à réfléchir sur le sujet : Figuration de l’échec dans Les choses de Georges Perec. Un tel thème induit des questions de recherche qui permettront d’orienter l’analyse : Comment l’échec est-il représenté ? Comment le discours de la marginalité et de la désintégration se déploie-t-il dans le texte ?
Pour répondre à ces questions nous allons convoquer les méthodes narratologique et linguistique qui permettront d’étudier d’abord la typologie du personnage perdant. Il s’agira d’analyser les personnages principaux dans une perspective qui les appréhende selon la classification d’Éric Bordas qui définit une typologie basée sur quatre éléments majeurs (162-163). Ce qui aboutira à dresser une caractérisation de l’archétype du loser, dont la marginalisation est cristallisée par une narration avec une situation finale consacrant une irréversibilité du désavantagé. Ensuite, le discours de l’échec conduit à analyser une linguistique du perdant qui est consacrée par une véritable apologie de l’échec. Elle se perçoit dans un langage et des expressions spécifiques et un champ lexical particulièrement abondant ainsi qu’un vocabulaire dédié à cette notion.
- Typologie du personnage loser
Il serait illusoire d’évoquer les catégories de personnages sans définir la notion même de personnage qui intéresse la critique. Cette instance narrative, en effet, a connu des fortunes diverses avec les différentes approches qui enrichissent les travaux critiques. La plus virulente des études est certainement celle d’Alain Robbe-Grillet qui vilipende le statut du personnage. Il formule clairement le reproche suivant : « Nous en a-t-on assez parlé, du « personnage » ! Et ça ne semble, hélas, pas près de finir. Cinquante ans de maladie, le constat de son décès enregistré à maintes reprises par les plus sérieux essayistes, rien n’a encore réussi à le faire tomber du piédestal où l’avait placé le XIXe siècle. C’est une momie à présent » (31). La déchéance du personnage dont parle le critique est d’une autre façon, l’annonce de la perte d’un privilège. Dans cette étude, il est soumis à un effilochage qui est régi par des caractères qui se déclinent en trois strates : l’inaction, l’état d’esprit et le conditionnement social.
D’abord l’inaction du personnage est caractéristique. A priori, il paraît être en action, tant il est inscrit dans une dynamique évolutive. Cependant, le schéma actantiel du support textuel montre un état initial qui ne subit pas de modification substantielle puisque les personnages principaux sont toujours dans une situation végétative. Dès l’incipit, le récit présente des protagonistes et des adjuvants qui sont installés dans une léthargie. Cette situation de non action n’est pas modifiée, malgré le changement d’espace (de la France à la Tunisie), la lassitude et la prise de conscience de leur statut d’infortunés qui auraient pu créer le déclic et favoriser ainsi une réaction possible des personnages.
Ainsi, les actions que posent les personnages ne sont pas assez importantes au point de modifier leur état général. Dès le début du texte, le narrateur décrit des personnages dépareillés qui mettent fin à leurs études de droit et exercent des emplois précaires ou très banals. Cette situation de départ ne connaît pas d’évolution, puisque la précarité ne disparaît pas dans le dénouement de l’histoire. Finalement, les personnages s’inscrivent dans une forme de résignation ou d’accoutumance à leur situation. Nous lisons cette abdication dans ce passage : «Une annonce parue dans le Monde, aux premiers jours d’octobre, offrait des postes de professeurs en Tunisie. Ils hésitèrent. Ce n’était pas l’occasion idéale. Ils avaient rêvé des Indes, des Etats-Unis, du Mexique. Ce n’était qu’une offre médiocre, terre à terre, qui ne promettait ni la fortune ni l’aventure. Ils ne se sentaient pas tentés » (Perec 121). Les personnages sont en proie à une désillusion qui les amène à accepter, mal gré, des activités de peu de valeur avec des perspectives de carrière quasi inexistantes. Il y a un oxymore qui révèle une antinomie entre une opportunité d’affaire (l’annonce d’une offre d’emploi) et un désintérêt qu’ils affichent avec ostentation. Pour ce faire, l’emploi de la locution adverbiale « terre à terre », l’adjectif « médiocre » et le verbe « hésiter » montre l’attitude de dénégation et de minimisation affichée par des personnages qui sont paradoxalement en pleine crise existentielle.
Mieux, l’auteur n’est pas dans une logique de condamnation. Pourtant, il s’emploie à représenter des êtres maudits, de véritables abonnés aux ratages et qui entament une descente dans des lieux périphériques. Ce qui fait dire qu’il y a une perception duale dans le texte : une catégorie de losers et une autre de privilégiés. La focalisation est orientée vers la première catégorie qui s’autocensure et ne lutte plus, comme si elle s’abandonnait à la fatalité. Nous lisons une attitude contraire du protagoniste du Mythe de Sisyphe. Dans ce texte, Albert Camus revisite le mythe grec et les productions homériques qui construisent la figure de Sisyphe. Sa réécriture montre un Sisyphe qui refuse sa condition. A rebours de cette perception, chez Georges Perec le défaitisme est la chose la mieux partagée, car son personnage a conscience de sa situation, mais il assume sa passivité. C’est en substance ce qu’affirme Anne Pellerin :
Du paumé dilettante au poète raté en passant par le poissard en série, le dernier de la classe et le mari trompé, le loser est le champion des coups foireux, du manque de bol, des rendez-vous manqués, des opportunités loupées, des petites défaites et des grands échecs. Il préfère la fuite à la conquête, recule là où il faut avancer, hésite quand il faut agir et n’est pas sans peur ni reproche. S’il part de rien, il n’arrive à rien, voire est un bon à rien. Sombrant souvent dans un état d’inertie et de stagnation, il ne suit pas la trajectoire de l’ascension sociale, mais celle de la déchéance sociale et de la descente aux enfers. (3)
Bref, la posture des personnages, au sens physique du terme, donc la position assise qui est adoptée et qui implique une mobilité réduite sinon inexistence, est une expression de la platitude qui annihile la volonté de sortir d’une situation instable ou inconfortable. Il y a une sorte d’acceptation d’un état qui ne connaît pas d’évolution. Ce qui dénote de la fixité des personnages qui ne sont pas des êtres de faire.
Ensuite, l’état d’esprit général du personnage que décrit le narrateur s’exprime dans le pessimisme affiché. C’est un sentiment ambiant qui brise tout effort de transformation de la situation de départ du personnage. De ce fait, appréhender une telle psychologie altérée conduit à s’intéresser à la philosophe de Schopenhauer. Selon ce penseur allemand, « nous passons toute notre vie à poursuivre un objet puis un autre, allant du désir et de la privation à la déception que la possession engendre toujours. »[1] Georges Pérec se fait l’écho de cette philosophie en construisant des personnages dont la volonté est annihilée tant ils sont convaincus que la position qu’ils occupent ne peut changer dans le bon sens. Ils ont cessé de lutter et laissent le mal rogner leurs espérances. De façon illustrative, nous avons la construction d’une atmosphère de négativité qui affecte tout leur être :
Ils vivaient au jour le jour ; ils dépensaient en six heures ce qu’ils avaient mis trois jours à gagner ; ils empruntaient souvent ; ils mangeaient des frites infâmes, fumaient ensemble leur dernière cigarette, cherchaient parfois pendant deux heures un ticket de métro, portaient des chemises réformées, écoutaient des disques usés, voyageaient en stop, et restaient, encore assez fréquemment, cinq ou six semaines sans changer de draps. (Perec 79)
Le mode de vie qui est adopté par les personnages est totalement misérabiliste. La description, dans ce passage, porte sur des besoins primaires qui ne sont pas satisfaits correctement. On a spécifiquement un champ lexical de l’indigence qui est mis en évidence par le verbe ‘’empruntaient’’, le groupe de mots ‘’frites infâmes’’, les adjectifs ‘’réformés, usés’’. C’est une perception négative d’un quotidien complexe. Il y a dans l’écriture de Pérec une influence hippique qui affiche le refus des valeurs d’une société de consommation caractéristique du système capitaliste. Le gaspillage et la surexploitation sont cloués au pilori par la représentation d’une attitude totalement décalée.
Le type présenté par Georges Perec est à rebours des personnages de récits médiévaux qui présentaient des figures courageuses et victorieuses. L’auteur s’intéresse à des figures moins angulaires que sont les perdants, les ratés qui, généralement, sont loin des feux de projecteur. Cette perception est partagée par Pierre Chartier qui, parlant du point de vue de Balzac sur ce thème, affirme que « Un type […], écrit-il dans la préface à Une Ténébreuse Affaire (1842), est un personnage qui résume en lui-même les traits caractéristiques de tous ceux qui lui ressemblent plus ou moins, il est leur modèle du genre. Aussi trouvera-t-on des points de contact entre ce type et beaucoup de personnages du temps présent » (123).
Finalement, la caractérisation du type perecien se base sur une inaction qui l’installe dans une fixité qui n’évolue pas. Le personnage est inscrit dans un état d’esprit bouleversé qui révèle une résignation et une acceptation d’une condition. Ces traits de fatalité sont construits par un auteur qui aborde, de ce fait, une thématique dont l’actualité dans une société contemporaine est manifeste.
- Le discours de l’échec
Le concept de l’échec est prégnant dans un texte actuel par sa thématique qui porte sur la condition de l’homme. L’auteur ne pointe pas une fatalité ou une divinité, mais un système social qui engendre des inégalités sociales caractéristiques. Dans le texte, la figure du couple Gérôme et Sylvie est représentative des infortunes et de la précarité qui sont abondamment décrites sous le prisme d’une situation d’énonciation qui cristallise l’échec et un vocabulaire de l’impuissance et de la résignation très caractéristique.
À cet effet, Emmanuel Maingueneau dans son approche, affirme que « La notion de situation d’énonciation est au cœur de toute réflexion sur l’énonciation. Il s’agit d’un système de coordonnées abstraites, de point de repère par rapport auxquels doit se construire toute énonciation » (9). Le critique interroge tout un ensemble d’éléments structurels qui sont déployés dans un discours et principalement, pour le cas qui nous intéresse, le roman. De ce point de vue, l’énonciation lève le voile sur un narrateur extradiégétique qui prend en charge la narration d’une histoire rocambolesque. En effet, nous avons une scénographie spécifique de la condition humaine qui est l’objet de l’analyse. Elle pose dès le départ, un environnement où s’épanouit aussi bien un langage spécifique qu’un mode de pensée qui définit une catégorie de personnages. L’auteur ne peint pas spécifiquement des catégories sociales. Il investit une kyrielle d’objets hétéroclites, mais qui présentent une homogénéité. Ces objets de la vie quotidienne sont présentés dans une perspective antinomique qui permet de mettre en évidence un actant qui est présenté, dans ce texte sous la forme de chose. Le terme « chose » (Levinas 137) est employé dans le sens où l’entend le critique, c’est-à-dire un phénomène participant à la jouissance d’un individu. Ainsi dans le texte, nous lisons un amoncellement des objets de plaisir :
Il existait, à côté d’eux, tout autour d’eux, tout au long des rues où ils ne pouvaient pas ne pas marcher, les offres fallacieuses, et si chaleureuses pourtant, des antiquaires, des épiciers, des papetiers. Du Palais-Royal à Saint-Germain, du Champ-de-Mars à l’Etoile, du Luxembourg à Montparnasse, de l’île Saint-Louis au Marais, des Ternes à l’Opéra, de la Madeleine au parc Monceau, Paris entier était une perpétuelle tentation. Ils brûlaient d’y succomber, avec ivresse, tout de suite et à jamais. Mais l’horizon de leurs désirs était impitoyablement boucle. (Perec 18)
Il y a un recensement de lieux et d’objets qui sont focalisés sur la jouissance des sens. Ces déictiques spatiaux présentent des topographies connues et une spatialité qui sont potentiellement chargées d’émotion. Ces milieux exercent une influence sur les sens qui les rendent attractifs. Ils ont une certaine visibilité par la richesse de ce qu’ils présentent. Cependant, ces choses qui s’adressent à la sensibilité sont inaccessibles à des individus démunis dont la satisfaction des besoins est une gageure. À ce propos, le narrateur répertorie un ensemble d’éléments qui montrent un lexique essentiellement orienté sur des manques et des désirs impossibles à assouvir.
Ils vivaient dans un appartement minuscule et charmant, au plafond bas, qui donnait sur un jardin. Et se souvenant de leur chambre de bonne – un couloir sombre et étroit, surchauffé, aux odeurs tenaces – ils y vécurent d’abord dans une sorte de d’ivresse, renouvelée chaque matin par le pépiement des oiseaux. Ils ouvraient les fenêtres, et, pendant de longues minutes, parfaitement heureux, ils regardaient leur cour. La maison était vieille, non point croulante encore, mais vétuste, lézardée. Les couloirs et les escaliers étaient étroits et sales, suintant d’humidité, imprégnés de fumées graisseuses. (18)
Nous avons dans cet extrait un champ lexical de la misère et du dénuement dont le foisonnement met en évidence un espace complètement désuet, insalubre et abject. La perception déformée de la réalité ne permettait pas aux personnages principaux de prendre conscience des conditions de vie exécrable et spartiates dans lesquelles ils baignaient. Pour présenter ce sombre tableau, le narrateur emploie des adjectifs qui relèvent la morosité d’un lieu : « vieille, sombre, vétuste » ; des adjectifs exprimant la crasse : « sale, suintant, graisseuses » ; les adjectifs qui portent sur un cadre de vie bringuebalant : « croulante, lézardée » et des adjectifs qui montrent la restriction d’un espace : « minuscule, étroit ». Tous ces adjectifs permettent d’identifier un milieu qui n’offre pas de confort à ses pensionnaires, mieux qui lève le voile sur leur statut social.
L’expression d’une incapacité ou d’une perte de volonté se lit par un champ lexical particulièrement foisonnant. Ainsi dans le texte perecien, le discours se comprend comme une prise de conscience d’une situation ou d’un statut de défavorisé qui ne peut être modifié, mais est mal assumé par les personnages. Le langage, dans ces conditions, se veut caustique et récriminatoire :
Peut-être étaient-ils trop marqués par leur passé (et pas seulement eux, d’ailleurs, mais leurs amis, leurs collègues, les gens de leur âge, le monde dans lequel ils trempaient). Peut-être étaient-ils d’emblée trop voraces : ils voulaient aller trop vite. Il aurait fallu que le monde, les choses, de tout temps leur appartiennent, et ils y auraient multiplié les signes de leur possession. Mais ils étaient condamnés à la conquête. (24)
Nous avons un groupe social qui adopte le même mode de vie morne de l’étudiant et/ou du psycho-enquêteur affadi. Il s’agit d’une catégorie d’individu qui partage une filiation, un métier et une temporalité. Ces éléments d’identification intègrent ce type de personnages dans un milieu qui les conditionne à développer des besoins inextinguibles qui s’expriment singulièrement par le verbe sans l’action. L’auteur procède ainsi par la construction de deux conditions sociales mises en parallèle pour cristalliser la notion de l’échec.
Il y a tout un langage de la matière omniprésente, mais qui échappe à une possession ou une appropriation. En effet, le procédé de la description qui est utilisé à profusion dans le texte est mis au service des éléments qui sont répertoriés dans une perspective antinomique. Ils cristallisent une société capitaliste de grande consommation stratifiée pour exprimer le non accomplissement des personnages dans cette fiction. Ce discours de paradoxe est exprimé dans le passage suivant :
De station en station, antiquaires, libraires, marchants de disques, cartes des restaurants, agences de voyages, chemisiers, tailleurs, fromagers, chausseurs, confiseurs, charcuteries de luxe, papetiers, leurs itinéraires composaient leur véritable univers : là reposaient leurs ambitions, leurs espoirs. Là était la vraie vie, la vie qu’ils voulaient connaître, qu’ils voulaient mener. (97)
Les personnages, perdent pied avec la réalité fictive, et surfent entre un mode de vie rêvé mais inaccessible, et un autre qui est celui qu’ils vivent. Le faisant, dans l’expression de ce contraste, les personnages sont installés dans une situation d’oxymore. Dans l’extrait, l’opposition sémantique affichée porte sur des propositions. Il y a un idéal de vie projeté qui s’oppose avec leur réalité morne, détestable et implacable qui attise le mal-être. Les éléments cités dans le passage représentent des privilèges qui sont destinés à une classe de nantis. Et l’expression « là était la vrais vie » montre des qualités, des valeurs, des avantages sociaux qui débouchent sur une existence comblée, de jouissance. Toutes les choses décrites conduisent à la satisfaction sensorielle. Ainsi, les plaisirs gustatifs, visuels, tactiles sont ceux qui sont mis en évidence. Leur assouvissement permet d’atteindre une jouissance qui est, malheureusement, mise à mal par l’emploi du verbe « vouloir ». Il traduit l’intention des personnages qui ne suffit pas à rendre effectif un idéal, car la volonté seule ne modifie pas une position sociale. Les personnages ne peuvent que lorgner vers cette société d’avantage impossible à atteindre.
Au demeurant, la catégorie de personnages que nous analysons est confinée dans un espace périphérique singulier qui conduit au développement d’un argotisme. Elle appartient à un milieu qui agit inéluctablement sur leur mode d’expression. Les signes qu’ils emploient éclairent certainement sur un groupe social, mais aussi sur une profession. Mais quels sont les caractéristiques de ce langage ? La réponse amène à porter un intérêt aux travaux de Denise qui affirme que
La définition courante de l’argot est une définition historique : l’argot y est caractérisé comme la langue des malfaiteurs et des mendiants utilisé à des fins cryptiques. Il est clair que, si elle s’applique bien aux origines de l’argot, cette définition ne recouvre pas la multiplicité des formes que celui-ci a pu prendre au cours des siècles. On constate, en effet, que ces formes se développent dans toutes les communautés qui, en se forgeant un langage à des fins cryptiques ou crypto-ludiques, cherchent à affirmer la solidarité de leurs membres ou, plus exactement, la connivence des initiés. (5)
Partant de ce point de vue, l’argot peut être appréhendé comme un langage spécifique à un groupe, en l’occurrence le groupe de psycho-enquêteurs, dans cette fiction, qui utilise les mêmes codes linguistes dans l’exercice de leurs activités. Et c’est l’ensemble de ces signes qui permet d’identifier ce type, mais surtout de le marginaliser dans cet environnement textuel. L’inscription des personnages principaux dans un code de référence a un revers ; elle les classe et les maintient dans une catégorie qui influence leur parcours narratif.
De fait, le discours des personnages porte essentiellement sur le constat d’un manque ou sur la superficialité d’un mode de vie qui est toujours comparé à un autre qui est insaisissable. Ces personnages sont d’anciens étudiants qui ont abandonné leurs formations pour vivre de l’industrie de la publicité. Il s’agit de métiers mal rémunérés qui les maintiennent dans un état constant d’indigence ou dans l’illusion qu’ils ont un pouvoir d’achat. Ils affichent un langage commun tiré de leur métier absorbant de psycho-enquêteurs. Nous lisons dans le texte cette communauté : « Ils étaient tous une bande, une fine équipe. Ils connaissaient bien ; ils avaient, déteignant les uns sur les autres, des habitudes communes, des goûts, des souvenirs communs. Ils avaient leur vocabulaire, leurs signes, leur dada » (42).
Ce vocabulaire dont parle l’extrait est composé de mots techniques employés dans les enquêtes, les sondages et les questionnaires. C’est un ensemble de vocables tirés du domaine de la psychologie et qui foisonnent dans la communication des personnages. Cette spécificité langagière sort de leur cadre professionnel pour alimenter les conversations dans les différents lieux qu’ils fréquentent. Finalement, le discours de l’échec se nourrit d’un vocabulaire spécifique qui porte sur un ensemble de choses et d’objets hétéroclites dont la présence permet de lever le voile sur une condition humaine détestable qui provoque le déséquilibre des personnages de Georges Perec.
Conclusion
L’analyse de la thématique de l’échec a permis d’appréhender, plus que les dimensions sociales et psychologiques soumises à une contrainte dans le texte de Georges Perec, une écriture des objets et des choses dont le foisonnement est assez particulier. Cette étude a permis de caractériser le type du personnage loser. Il est ancré dans une posture qui ne le satisfait pas, mais il ne pose pas d’action pour faire évoluer sa situation. C’est un personnage statique et fataliste qui s’inscrit dans une spatialité périphérique. Aussi, le discours de l’échec est essentiellement porté par un lexique qui s’attache à définir une catégorie sociale. Elle est figurée par un argotisme qui exprime l’impuissance, l’insuffisance, l’insatisfaction et l’amertume. Au total, plus que la focalisation d’un langage pour exprimer l’échec, l’auteur montre la spécificité d’un monde déterminé par un système capitaliste qui stigmatise les perdants.
Travaux cités
Adam, Olivier. Poids léger. Paris : Éditions de l’Olivier/Seuils, 2002.
Barthes, Roland et al. Poétique du récit. Paris : Édition du Seuil, 1977.
Bordas, Éric et al. L’analyse littéraire. Paris : Édition Armand Colin, 2011.
Camus, Albert. La peste. Paris : Édition Gallimard, 1947.
Chartier, Pierre. Introduction aux grandes théories du roman. Paris : Édition Armand Colin, 2013.
François, Denise. « La littérature en argot et l’argot dans la littérature », Communication et langage, 1975 n. 27, p. 5-27, [En ligne] URL : https://www.persee.fr, consulté le 21 avril 2021.
Levinas, Emmanuel. Totalité et infini : Essai sur l’extériorité. Paris : Édition Librairie Générale Française, 2015.
Maingueneau, Dominique. Linguistique pour le texte littéraire. Paris : Édition Nathan, 4e édition, 2003.
Medjahed, Lila. « Satire et procès de l’échec dans la littérature issue de l’immigration algérienne », Synergies Algérie, 14, 2011, p. 169-178.
Pellerin, Pierre-Antoine. « L’art de l’échec : repères historiques et enjeux critiques », Revue française d’études américaines, 163, 2020, p. 3-30.
Perec, Georges. Les choses. Paris : Édition René Julliard, 1965.
Primo, Levi. Si c’est un homme. Paris : Édition Julliard, 1987.
Robbe-Grillet, Alain. Pour un nouveau roman. Paris : Les Éditions de Minuit, 2013.
Simonin, Anne. « Esquisse d’une histoire de l’échec. L’histoire malheureuse des réputations littéraires de Paul Stapfer », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 12, 1994, p. 111-128.
« Pessimisme », Philosophie magazine, philomag.com/philosophes/arthur-schopenhauer, page consultée le 15 juillet 2021.
Comment citer cet article :
MLA : Aka, Adjé Justin. « Figuration de l’échec dans Les choses de Georges Perec. » Uirtus 1.2. (décembre 2021) : 221-232.
[1] https://www.philosophie magazine, philomag.com/philosophes/arthur-schopenhauer/