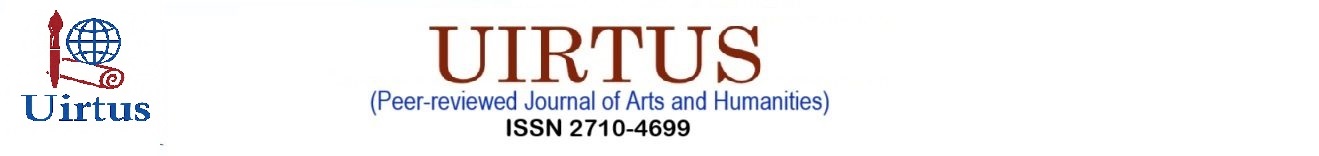Fatchima Mayaki§
Résumé : Cet article exploratoire sur la violence universitaire au Niger s’appuie sur la théorie de la responsabilité partagée d’Epstein. Les résultats sont concluants et montrent que les individus sont non seulement conscients de ce qu’est la violence, mais aussi de l’existence d’une responsabilité partagée. La violence universitaire est une convergence de facteurs qui produit une convergence et une interaction des responsabilités. La responsabilité de la violence en milieu universitaire est imputée dans l’ordre à la famille, aux Hommes politiques, à l’école ici l’Université et enfin à la société
Mots-clés : violence universitaire, responsabilité partagée, Epstein, Niger
Abstract: This exploratory article on academic violence in Niger builds on Epstein’s shared responsibility theory. The results are conclusive and show that individuals know’s what academic violence is, but also the exisence of shared responsibility. Academic violence is a convergence of factors that produces a convergence and interaction of responsibilities. The responsibility for violence in the university environment is attributed in order to the family, to the politicians, to the school here the University and finally to the society.
Keywords: Academic violence, shared responsability, Epstein, Niger
Introduction
Depuis quelques années les violences universitaires sont devenues fréquentes sur les campus au Niger. Au-delà de l’instruction qui est la mission première de l’Université, il se pose aujourd’hui un problème d’éducation : respect entre les étudiants et les autres composantes de l’université, respect des étudiants entre eux, respect des infrastructures etc. La violence est une traduction de l’agressivité qui est certes un comportement normal d’autoconservation chez l’être humain, mais le processus de socialisation permet de juguler cette agressivité pour la diriger vers des tâches de réalisation ou de construction. Lorsqu’elle reste contenue, domestiquée, et se tourne vers la sublimation, la violence peut être un moteur, qui aide l’individu à se construire.
La violence peut être individuelle ou collective, dirigée vers l’autre ou tournée contre soi-même. Elle peut prendre les formes les plus diverses et les plus cachées, allant du mépris et de la non-considération, aux coups et blessures jusqu’au meurtre. Elle peut aussi être verbale ou psychologique. Selon Michaud, il y’a violence quand, dans une situation d’interaction, un ou plusieurs acteurs agissent de manière directe ou indirecte, massée ou distribuée, en portant atteinte à un ou plusieurs autres acteurs, à des degrés variables, soit dans leur intégrité physique, soit dans leur intégrité morale, soit dans leurs possessions, soit dans leurs participations symboliques et culturelles. Les formes de la violence universitaire sont nombreuses (physiques, verbales, psychologiques, économiques etc.) ainsi que leurs causes. C’est par l’éducation que la personnalité de l’enfant développe une appétence sociale. Or, actuellement au Niger, on constate que les familles abandonnent de plus en plus leur rôle d’éducateur. Cet abandon de devoir éducationnel peut générer un manque de repères pour les étudiants.
Il est admis que les caractéristiques d’une société influencent le comportement social des individus qui la composent. Or, depuis des années la société nigérienne fait face à plusieurs problèmes : alimentaire, sécuritaire, politique, environnemental, économique etc. Ceci n’est pas sans conséquence sur les interactions sociales. L’incertitude autour des questions de l’emploi et le chômage créent aussi un malaise social avec la peur de quoi sera fait demain. Au fil des jours, un sentiment de frustration nait et murit. Il suffit d’un catalyseur quelconque pour réactiver l’agressivité naturelle qui sommeille en chacun.
À cette peur du lendemain, s’ajoute une communauté universitaire en crise : Les infrastructures et les structures n’ont pas suivi l’accroissement du nombre d’étudiants depuis plusieurs décennies. La promiscuité est grande. Les œuvres universitaires sont limitées alors que la majorité des étudiants provient des zones rurales. Les nouveaux programmes désarçonnent étudiants et enseignants. Parfois les moyens manquent pour conduire les réformes. Les enseignants sont parfois démunis par rapport à ce que l’institution universitaire leur demande. Les étudiants quant à eux, n’ont pas toujours à leur disposition tout le requis. Mises à part ces violences très médiatisées des marches estudiantines suivies de vandalisme, des grèves des enseignants, il existe de manière endémique des formes de violences parfois ignorées par les individus extérieurs à l’Université. Selon Olweus, la violence à l’Université concerne majoritairement certaines formes insidieuses de violence comme des échanges verbaux, des manquements de conduite et des difficultés relationnelles de manière répétitive, qui mis ensemble entrainent des malaises et finissent par entrainer des passages à l’acte. Sans oublier que cette forme de violence s’accompagne d’une vraie souffrance psychologique. Ainsi, cette violence interne est celle qui nous intéresse suite à plusieurs observations fortuites sur le campus.
Epstein dans son modèle de l’Influence Partagée stipule que l’analyse du comportement violent peut se faire à travers un modèle à trois composantes : la famille, la communauté et le milieu scolaire, qui est ici l’université. Dans ce modèle, la violence à l’école est abordée en fonction de l’un de ces contextes, ou en fonction de l’interaction entre deux d’entre eux.
Ce modèle de la responsabilité partagée servira d’ancrage à cette étude exploratoire. Cependant, il importe d’indiquer qu’il s’agira juste pour nous, de tester cette responsabilité partagée. A ce modèle nous introduisons une autre composante à savoir les Hommes politiques. En effet depuis une vingtaine d’années, les politiciens ont investi les milieux des étudiants : financement des activités, soutien financier individuel surtout. Cette proximité avec le pouvoir politique transfère le climat politique national sur les campus. Certes, cette composante appartient à la communauté, mais la communauté reste une notion diffuse et englobante. Conformément au modèle de la Responsabilité Partagée, nous avançons que la responsabilité de la violence à l’université de Niamey serait due à une démission de la famille, de l’université, de la communauté et à l’immixtion des hommes politiques dans la vie estudiantine. Nous avons tenu à faire une autre inférence : la définition de la violence dépend du corps d’appartenance.
- Méthodologie
- Variables de l’étude
Toutes les variables de l’étude sont binaires
- Variable dépendante
Il s’agit de voir si oui ou non la violence serait due à un manquement d’une des composantes
- Variables indépendantes
Il s’agit de la famille, de l’université, de la communauté et des Hommes politiques. En un mot, est-ce que ces facteurs permettent de prédire ou non la violence.
- Participants
400 individus hommes et femmes sont concernés par cette étude, à proportion égale entre les étudiants, les enseignants, le personnel administratif et technique, et des participants issus de la société en général. L’âge des participants varie entre 19 ans et 65 ans, avec une moyenne de 39,82 et un écart-type de 11,33. Mis à part le respect dans la proportion des différentes composantes de l’étude, l’échantillon est de convenance.
- Outil
Il s’agit d’un questionnaire construit à partir des variables du modèle d’Epstein. Au questionnaire ont été ajoutées d’autres questions. Il s’agit notamment de la définition de la violence. Le questionnaire comporte aussi des questions signalétiques.
- Procédure
Pour les étudiants, une affiche est faite pour les inviter à participer à une recherche sur le développement d’une politique non violente à l’Université. La passation est individuelle dans un bureau qui sert de box expérimental. Pour les autres composantes la passation se fait soit sur leur lieu de travail soit à leur domicile après prise de rendez-vous. La passation dure une vingtaine de minutes au plus. Il importe de noter que des questionnaires ont été passés à certains individus ne parlant pas français (jardiniers, bouviers, techniciens de surface en ce qui concerne l’université). En dépit du biais possible, nous leur avons traduit le questionnaire et avons transcrit les réponses au fur et à mesure. Au Niger, 70% de la population ne parlent pas la langue française. Il est important selon nous d’avoir l’avis de cette frange de la population. Onze questionnaires étaient incomplets. Des questionnaires de remplacement ont été administrés. Il est à noter qu’accepter de répondre ne donne droit à aucune rémunération ou avantage.
- Résultats : présentation et analyse
Les données obtenues aux questions sont traitées grâce au logiciel SPSS 20.0. Il est important de connaître comment la violence est définie par les différents acteurs ; c’est pourquoi le premier résultat concerne la définition de la violence en milieu universitaire.
- Définitions de la violence
A la question de savoir quelle définition les participants ont de la violence universitaire, 66,8 % soit 267 individus ont affirmé qu’il s’agit d’une menace ou d’une agression en milieu universitaire. Pour 67 individus soit 16,7%, la violence renvoie à une atteinte à l’intégrité physique et morale. 36 individus (≈ 9%) affirment que tout mauvais comportement envers autrui est une violence. 43 individus (10,8%) pensent que la violence universitaire est toute nuisance envers une des composantes de l’université alors 24 individus (6%) perçoivent la violence universitaire comme une violence entre étudiants et enseignants. 6 individus (1,5%) sont classés « autres » car ils évoquent plutôt la cause que la définition. En effet, ils affirment que la violence est due au non-respect de l’ordre au restaurant.
Les résultats montrent que les individus sont bien conscients de ce qu’est la violence, mais l’appréhendent de différentes manières, probablement à partir d’expériences personnelles ou de trait de caractère (ou de personnalité) afférant à chaque individu. Par exemple, pour quelqu’un, bousculer la queue au restaurant universitaire constitue une violence qui mérite d’être soulignée, car pour cette personne, rien ne vaut l’ordre dans l’attente de sa ration alimentaire. Pour cet autre, c’est seulement quand il y’a violence entre étudiants et enseignants qu’il en prend conscience. Le tableau qui suit nous donne un aperçu des définitions données à la violence par les différents participants.
Tableau n°1 : Définitions de la violence
| Qu’est-ce que selon vous la violence universitaire ? | Fréquence | % |
| Menace ou agression en milieu universitaire | 267 | 66.8 |
| Atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes | 67 | 16.7 |
| Mauvais comportements en général | 36 | 9 |
| Violences entre étudiants et enseignants | 24 | 6 |
| Autres | 6 | 1.5 |
| Total | 400 | 100 |
L’idée d’une perception de la violence liée à l’appartenance à une composante nous a effleurée car nous savons que l’affiliation à un groupe crée une identité. C’est pourquoi nous avons effectué une Anova qui indique de manière globale que la différence de définition entre les différentes composantes du groupe enquêté est significative : F (3, 396) = 9,36 ; p < .0001. Mais cette différence devient relative quand on fait un test de comparaisons multiples. Ainsi par exemple, quand on compare la définition de la violence entre les Enseignants – chercheurs (EC) et le Personnel administratif et technique (PAT), aucune différence statistique significative n’est observée, idem entre les étudiants et la population ou entre les PAT et la population. Par contre, on observe une différence statistique entre la perception de la violence chez les EC et les étudiants ((I – J) = 1 ; p < .0001) ; entre les EC et la population ((I- J) = .780 ; p < .002) ; entre les PAT et les étudiants ((I –J) = .760 ; p < .003).
Tableau n°2 : différence de définition entre les composantes
| Variable dépendante | (I) identité | (J) identité | Différence de M (I-J) | P |
| Définition de la violence universitaire | EC | PAT | ,240 | 1 |
| EC | Etudiants | 1,000 | ,000 | |
| EC | Population | ,780 | ,002 | |
| PAT | Etudiants | ,760 | ,003 | |
| PAT | Population | ,540 | ,073 | |
| Etudiants | Population | ,220 | 1 |
- La responsabilité partagée
Cette question est le but premier de ce travail. Conformément au modèle d’Epstein (op.cit.), il convient de se demander à qui incombe la responsabilité de la violence en milieu scolaire. Selon ledit modèle, les trois contextes que sont la famille, l’école et la communauté peuvent se rapprocher ou s’éloigner en fonction des forces qui s’exercent les unes sur les autres, ou en fonction des pratiques propres à chaque contexte. En ce sens, la violence représente un système en interaction avec le contexte familial et le contexte communautaire.
La réponse à cette question est cruciale pour apporter éventuellement des solutions durables et adéquates à la violence universitaire au Niger. Dans le questionnaire soumis, nous avons posé ceci : « la violence en milieu universitaire provient selon vous d’une responsabilité partagée entre la famille, l’université, la société et les Hommes politiques ; veuillez indiquer, celui qui selon vous est le plus responsable ».
Les résultats obtenus qui confortent par ailleurs notre hypothèse, dévoilent que la responsabilité de la violence en milieu universitaire est imputée dans l’ordre à la famille (62.5%), aux Hommes politiques (21.25%), à l’école ici l’Université (10%) et enfin à la société (6.5%). Le tableau qui qui suit nous donne un aperçu des résultats
Tableau n°3 : la responsabilité partagée
| Responsabilité de la violence | Fréquence | % |
| La famille | 250 | 62.5 |
| Les Hommes politiques | 85 | 21,25 |
| L’Université | 40 | 10 |
| La société | 25 | 6.25 |
| Total | 400 | 100 |
Afin de mieux comprendre cette imputation de responsabilité aux différents auteurs, nous avons demandé aux enquêtés d’expliquer en quoi consiste la responsabilité de la famille, de la communauté, des Hommes politiques et de l’Université. Il ressort ainsi les explications suivantes :
- La responsabilité de la famille
83,3% des personnes interrogées affirment que la famille a manqué de jouer son rôle d’éducation, de conseil et de sensibilisation. ≈ 16,8% indiquent que la famille a des défaillances dans ses responsabilités. Ces résultats témoignent quelque part, qu’il existe des ratés dans l’éducation donnée par les familles qui conduisent à l’expression de la violence. De ce fait, les familles doivent être en mesure d’assumer leur responsabilité vis-à-vis des actes posés par leurs enfants. D’une manière générale, il est reproché à la structure familiale sa démission dans l’éducation des enfants. Ces données sont présentées dans le tableau n°2 ci-dessous.
Tableau n°4 : responsabilité de la famille
| Responsabilité de la famille | Fréquence | % |
| Faiblesses dans l’éducation et la sensibilisation | 333 | 83,3 |
| Défaillance dans la prise de responsabilité | 67 | 16,8 |
| Total | 400 | 100 |
- La responsabilité de la société
Les griefs contre la société sont nombreux. En effet, 166 individus soit 41,5% pensent que la violence est due à l’abandon par la société de son rôle de sensibilisation et de moralisateur du comportement. 90 individus soit 22,5% affirment que la violence vient du fait que la société ne se mobilise pas contre la violence. 65 individus soit 16,3% jugent que la violence vient du manque de structure d’adaptation sociale et 54 (13,5%) affirment que la société manque de promotion de la cohésion sociale. Seuls 6,3% soit 25 individus estiment la violence survient du fait que la société ne vulgarise pas les lois et règlements. Les présents résultats indiquent à souhait les attentes individuelles vis-à-vis de la société et montrent que la violence résulte d’une déstructuration sociale. Nous pensons qu’en abandonnant son rôle « social » traditionnel, la société crée un vide (conscient ou inconscient) au niveau individuel. Le vide est stressant et chaque individu va le combler à sa manière ; certains par la violence. Un résumé est proposé ci-dessous.
Tableau n°5 : responsabilité de la société
| Responsabilité de la société | Fréquence | % |
| Abandon de son rôle de sensibilisation du public et moralisation | 166 | 41.5 |
| Manque de mobilisation contre la violence | 90 | 22.5 |
| Manque de structure d’Adaptation/Réadaptation | 65 | 16.3 |
| Manque de promotion de la cohésion sociale | 54 | 13.5 |
| Manque de vulgarisation des lois et règlements contre la violence | 25 | 6,3 |
| Total | 400 | 100 |
- La responsabilité de l’Université
La responsabilité de l’Université vient du manque de sensibilisation sur la violence 48,5%, puis du manque de règlementation et d’application des textes 24,5%. 19% affirment que la violence à l’université provient d’un manque de promotion des normes de la paix et du vivre ensemble alors que 8% indiquent que la violence est due à un manque de spécialistes pour lutter contre la violence. Nous remarquons une perception plus formalisée du rôle de l’Université avec une règlementation sur la base de textes. Cette vision est logique. Les propositions sont présentées dans le tableau n°4 qui suit.
Tableau 6 : responsabilité de l’université
| Responsabilité de l’université | Fréquence | % |
| Manque de sensibilisation des étudiants | 194 | 48.5 |
| Manque de réglementation et d’application des textes | 98 | 24.5 |
| Manque de promotion de la paix et du vivre ensemble | 76 | 19 |
| Manque de spécialistes pour lutter contre la violence | 32 | 8 |
| Total | 400 | 100 |
- La responsabilité des Hommes politiques
Selon les informations recueillies, la responsabilité des Hommes politiques réside dans le fait de politiser l’Université (38%), puis celui d’affecter de crédits insuffisants (31%). 109 individus soit 27.3% pensent que la responsabilité des Hommes politiques dans la violence est imputable à leur manque de franchise dans le dialogue qu’ils tiennent avec les universitaires. Cette irresponsabilité crée des frustrations qui s’extériorisent et se matérialisent au moindre contact entre les étudiants. Seuls 3.8% de l’échantillon affirment que la responsabilité des hommes politiques n’a aucune incidence. Les répondants à cette étude prouvent qu’ils sont conscients de l’implication des politiciens dans le climat qui prévaut à l’Université. Le tableau n°7 présente les différentes réponses
Tableau 7 : responsabilité des Hommes politiques
| Responsabilité des Hommes politiques | Fréquence | % |
| Politisation du milieu universitaire | 152 | 38 |
| Insuffisance des moyens mis à disposition de l’Université | 124 | 31 |
| Manque de dialogue franc avec les composantes de l’Université | 109 | 27.3 |
| Aucune incidence | 15 | 3.8 |
| Total | 400 | 100 |
Sur cette question de responsabilité des Hommes politiques, il est intéressant de noter que 332 individus soit 83% de la population enquêtée ont répondu oui à la question de savoir si les Hommes politiques s’ingèrent de manière générale dans la vie estudiantine.
- Discussion
De cette étude, il apparaît que les individus ont une bonne connaissance de ce qu’est la violence en milieu universitaire. Cependant, la définition que les individus ont de cette violence peut être différente d’un individu à un autre, ou d’un groupe à un autre. Nous avons tous une perception différente des choses selon que nous sommes acteurs ou observateurs, car nous ne disposons pas des mêmes informations. L’attitude (donc l’évaluation) envers une chose est fonction d’un paramètre (cognitif, conatif ou affectif), de deux ou des trois mis ensemble. C’est pourquoi, même si l’idée de l’utilisation de la force constitue la trame d’une définition, elle se rattache à autre chose. La définition donnée à la violence est liée nécessairement à un background, un vécu, une personnalité.
Les résultats obtenus ayant démontré une différence significative dans la définition de la violence entre les différentes composantes, nous pensons qu’il serait judicieux d’en tenir compte et de prévoir des actions ciblées.
Notre vision de la responsabilité partagée permet d’éviter une vision fragmentée qui biaisera toute recherche de solution. Bouchamma, Ilna et Moisset dans une étudeconduite en Haïti sur la violence en milieu scolaire sont arrivés à des conclusions similaires aux nôtres. En effet, selon ces auteurs, les participants attribuent les causes de la violence scolaire plus à des facteurs externes à l’école (dans l’ordre : à la famille, à la société et aux élèves) qu’à des facteurs qui lui sont internes. Ainsi donc, il convient de noter l’importance d’une synergie interactionnelle qui permet de repenser l’apport de la famille d’abord, de la société ensuite et de l’Université enfin. Ces conclusions nous orientent à proposer de revenir au mode traditionnel nigérien de prise en charge de l’individu qui faisait d’un enfant, autant le fils d’une famille, mais aussi celui d’un clan, d’une société. La réappropriation des valeurs traditionnelles nigériennes permettra la construction ou la reconstruction d’une personnalité en adéquation avec le groupe à travers les différents mécanismes d’influence sociale. Dupâquier pointe le manque de sens moral des élèves, le manque de repères, de normes et de valeurs, Lindstrom, Campart et Mancel abondent dans le même sens. Si nous émettons des réserves sur le sens moral, nos résultats s’accommodent du manque de repères, des normes et des valeurs, car dans une société en crise comme nous l’avons souligné, cela se comprend. La responsabilité des familles et au-delà, de la société se trouve dans leur rôle d’éducation dans son sens le plus complet.
Coslin, Gasparini, Caouette, Kuntz, Demenet ont relié la violence en milieu scolaire au manque de formation de certains acteurs du système, en l’occurrence, à l’incapacité des enseignants et à leur manque de performance dans la gestion de l’enseignement. Ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle les établissements les plus affectés par la violence sont ceux où les élèves jugent le plus négativement les enseignants. Roy et Bovin cités par Hébert ont conclu que le comportement de certains professeurs peut être parfois à l’origine de conduites violentes des élèves comme le manque de justice et d’équité envers ceux-ci, l’abus des mesures disciplinaires tandis que Charlot et Emin pensent que l’effritement des relations maître/élève peut expliquer la violence. Une étude dans ce sens pourrait s’avérer utile dans notre contexte.
Les participants à cette étude ont souligné une défaillance dans l’éducation familiale et sociétale qui serait source de violence chez les étudiants. Nous avons souligné dans la problématique que la société nigérienne en général traverse une crise. Certains auteurs comme Gasparini affirment que la violence en milieu scolaire s’inscrit dans la crise sociale en général et en particulier dans les familles. Mucchielli, affirme que la pauvreté des familles est un facteur incubateur de la violence en milieu scolaire tandis que le faible niveau culturel des parents constitue une source de violence chez les scolaires (Coslin). Il nous a manqué de tester ces variables qui auraient pu enrichir ce travail bien que nous ayons eu à souligner les conditions des familles. Ces différentes études bien que conduites dans des milieux scolaires ne peuvent pas être directement transposables dans le milieu universitaire. Mais elles peuvent servir de tremplin à la réflexion et à la recherche de solutions.
Certains auteurs mettent en avant des solutions qui s’appliquent prioritairement ou exclusivement à une des composantes que nous avons prises en compte. C’est ainsi que des mesures de prévention qui concernent l’élève (ou l’étudiant) tournent autour de la promotion des grandes valeurs auprès des jeunes (Kuntz), de la disponibilité de l’éducation morale aux scolaires violents (Coslin; Fontaine et Jacques), de la conscientisation des élèves aux conséquences de la violence (Doudin et Erohen-Marküs) et de leur implication dans les moyens de lutte contre la violence (Simpson).
Concernant les solutions relatives à la famille, elles portent sur l’identification et l’accompagnement des familles à problèmes (Rainville) et sur la sensibilisation aux conséquences de la violence (Hébert). Coslin souligne que la responsabilité de l’éducation des enfants incombe en premier lieu aux parents et ce, malgré la disponibilité des centres de formation pour les élèves.
Leverett et Larry, prônent uniquement les moyens de prévention axés sur l’école notamment sur l’organisation des activités parascolaires pour impliquer les élèves tandis que Lindstrom, Campart et Mancel parlent d’améliorer le climat de l’école en impliquant les enseignants et les chefs d’établissements scolaires.
Ces études bien qu’enrichissantes restent partielles par rapport à nos résultats. En effet la responsabilité partagée suppose que tous les acteurs soient impliqués dans la prise en charge proportionnellement à l’implication de chacun. Concernant cette étude, nous préconisons une vision conjuguée débouchant sur une action conjuguée. A partir du moment où les parties en présence (étudiants, enseignants, PAT, société) ont souligné l’influence partagée, il est nécessaire de traiter globalement l’équation. Cette vision rejoint celle de Maati et Lakhdar concernant la violence au sein des campus universitaires au Maroc. Ces auteurs préconisent, entre autres, une vision commune acceptée par toutes les parties dans le cadre d’un vivre ensemble, une focalisation sur les aspects pratiques et une mise en œuvre d’activités pratiques communes.
Conclusion
Il faut rappeler que les résultats obtenus, imputent dans l’ordre la responsabilité de la violence en milieu universitaire est imputée à la famille (62.5%), aux Hommes politiques (21.25%), à l’école ici l’Université (10%) et enfin à la société (6.5%). Il est important de souligner que 83,3% des personnes interrogées affirment que la famille a manqué de jouer son rôle d’éducation, de conseil et de sensibilisation alors que 41,5% pensent que la violence est due à l’abandon par la société de son rôle de sensibilisation et de moralisateur du comportement. 83% de la population enquêtée affirment que les Hommes politiques de mêlent de la vie estudiantine.
Il importe de souligner quelques limites à cette étude, notamment l’échantillon non représentatif de la population générale du Niger et/ou des Universités, le caractère exploratoire de l’étude, donc il manque de données disponibles pouvant servir de recul. Nous soulignons une limite qui peut aussi être une force. L’étude s’est faite au moment même où les violences avaient atteint un summum. Donc il s’agit de réaction à chaud qui permet d’avoir des renseignements actuels, sans détour, mais d’un autre côté, les émotions peuvent jouer un rôle perturbateur.
Des recherches ultérieures s’appuyant sur ces résultats pourraient permettre d’avoir des solutions concrètes et idoines aux manifestations de violence en milieu universitaires et aussi de conduire des études actions.
Travaux cités
Bouchamma, Yamina, Daniel Ilna et Jean-Joseph Moisset. Education et francophonie, 32. 1 (2004).
Caouette, Charles E. Si on parlait d’éducation, pour un nouveau projet de société. Montréal : VLB Éditeur, 1992.
Carra, Cécile et François Sicot. « Une autre perspective sur les violences scolaires : l’expérience de victimation ». In B. Charlot et J.-C. Emin (dir.), Violences à l’école : état des savoirs. p. 61-81. Paris : Armand Colin, 1997.
Charlot, Bernard et Emin Jean-Claude. États des savoirs : Violence à l’école. Paris : Éditions Armand Colin, 2000.
Coslin, Pierre G. « Enseignants et élèves face à la violence scolaire ». Bulletin de Psychologie, 52,5, n°443, (1999) : 523-530.
Demenet, P. (2001). La défaite des profs karatékas. http://www.unesco.org/courier/2001_04/fr/education3.htm
Doudin, Pierre André et Miriam Erkohen-Marküs. Violences à l’école : Fatalité ou défi ? Bruxelles : De Boeck, 2000.
Dupâquier, Jacques. La violence en milieu scolaire. Paris : Presses Universitaires de France, 1999.
Epstein, Joyce L. “School, Family, and Community Partnerships: Caring for the Children we share”, Phi Delta Kappan, 76 (1995): 701-712.
Galand, Benoît. Nature et déterminants des phénomènes de violence en milieu scolaire. Thèse de doctorat non publiée, Université catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique, 2001.
Gasparini, Rachel. Ordres et désordres scolaires. La discipline à l’école primaire. Paris : Grasset, 2000.
Kuntz, L. I. Zéro de conduite. 2000. http://pluto.unesco.org/courier/200001fr/apprend/txtl.htm
Lapointe, François. Violence à l’école primaire et mesures préventives. Mémoire de maîtrise, inédit. Université Laval, Québec, 2002.
Lecacheur, Mireille . « La maitresse d’école maternelle à travers le jugement de ses élèves ». Bulletin de Psychologie, 35 (1981) : 221-227.
Lindstrom, Peter, Martina Campart et Catherine Mancel. “Brimades et violence dans les écoles suédoises : Une revue des recherches et des politiques de prévention ; La violence à l’école : approches européennes. » Revue française de pédagogie, 123 (1998) : 79-91.
Maati, Monjib et Lakhdar Ghettas. Contribution à la réduction de la violence au sein des campus universitaires au Maroc, Istanbul, 18 et 19 mars 2017.
Michaud, Yves. Violence et politique. Paris : Gallimard, 1978.
Mucchielli, Laurent. « De la peur à l’analyse : l’école ne brûle pas. » Le Monde diplomatique, 2002.
Olweus, Dan “Sweden”, in Peter K Smith et al. (eds.) The Nature of School Bullying: A Crossnational Perspective. London, Routledge. (1999) : 2-27.
Postic, Marcel. La relation éducative. Paris, PUF, 1979.
Rainville, Suzanne. L’abandon d’enfant. Dépister, accepter, accompagner. Montréal : Sciences de l’éducation et culture, 2001.
Comment citer cet article :
MLA : Mayaki, Fatchima. “Violence en milieu universitaire au Niger.” Uirtus 1.1 (août 2021): 230-243.
§ Université Abdou Moumouni de Niamey, [email protected]