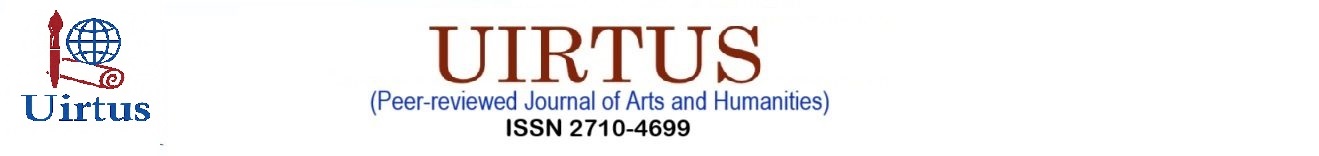Mathias Kei§
Résumé : Cet article analyse l’impact de la représentation de l’enseignant sur l’implication aux études chez les étudiant-e-s du premier cycle inscrit-e-s dans les filières de Criminologie et d’Economie générale de l’Université Félix Houphouët-Boigny. L’analyse de données recueillies par questionnaire auprès de 256 sujets révèle que les dimensions « identification personnelle aux études » et « valorisation des études » entretiennent des liens significatifs avec la représentation de l’enseignant. En d’autres termes, la représentation qu’entretient l’étudiant de son enseignant joue un rôle fondamental dans son implication sur les dimensions indiquées. En ce qui concerne la dimension « capacité perçue d’action sur les études », les résultats infirment notre hypothèse. Il n’existe donc aucun lien entre cette dimension et la représentation de l’enseignant. Toutefois, les résultats obtenus permettent de formuler des recommandations au niveau des pratiques d’enseignement et d’encadrement des étudiants afin de favoriser leur implication aux études.
Mots-clés : Social représentations, enseignant, étudiant, implication personnelle
Abstract: This article analyzes the impact of teacher representation on study engagement among ndergraduate students enrolled in of Criminology and General Economics at Félix Houphouët-Boigny University. Analysis of data collected by questionnaire from 256 subjects reveals that the dimensions “personal identification with studies” and “valuation of studies” have significant links with the representation of the teacher. In other words, the student’s representation of his teacher plays a fundamental role in his involvement in the dimensions indicated. Regarding the dimension “perceived ability to act on studies”, the results invalidate our hypothesis. There is therefore no link between this dimension and the representation of the teacher. However, the results obtained allow recommendations to be made in terms of teaching and supervision practices for students in order to promote their involvement in studies.
Keywords: Representation, Teacher, Student, Personal Involvement
Introduction
Dans la hiérarchie des grandes problématiques sociales que se pose le monde actuellement, l’éducation vient immédiatement après la croissance économique (Lis-Zonabend). En effet, ces dernières années, les universités en général et celles en Afrique en particulier, font face aux questions d’échecs scolaires.
En Côte d’Ivoire, notamment à l’Université Félix Houphouët Boigny, les statistiques indiquent 62.84% de redoublants en licence 1 ; 69.19% en licence 2 et 55.03% en licence 3 pour la faculté de Criminologie (année académique 2012-2013). En Economie Générale, ce sont 100% en licence 1 ; 69.41% en licence 2 et 68.63% en licence 3, pour ne citer que ces facultés (Direction de la Planification et de l’Evaluation, Annuaire Statistique de l’Enseignement Supérieur, Décembre 2014). Face à cette situation, le taux d’échec, traduit par le la non validation de l’année d’études, atteint en première année universitaire, en Côte d’Ivoire, conduit à s’interroger sur le degré d’implication des étudiants dans les études universitaires.
Considérée comme une attitude comportementale qui permet de fournit un contexte favorable à l’amélioration de la qualité de l’enseignement (Shagholi et al.), l’implication a fait l’objet de nombreuses études dans le contexte universitaire. Pour la cerner au mieux, plusieurs facteurs ont été mis en avant. A ce sujet, V. Tinto propose un modèle explicatif basé sur l’intégration de l’étudiant. Cet auteur, pour sa part, propose un modèle interactionniste qui prend en compte les concepts d’intégration et d’appartenance à la communauté universitaire (Schmitz et al.). Il utilise le concept d’implication pour expliquer l’abandon des études à l’Université, et conclut que l’intégration sociale et intellectuelle de l’étudiant dans l’établissement (désignée également par l’implication) constitue un facteur important de persévérance pour lui. Ses conclusions montrent que l’étudiant adopte davantage une attitude de persévérance lorsqu’il est en interaction avec l’ensemble des parties prenantes de son établissement.
Dans la suite de son analyse, il dissocie l’intégration sociale de l’intégration académique. Il montre que la première est liée aux facteurs stimulés par l’interaction entre l’étudiant et les enseignants ou entre l’étudiant et l’administrationainsi que la participation aux activités socio-culturelles. Quant à la seconde, il mentionne qu’elle s’applique aux facteurs de réussite scolaire et est déterminée grâce à la performance scolaire de l’étudiant, à son développement intellectuel, et à son identification par rapports aux principes et règles du système Universitaire. Cette dernière forme d’intégration (académique) peut être mesurée par le degré de congruence entre les valeurs et objectifs de l’étudiant et ceux de l’institution (J. Schmitz et al.).
Pour conclure ses propos, Tinto pense que la difficulté d’intégrer le milieu Universitaire peut mener à l’abandon scolaire. Pour cela, il soutient l’idée selon laquelle, la qualité des expériences vécues par l’étudiant au sein du milieu académique et social (l’intégration académique et sociale) peut modifier l’implication initiale de ce dernier.
Quant à T. Pascarella et P.T. Terenzini, ils assimilent l’implication de l’étudiant à sa participation aux activités pédagogiques et aux interactions qu’il a avec ses enseignants. Ils montrent que les activités qui permettent un meilleur développement scolaire et cognitif sont celles qui favorisent chez lui l’implication.
Dans son analyse sur les facteurs de l’implication des étudiants et la gouvernance des Universités sénégalaises, C.O. Baldé montre que la satisfaction des aspects annexes et de la qualité de l’enseignement influencent significativement l’implication affective des étudiants. Pour ce qui est de l’implication calculée, elle est partiellement influencée par la satisfaction, la participation, la sélection et les caractéristiques individuelles. En revanche, les droits d’étude n’influencent en aucun cas le degré d’implication des étudiants (Baldé, cité par Côme et Abdelilah).
De son côté, A.W. Astin pense que l’implication est un terme « actif » qui renvoie essentiellement à une attitude comportementale à l’opposé de la motivation, qui serait davantage liée à un état psychologique. Pour lui, la notion d’implication se rapporte tout simplement à la quantité d’énergie physique et psychologique que l’étudiant consacre à l’expérience universitaire. Ainsi, un étudiant fortement impliqué est un étudiant qui, par exemple, consacre une énergie considérable à l’étude, passe beaucoup de temps sur le campus, participe activement aux associations des étudiants, et interagit souvent aussi bien avec les membres du corps professoral qu’avec les autres étudiants. Inversement, un étudiant « non impliqué » néglige ses études, passe peu de temps sur le campus, s’abstient de participer aux activités extra-universitaires, et n’entre qu’occasionnellement en contact avec les enseignants et ses camarades (Astin, cité par Côme et Abdelilah).
De l’analyse des facteurs ci-dessus, nous pouvons soutenir que l’implication des étudiants est déterminée par une pluralité de facteurs. Les résultats de ces recherches montrent que, les facteurs les plus évoqués sont d’ordre social. Ces travaux, bien qu’enrichissants, abordent peu l’approche qui consiste à étudier l’implication chez les étudiants sous l’égide des représentations sociales notamment l’approche structurale d’Abric et de Flament qui s’intéressent àla structure et à la dynamique des représentations sociales c’est à dire la théorie du noyau central. La caractéristique principale de cette théorie, se situe dans l’organisation de la représentation en un double système : le noyau central et le système périphérique. Le noyau centralremplit deux fonctions essentielles dans la structure et la dynamique représentationnelle. Sa fonction organisatrice permet de déterminer la nature des relations qui unissent entre eux les éléments de la représentation. Ce système (ou noyau) central est l’élément unificateur et stabilisateur de la représentation. Sa fonction génératrice précise la signification de chaque élément du champ représentationnel. Le système périphérique quant à luiest composé d’un ensemble d’éléments qui permettent l’ancrage de la représentation dans la réalité des sujets sociaux. Ces éléments périphériques présentent une plus grande souplesse que les éléments centraux et sont le lieu de l’individualisation de la représentation, ils interviennent dans les processus de défense et de transformation des représentations (Flament).
Le choix des représentations sociales comme variables explicatives de l’implication chez les étudiants n’est pas un hasard. Ce choix remonte aux travaux de P. Rateau et M.L. Rouquette, qui définissent l’implication comme le lien entre un sujet et un objet. Or toute relation entre un sujet et un objet est médiatisée par les représentations dans la mesure où elles sont des systèmes d’interprétation qui régissent notre relation aux autres et, orientent les conduites et les communications sociales (Jodelet). En prenant sur cette affirmation, nous posons la question suivante : existe-t-il un lien entre la représentation de l’enseignant et l’implication personnelle des étudiants ? Telle se formule la question à laquelle souhaite répondre cette étude. Notre objectif, pour cette tâche, consiste à déterminer le lien entre la représentation de l’enseignant et l’implication personnelle des étudiants. A partir de cet objectif nous formulons l’hypothèse générale suivante : la représentation qu’entretient l’étudiant à l’égard de son enseignant influence son implication personnelle.
Vu que la variable « implication personnelle » sera analysée sous trois dimensions (voir p.5), l’hypothèse générale formulée ci-dessus autorise la formulation des hypothèses opérationnelles suivantes :
- H1 : Les étudiant-e-s ayant une représentation positive de l’enseignant font preuve d’une forte identification personnelle aux études.
- H2 : Les étudiant-e-s ayant une représentation positive de l’enseignant accordent plus d’importance à leurs études que leurs pairs n’ayant pas une représentation positive.
- H3 : Les étudiant-e-s ayant une représentation positive de l’enseignant assument davantage la responsabilité de leurs études que leurs pairs.
Dans la rubrique qui suit, ces hypothèses seront mises à l’épreuve.
1. Méthodologique
Dans cette section nous présentons les moyens retenus pour atteindre nos objectifs. Nous y abordons les points suivants : le terrain et les caractéristiques des participants, la méthode d’échantillonnage, les instruments de collecte et d’analyse de données.
- Terrain d’étude et caractéristiques des participants
Les étudiants des années de licence 1, 2 et 3 du département de Criminologie et d’Economie générale de l’Université Félix Houphouët Boigny sont les sujets concernés par cette étude. Justification du choix des sujets. En appliquant la méthode d’échantillonnage du « tout venant », nous avons interrogé 256 individus répartis comme suit :
Tableau n°1 : Caractéristiques de l’échantillon
| Niveaux Départe- ments | Genres | Licence 1 | Licence 2 | Licence 3 | Total |
| Criminologie | Etudiants | 21 | 21 | 21 | 63 |
| Etudiantes | 22 | 22 | 21 | 65 | |
| Economie | Etudiants | 21 | 21 | 21 | 63 |
| Etudiantes | 22 | 22 | 21 | 65 | |
| Total | 86 | 86 | 84 | 256 |
Source : Source : Enquête de terrain 2020
1.2. Présentation des variables
Deux variables sont mises en relation dans cette étude : la représentation de l’enseignant et l’implication personnelle.
La représentation de l’enseignant est notre variable indépendante. Elle renvoie aux croyances, à l’image et au jugement que chaque étudiant-e porte sur son enseignant. Cette variable est appréciée suivant deux modalités :
- Représentations sociales valorisantes de l’enseignant ;
- Représentations sociales dépréciatives de l’enseignant.
La représentation de l’enseignant est dite positive lorsque l’étudiant-e entretient à son égard une bonne image et des croyances positives. Dans la situation contraire, elle est dite négative.
L’implication personnelle représente notre variable dépendante. En nous appuyant sur la définition de A. Gruev-Vintila (op. cit), nous la présentons comme étant l’expression individuelle et socialement déterminée du lien entre l’étudiant et l’objet sur lequel il porte son attention (ses études).
- Instruments d’enquête
Deux échelles de mesure composent notre questionnaire d’enquête : la première porte sur la représentation de l’enseignant et la deuxième sur l’implication personnelle.
- Echelle relative à la représentation de l’enseignant-e
Cette échelle est constituée de douze (12) items formulés à partir des éléments issus des entretiens dirigés effectués en amont. Les items positifs sont ceux qui valorisent l’enseignant-e : (exemple « les enseignant-e-s de ma filière sont sympathiques »). A l’opposé, les items négatifs donnent lieu à des propositions qui dévalorisent l’enseignant-e (exemple : « les enseignant-e-s de de ma filière ne sont pas assidus »).
- Procédure d’exploitation de l’échelle
De type nominale, cette échelle évalue l’objet des représentations sociales sous deux angles : valorisant et dépréciatif, à partir de deux niveaux de réponses : d’accord et pas d’accord. Vu que les items ne sont pas tous de même valence (négative ou positive), cela n’autorise pas la conservation du même principe de codification pour tous. En pratique, le code(1) est attribué à la modalité de réponse « pas d’accord » et le code (2) à la modalité de réponse « d’accord », quand les items sont positifs. A l’inverse, le code (1) est attribué à la modalité de réponse « d’accord » et le code (2) à la modalité de réponse « pas d’accord », quand les items sont négatifs. Pour chaque étudiant-e interrogé-e, nous définissons la fréquence globale des codes. Sur cette base, la fréquence modale, c’est-à-dire le code qui se répète le plus, est considérée comme plus caractéristique du type de représentation en jeu. Ainsi, une fréquence plus élevée de « d’accord » par rapport à « pas d’accord » traduit le caractère valorisant des représentations sociales de l’enseignant. A l’opposé, une fréquence plus élevée de « pas d’accord » par rapport à « d’accord » correspond à une représentation dépréciative de l’enseignant.
- Echelle relative à l’implication personnelle
La deuxième échelle évalue l’implication personnelle des étudiant-e-s. Construite sous la forme d’une échelle de type likert, elle est composée de trois (03) dimensions. De manière opérationnelle, elle se présente comme suit :
- L’identification personnelle à l’objet (études)
Cette dimension correspond à la relation de proximité qu’entretient l’étudiant avec ses études. En d’autres termes, le degré par lequel celui-ci est concerné par ces études. On peut la mesurer sur une échelle allant de « je suis personnellement concerné » à « tout le monde est concerné ».
- La valorisation de l’objet (études)
La valorisation de l’objet, ou importance de l’enjeu, renvoie à l’importance de l’enjeu associé aux études. Elle peut être conçue comme une échelle allant de « c’est une question extrêmement importante » à « c’est une question sans importance ».
- La capacité perçue d’action sur l’objet (études)
La capacité perçue d’action, ou possibilité perçue d’action, fait référence au contrôle que l’étudiant peut exercer sur son travail/ses études, sur une échelle allant de « tout dépend de moi » à « je n’y peux rien ».
- Procédure d’exploitation de l’échelle
En effet, chacune des dimensions se comporte comme une sous échelle de type likert avec plusieurs possibilités de réponses.
- Identification personnelle au travail
Quatre possibilités de réponses sont proposées pour cette sous-échelle :
- Très concerné
- Moyennement concerné
- Peu concerné
- Très peu concerné
Les réponses « très concerné et moyennement concerné » traduisent la bonne relation de proximité qu’entretient l’étudiant avec ses études. Par compte, les réponses « peu concerné et très peu concerné » indiquent le contraire.
- Valorisation de l’objet études
- Extrêmement importantes
- Importantes
- Peu importantes
- Pas du tout importantes
Les réponses « extrêmement importantes et importantes » renvoient à l’importance que l’étudiante accorde à ses études. A l’opposé, les réponses « peu importantes et pas du tout importantes » indiquent le contraire.
- Capacité perçue d’action sur l’objet
- Vous-mêmes
- Vos enseignants
- Vos parents
La réponse « vous-mêmes » indique le contrôle que l’étudiant peut exercer sur le déroulement de ses études. Par compte, les réponses « vos enseignants et vos parents » montrent le contraire.
2. Résultats
Deux types d’analyses sont effectués : une analyse descriptive qui permet de comprendre les tendances pour chaque item et une analyse croisée destinée à vérifier le lien entre nos deux variables.
2.1. Analyse descriptive des données
2.1.1. Représentation de l’enseignant
Tableau 2 : Représentation : statistiques par item
| Les enseignants … | D’accord | Pas d’accord | |
| 1 | Sont sympathiques | 196 (76.6%) | 60 (23.4%) |
| 2 | Ne motivent pas les élèves | 101 (39.5%) | 155 (60.5%) |
| 3 | Sont des pédagogues (font bien leur cour) | 179 (69.9%) | 77 (30.1%) |
| 4 | Ne sont pas assidus au cours | 102 (39.8%) | 154 (60.2%) |
| 5 | Maîtrisent le contenu de leur cours | 210 (82%) | 46 (18%) |
| 6 | Sont impartiaux (traitent tous les élèves de la même manière) | 106 (41.4%) | 150 (58.6%) |
| 7 | Harcèlent les filles | 102 (39.8%) | 154 (60.2%) |
| 8 | Sont patients avec les élèves | 144 (56.3%) | 112 (43.8%) |
| 9 | Sont sévères avec les élèves | 177 (69.1%) | 79 (30.9%) |
| 10 | Humilient souvent les élèves | 94 (36.7%) | 162 (63.3%) |
| 11 | Sont agressifs | 104 (40.6%) | 152 (59.4%) |
| 12 | Sont injustes | 89 (34.8%) | 167 (65.2%) |
Source : Enquête de terrain 2020
De l’analyse du tableau n° 2 il ressort que, plusieurs items négatifs détiennent un taux de réponse « d’accord » très élevé. Cela sous-entend que nous sommes en présence d’une représentation de l’enseignant en général négative.
3.1.2. Implication personnelle
Tableau n°3 : Identification personnelle aux études
| Effectifs | Pourcentage | |
| Très concerné Moyennement concerné Peu concerné Très peu concerné Total | 156 | 60.94 |
| 41 | 16.0 | |
| 36 | 14.0 | |
| 22 | 8.6 | |
| 256 | 100.0 |
Source : Enquête de terrain 2020
L’observation du tableau montre que plus de la moitié des sujets interrogés se sentent très concernés par leurs études (156 sujets, soit 60.94%).
Tableau n°4:Valorisation de l’objet études
| Effectifs | Pourcentage | |
| Extrêmement importantes Importantes Peu importantes Pas du tout importantes Total | 79 | 30.7 |
| 116 | 45.31 | |
| 47 | 18.3 | |
| 13 | 5.1 | |
| 256 | 100.0 |
Source : Enquête de terrain 2020
Les statistiques du tableau indiquent que 116, soit 45.31% de l’échantillon d’étudiant-e-s interrogé-e-s considèrent les études importantes.
Tableau n°5 : Capacité perçue d’action sur les études
| Effectifs | Pourcentage | |
| Vous-mêmes Vos enseignants Vos parents Total | 98 | 38.28 |
| 89 | 34.76 | |
| 69 | 26.95 | |
| 256 | 100,0 |
Source : Enquête de terrain 2020
De l’observation du tableau, on constate que 98 étudiant-e-s, soit 38.28% de l’échantillon interrogé estiment que leurs études dépendent d’eux-mêmes.
3.1. Analyse croisée des variables
Tableau n° 6 : Relation entre représentation et identification personnelle aux études
| Identification personnelle aux études | Représentations de l’enseignant | Total | |
| Positive | Négative | ||
| Forte identification personnelle | 73 | 96 | 169 |
| Faible identification personnelle | 33 | 54 | 87 |
| Total | 106 | 150 | 256 |
| Chi2 = 30.76 ddl =1 p = .05 Chi2 théorique = 3.84 |
Source : Enquête de terrain 2020
A 1 degré de liberté (ddl) et au seuil de probabilité .05, la valeur du Chi2 (30.76) calculé est supérieure à la valeur théorique (3.84). Il y a donc un lien statistiquement significatif entre la représentation que l’étudiant-e a de l’enseignant et son identification personnelle aux études. Notre hypothèse opérationnelle (H1) est donc confirmée.
Tableau n°7 : Relation entre représentation et valorisation de l’objet études
| Valorisation de l’objet études | Représentations de l’enseignant | Total | |
| Positive | Négative | ||
| Forte valorisation | 41 | 102 | 143 |
| Faible valorisation | 53 | 60 | 113 |
| Total | 94 | 162 | 256 |
| Chi2 = 15.49 ddl =1 p = .05 Chi2 théorique = 3.84 |
Source : Enquête de terrain 2020
A 1 degré de liberté (ddl) et au seuil de probabilité .05, la valeur du Chi2 (15.49) calculé est également supérieure à la valeur théorique (3.84). Il y a donc un lien significatif entre l’importance accordée aux études et la représentation qu’entretient l’étudiant-e de son enseignant. Notre deuxième hypothèse opérationnelle est également confirmée.
Tableau n°8 : Relation entre représentation et capacité perçue d’action sur les études
| Capacité perçue d’action sur les études | Représentation de l’enseignant | Total | |
| Positive | Négative | ||
| Forte capacité perçue d’action | 58 | 98 | 156 |
| Faible capacité perçue d’action | 76 | 24 | 100 |
| Total | 134 | 122 | 256 |
| Chi2 = 2.78 ddl =1 p = .05 Chi2 théorique = 3.84 |
A 1 degré de liberté (ddl) et au seuil de probabilité .05, la valeur du Chi2 (2.78) calculé est inférieure à la valeur théorique (3.84). Il n’y a donc aucun lien entre la représentation qu’entretient l’étudiant-e de son enseignant et sa capacité d’action sur ses études. Notre troisième hypothèse opérationnelle n’est donc pas confirmée.
3. Discussion
L’analyse des données révèle que la dimension « identification personnelle aux études » de l’implication entretient un lien avec la représentation de l’enseignant (Voir tableau n°6). En nous appuyant sur le sens de notre première hypothèse opérationnelle, cela suppose que la motivation de l’étudiant à s’impliquer davantage dans ses études dépend, selon les résultats de cette étude, de sa représentation de l’enseignant.
Au niveau du tableau VII, les résultats montrent que l’importance de l’enjeu associé aux études (valorisation des études) dépend également de la représentation que l’étudiant entretient à l’égard de son enseignant, ce qui confirme notre deuxième hypothèse opérationnelle de recherche. De l’hypothèse 1 à 2, les analyses montrent que les cognitions sociales à propos de l’enseignant sont des vecteurs d’orientation du comportement d’implication des étudiants. Ces résultats montrent également que les représentations sociales sont prédictives de l’implication. Plusieurs autres études peuvent permettent de confirmer davantage ces résultats.
Selon P. Cres, l’activation d’un élément central d’une représentation peut être déterminée par un ensemble de facteurs : la finalité de la situation, le contexte d’énonciation, la réversibilité perçue de la situation et la distance à l’objet. L’implication s’intègre dans cette dernière (Dany).
Pour S. Baggio (16), l’implication personnelle joue un « rôle fondamental dans l’expression et la dynamique des représentations sociales » et, c’est cela qui en fait un facteur dont la prise en compte apparaît désormais primordiale dans l’analyse des processus intervenant dans l’organisation des formes de la pensée sociale et, en particulier, des représentations sociales. En effet, cette variable interviendrait sur la formation et la structuration des représentations (Flament et Rouquette) et pourrait aussi, à son tour, être affectée par la nature de ces dernières (Baggio; A. Gruev-Vintila). C’est dire que les représentations sociales sont également des agents modulateurs de l’implication.
Les résultats du tableau VIII indiquent qu’il n’existe aucun lien significatif entre la « capacité perçue d’action sur les études », troisième dimension de l’implication personnelle, et la représentation que l’étudiant entretient de l’enseignant. Notre troisième hypothèse opérationnelle est donc infirmée. Les résultats obtenus à ce niveau vont dans le sens opposé de notre hypothèse. Toutefois, nous ne pouvons affirmer avec certitude que cette dimension n’entretient aucune relation avec la représentation. Nous pouvons simplement noter que les étudiant-e-s interrogés dans notre contexte n’établissent aucun rapport entre responsabilité face aux études et représentations de l’enseignant. En effet, plusieurs autres hypothèses pourraient être émises. On pourrait, par exemple, dire que les étudiant-e-s ayant une représentation positive de leur enseignant estiment davantage que leurs études dépendent de lui, et celle-ci pourrait être confirmée.
Au-delà de tous ces aspects, il faut tout de même savoir que les résultats de cette étude n’obtiennent pas un écho favorable chez tous les chercheurs. En effet, pour V. Tinto, l’implication est une variable centrée sur l’intégration de l’étudiant. Pour l’auteur, la qualité des expériences vécues par l’étudiant au sein du milieu académique et social (l’intégration académique et sociale) peut modifier l’implication initiale de ce dernier. Il est donc essentiel de veiller à une bonne intégration de l’étudiant dès son arrivée à l’université. De même, Pascarella et Terenzini assimilent l’implication de l’étudiant à sa participation aux activités pédagogiques et aux relations qu’il entretient avec ses enseignants. Ces auteurs estiment que les activités qui permettent un meilleur développement scolaire et cognitif sont celles qui favorisent l’implication chez l’étudiant. Chez C.O. Baldé, la satisfaction des aspects annexes et de la qualité de l’enseignement sont les paramètres qui influencent significativement l’implication affective des étudiants. Aussi, bien qu’ils ne soient pas mis en avant dans cette étude, les résultats obtenus dans cette étude sont aussi essentiels dans l’analyse de l’implication des étudiants.
Conclusion
L’objectif de notre analyse est de montrer que la représentation que l’étudiant a de l’enseignant influence son implication envers ses études. Sur les trois dimensions de l’implication mises en relation avec la représentation, les deux premières hypothèses se sont avérées confirmées. Cela suppose que l’importance accordée aux études et la volonté de s’y impliquer dépendent des opinions et croyances que chaque étudiant-e a de son enseignant. La troisième dimension (capacité perçue d’action) n’entretient aucun lien avec la représentation. Les résultats obtenus à ce niveau ne confirment pas notre hypothèse. Avant de songer à une extrapolation des résultats obtenus, il serait convenable de conforter ces derniers de manières suivantes :
- En étendant l’expérimentation à toutes les universités du pays.
- En utilisant une technique d’échantillonnage plus élaborée
- En prenant le soin de neutraliser un plus grand nombre de variables parasites
Toutefois, il faut retenir que les résultats de cette étude peuvent avant tout servir de base à la formulation de recommandations au niveau des pratiques d’enseignement et d’encadrement des étudiants.
Travaux cités
Abric, Jean Claude. Méthodes d’études des représentations sociales, Saint-agne, Erès, 2003.
Astin, Alexander W. Student Involvement: A Developmental Theory for Higher Education: An Empirical Typology of College Students, Journal of College Student Personnel, 25.4, (1984) : 297-308.
Baggio, Stéphanie. Pensée sociale et risques collectifs: Effets de l’implication personnelle sur la construction sociale des catastrophes naturelles. Unpublished thesis, Ecole doctorale 261, Cognitions, Comportements, Conduits Humaines, Université Paris Descartes, Paris, 2006.
Balde, Cheikh Oumar. Facteurs d’implication des étudiants et la gouvernance des universités : l’exemple du Sénégal. Thèse de doctorat. Université de Reims Champagne-Ardenne, 2011.
Côme, Thierry et Abdelilah Yassine. Accès régulé à l’Université et implication et motivation des étudiants : l’exemple du Maroc, Revue Gestion et Management Public, 3.4 (2015) : 5-26
Cres, Philippe. Représentation sociale des études et recherche exploratoire sur l’implication vis-à-vis des études, Diplôme d’Etat de Conseiller d’Orientation-Psychologue, Université de Provence, 2007.
Dany, Lionel. La drogue et le cannabis : approche psychosociale. Thèse de doctorat, Université de Provence, 2006.
Flament, Clade. Le questionnement lorsque l’on étudie les représentations sociales. Séminaire de laboratoire de recherche, juin 2003. L.P.S. de Grenoble-Chambéry, 2003.
Flament, Claude et Michel-Louis Rouquette. Anatomie des idées ordinaires, Comment étudier les représentations sociales, Paris : Armand Colin, 2003.
Gruev-Vintila, Andreea. Dynamique de la représentation sociale d’un risque collectif et engagement dans les conduites de réduction du risque: Le rôle des pratiques, de l’implication et de la sociabilité. Unpublished thesis, Ecole doctorale 261, Cognitions, Université Paris Descartes, Paris, 2005.
Jodelet, Denise. Les représentations sociales. Paris: Les Presses universitaires de France, 1989.
Lis-Zonabend, Françoise. Lycéens de Dakar, essai de sociologie de l’éducation. Paris : Maspero, 1968.
Pascarella, Ernest T. et Patrick T. Terenzini. Comment le collège affecte les étudiants; v. 2: Une troisième décennie de recherche. San Francisco: Jossey-Bass, 2005.
Rateau, Patrick. Psychosociological anchoring and structural dynamics in social representations of the heterosexual/homosexual couple.Revue Suisse de Psychologie, 63. 1 (2004) : 43-51
Rouquette, Michel-Louis. La chasse à l’immigré : Violence, mémoire et représentations. Liège : Mardaga, 1997.
Schmitz, Julia, et al. Étude de trois facteurs clés pour comprendre la persévérance à l’université, Revue Française de Pédagogie, (3), 172 (2010) : 43-61.
Shagholi, Reihaneh, et al. The consequences of organizational commitment in education, Procedia Social and Behavioral Sciences, (15), (2011) : 246-250
Tinto, Vincent. Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition, 2nd ed., Chicago: University of Chicago Press, 1993.
Comment citer cet article :
MLA : Kei, Mathias. ” Représentations sociales de l’enseignant et implication aux études : l’exemple des étudiant-e-s de l’UFHB d’Abidjan.” Uirtus 1.1 (août 2021): 261-276.
§ Université Felix Houphouët-Boigny, [email protected]