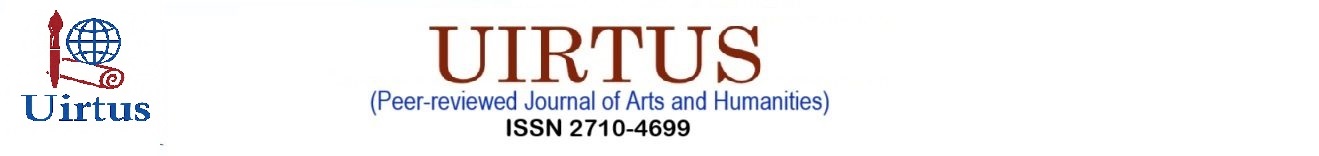Guy Moussavou§
Résumé : Notre article porte sur la dimension cachée de la pédagogie dans la circonscription scolaire de Ouenzé 2 à Brazzaville. Cette dimension cachée est entendue comme l’ensemble des situations non prévues par l’enseignant dans sa préparation pédagogique et qui se produisent dans le processus enseignement-apprentissage, obligeant l’enseignant à y faire face pour faire la classe. L’objectif principal de cette recherche consiste à mettre en évidence les caractéristiques de la dimension cachée de la pédagogie et son impact sur le processus enseignement-apprentissage. Il s’agit aussi de vérifier si les maîtres en ont conscience dans leurs pratiques quotidiennes en classe. L’observation et l’entretien nous ont servi d’instruments de collectes de données. L’examen des faits observés auprès des maîtres et la description faite de leur pratique ont révélé que le travail enseignant ne peut s’exonérer de la dimension cachée de la pédagogie, car elle est intrinsèque à toute pratique pédagogique au point où elle passe inaperçue. La prise de conscience de la dimension cachée de la pédagogie, loin d’être un casse-tête, peut devenir une valeur ajoutée sur la gestion et l’autorité du maître. Pour ce faire, il est nécessaire de revoir la formation des maîtres, de les conscientiser et de recontextualiser la notion de classe pour augmenter l’efficacité pédagogique de nos maîtres.
Mots-clés : Dimension prescrite, dimension cachée, réalité de la classe, activité enseignante
Abstract: Our study focuses on the hidden dimension of teacher education Ouenze 2 in Brazzaville. This concept is defined as “the set of unanticipated situations that occur in the teaching-learning process that the teacher faces”.
The objectives of this study were to highlight the characteristics of the hidden dimension and its impact on the teaching-learning process. It was also a question of checking if the masters are aware of it. Observation and interview have served as instruments of investigation. Examination of the facts observed with teachers and the description they have given of their practice revealed that teaching work cannot be exonerated from the hidden dimension of pedagogy because it is intrinsic to any pedagogic practice to the point where it goes unnoticed. Awareness of the hidden dimension, far from being a puzzle, can become an added value on the management and authority of the master. To do this, it is necessary to review the training of teachers, to raise awareness and recontextualize the notion of class to increase the educational effectiveness of our teachers.
Keywords: Prescribed Dimension, Hidden Dimension, Reality of Classroom, Teaching Activity
Introduction
En s’émancipant de la philosophie, la pédagogie a fini par se donner un objet d’étude, des méthodes d’investigation et un vocabulaire qui est, aujourd’hui, largement partagé avec d’autres sciences. En définissant la pédagogie comme toute action d’une personne destinée à favoriser l’apprentissage d’autrui, Vergnioux, Piot et Bodergat stipulent qu’« avec un peu plus d’un siècle d’histoire, la pédagogie s’est progressivement construite théoriquement, pratiquement et méthodologiquement et a gagné en légitimité dans ses propositions pratiques ». Mais, dans la mesure aussi où le domaine de la pédagogie est de s’intéresser à l’interaction humaine, où la présence de l’autonomie des acteurs peut être envisagée « comme un levier essentiel de la réussite, elle doit admettre et intégrer dans sa réflexionune part d’incertitude contrôlée et accorder ses démarches à un principe de rationalité limitée » (Vergnioux, Piot et Bodergat).
Ainsi va-t-il de la dimension cachée de la pédagogie qui aujourd’hui veut mettre en lumière certaines facettes du travail enseignant dont l’enseignant lui-même, engagé dans son activité en classe, n’a pas conscience. Guidé par les ressources issues de la formation professionnelle initiale, l’enseignant a du mal à se soustraire de la routine quotidienne de sa pratique en classe. De plus en plus de recherches récentes en éducation et formation commencent à cerner la dimension cachée de la pédagogie grâce à l’observation du travail enseignant notamment ses réactions et sa gestion des situations non prévues, inattendues et non prescrites qui interviennent au cours du processus d’enseignement-apprentissage.
Dans le contexte congolais, la pratique pédagogique est encadrée par les instructions officielles (IO). Ces instructions définissent des règles et des principes guidant l’action de l’enseignant. Il s’agit ici de solliciter l’imagination et la créativité de l’enseignant qui doit juger de la congruence entre l’objectif opérationnel et le contrat didactique de son cours.
Dans nos différents échanges avec les enseignants, mettant en lien le prescrit du travail enseignant et le réel de l’activité, il ressort que dans le travail enseignant, l’écart qui se construit entre ces deux dimensions, se manifeste par la dimension cachée de la pédagogie, qui n’apparait qu’en classe et ne peut donc pas être visible dans la fiche de préparation pédagogique. Avec souvent des effectifs pléthoriques dans les différentes salles de classe dépourvues de tables bancs, et un manque de matériel didactique, le maître doit gérer les tensions quotidiennes pour que l’élève apprenne. En situation d’impasse ou de blocage, l’enseignant peut puiser ses ressources dans la dimension cachée de la pédagogie qui facilite l’apprentissage des élèves conformément à l’esprit des méthodes actives. Il s’agit donc de constater qu’au-delà des éléments contenus dans la fiche de préparation pédagogique, certains évènements imprévus viennent perturber les échanges entre enseignants et élèves. Ce sont ces évènements imprévus qui caractérisent la dimension cachée de la pédagogie au sens où l’enseignant est amené à mobiliser d’autres ressources pour faire face à la difficulté entraînée par ces évènements imprévus. Puisque les méthodes actives, selon Rieunier, sont basées sur l’activité propre de l’enfant, sa spécificité propre et son intérêt, ces mêmes méthodes autorisent l’enseignant à investir son expérience personnelle, sa créativité et son sens d’initiatives pour tracer et ouvrir son chemin à travers les difficultés pédagogiques : il puise ainsi ses solutions techniques et conceptuelles dans « la dimension cachée de la pédagogie ».
Creuser la notion de dimension cachée de la pédagogie, mettre en évidence ses aspects et contours, telle est l’ambition de ce travail qui veut montrer aussi l’impact de cette dimension cachée sur le processus d’enseignement-apprentissage. Puisque la formation pédagogique permet de développer des compétences générales et des compétences spécifiques, selon les archives de DISCAS[1]. L’interaction de ces deux types de compétences donne lieu à des compétences transversales qui se manifestent à travers la « dimension cachée de la pédagogie » qui n’est ni enseignée ni évaluée spécifiquement. La rationalité limitée de la pédagogie que nous avons évoquée plus haut se caractérise par le fait que dans les situations de classe, certains événements imprévus viennent perturber les échanges entre enseignants et élèves. Cette dimension cachée résulte du fait des évènements imprévisibles et inattendus qui apparaissent dans le déroulement de l’activité en classe. La lecture des auteurs ayant abordé cette thématique et l’observation des activités pédagogies des enseignants congolais exerçant dans la circonscription scolaire de Ouenzé II à Brazzaville a motivé cette recherche dont l’objectif général est d’analyser la dimension cachée de la pédagogie.
L’intérêt de mener une telle recherche réside dans le fait d’offrir une grille de lecture qui permet à l’enseignant de s’approprier de la dimension cachée de la pédagogie de manière à faire face aux événements imprévisibles et inattendus qui peuvent subvenir dans le processus enseignement-apprentissage. Cet intérêt nous amène à questionner d’une manière critique la dimension cachée de la pédagogie.
- Qu’est-ce que la dimension cachée de la pédagogie ?
La dimension cachée de la pédagogie renferme l’ensemble des situations non prévues inattendues, non prescrites se produisant dans le processus enseignement-apprentissage et auxquelles l’enseignant doit faire face en mobilisant des ressources hétérogènes pour faire la classe.
- Comment se caractérise-t-elle ?
Elle se caractérise par une multiplicité d’interactions entre les acteurs de la classe, par une imprévisibilité des événements qui peuvent subvenir de manière surprenante et inattendue au cours de n’importe quelle leçon, par une simultanéité de ces évènements marqués par les différents comportements des élèves en classe. Comme le souligne Perrenoud, l’enseignant est amené à « agir dans l’urgence et décider dans l’incertitude », de s’adapter à la situation de classe et adopter des stratégies immédiates.
- Pourquoi cette dimension cachée existe-t-elle dans le processus enseignement-apprentissage ?
Parce que dans ce processus, il s’agit des interactions humaines. Dans toute interaction humaine survient souvent des imprévus, des aléas auxquels les acteurs doivent s’adapter pour atteindre l’objectif assigné.
- Que font les enseignants pour faire face à cette dimension cachée ?
Il apparaît que la préoccupation première de l’enseignant est de se conformer à sa préparation pédagogique tenant compte des objectifs prescrits et du contrat pédagogique. Les situations imprévues ou inattendues qui entravent le climat, la discipline et l’apprentissage des élèves se doivent d’être résolues par l’enseignant qui tient à garder le cap à tout prix. Pour ce faire, il est obligé de mobiliser son expérience, sa personnalité et d’autres ressources non prescrites, mais de quelle manière ?
Si certaines de nos recherches antérieures ont abordé l’enseignement en milieu scolaire sous l’angle de l’analyse du travail (Moussavou), et que d’autres ont posé le problème du travail des enseignants pour essayer de comprendre l’écart qui existe entre le prescrit et l’activité réelle de l’enseignant en classe (Tardif et Lessard; Drand), cet article pose le problème de la prise de conscience de la dimension cachée de la pédagogie et de ses manifestations dans le contexte de l’école congolaise en mettant en évidence les réactions des enseignants face aux caractéristiques de cette dimension cachée.
La problématique est ainsi présentée, nous amène à la question de recherche suivante : Comment se caractérise la dimension cachée de la pédagogie ?
Cette question inspire l’hypothèse ci-après : La dimension cachée de la pédagogie se manifeste par des événements multiples qui interviennent en classe. Ces événements multiples se manifestent par une imprévisibilité de la situation de classe (variable 1), une pluridimensionnalité (variable 2), une simultanéité (variable 3) et une immédiateté des décisions (variable 4).
Afin de vérifier cette hypothèse et cerner la notion de dimension cachée de la pédagogie, nous avons eu recours à l’observation des pratiques enseignantes et des entretiens avec les enseignants des écoles primaires de la circonscription scolaire de Ouenzé II à Brazzaville.
Outre cette introduction, cet article nous permettra dans le premier chapitre d’aborder la méthodologie de travail utilisée. Dans le deuxième chapitre, nous présenterons, analyserons et interpréterons les résultats de notre travail de terrain. Le troisième chapitre discutera des résultats obtenus. Enfin, nous terminerons par une conclusion qui envisagera la dimension cachée de la pédagogie comme étant levier de l’efficacité dans l’enseignement.
- Méthodologie de recherche
- Le champ d’investigation
La circonscription scolaire de Ouenzé II à Brazzaville a été notre champ d’investigation.
- De l’échantillon
Pour les besoins de notre recherche, nous avons retenu 20 enseignants. Cet échantillon se présente de la manière suivante :20 enseignants dont 15 femmes.
Tableau 1 : Répartition de l’échantillon concerné
| Établissement | Hommes | Femmes | Total |
| Saboukoulou 1 | 2 | 3 | 5 |
| Saboukoulou 2 | 3 | 2 | 5 |
| 5 Février 1 | 00 | 3 | 3 |
| 5 Février 2 | 00 | 1 | 2 |
| Emeraude 1 | 00 | 3 | 3 |
| Emeraude 2 | 00 | 2 | 2 |
| Total | 05 | 15 | 20 |
- Les instruments de collecte des données
La recherche obéit à une démarche qui offre une multitude d’instruments susceptibles d’aider l’enquêteur dans la collecte des données. Pour notre recherche, nous avons retenu deux types d’instruments : l’observation et l’entretien qui prennent en compte les quatre thèmes suivants :
- la connaissance de la dimension cachée ;
- les manifestations de la dimension cachée ;
- l’impact de la dimension cachée ;
- la gestion de ses caractéristiques.
Tableau 2 : Synthèse des instruments de la collecte des données
| N° | Instruments | Sujets concernés | Objectifs |
| 01 | L’observation | Enseignants actifs | Recueillir les données relatives à la dimension achée de la pédagogie |
| 02 | L’entretien | Encadreurs pédagogiques et enseignants | Recueillir les informations sur le travail caché, les dimensions clandestines ; Comment accéder à ces dimensionsIdentifier le statut de la dimension cachée et ses caractéristiques |
- Présentation, analyse et interprétation des résultats
- Analyse et interprétation des résultats
- De la formation des enseignants
Parmi les vingt enseignants qui ont fait l’objet de notre recherche, douze affirment avoir bénéficié d’une formation initiale à l’Ecole Normale des Instituteurs (ENI), contre huit enseignants qui le sont devenus suite à une formation sur le tas. En effet, il existe une différence de comportement entre ceux qui ont été formés et ceux qui n’en ont pas bénéficié. Ici, les ressources issues de la formation professionnelle initiale servent de base à la conduite de la classe. Par contre, la jeunesse et le manque d’expérience des maîtres non formés constituent des freins à la maîtrise de l’activité enseignante en classe. Dans les deux cas, les situations imprévues et donc inattendues viennent perturber l’activité enseignante en classe.
- Du rapport à la tâche
Au niveau du rapport à la tâche, nous avons noté une conscience professionnelle qui se traduit par la préparation de leur classe, par leur assiduité. Malgré la pénibilité du travail enseignant au plan pédagogique, matériel et psychologique, et donc qui caractérisent la dimension cachée de la pédagogie, les enseignants sont résilients dans leur pratique de la classe. Donc, prendre conscience des caractéristiques de la dimension cachée de la pédagogie peut devenir une valeur ajoutée sur la gestion et l’autorité du maître. La capacité de résoudre les situations imprévues et de les réguler pendant qu’on fait la classe, confère au maître une expertise indéniable.
- De l’imprévisibilité
En termes d’imprévisibilité de la situation de classe, 18 enseignants sur 20 constatent qu’il y a de nombreuses variables qui déstabilisent la quiétude du maître : le climat conflictuel entre élèves et parfois entre élèves et le maître. L’environnement de l’école surdétermine le climat de la classe et des courants qui la traversent.
- De la simultanéité
Quant à la simultanéité des évènements apparaissant en classe, seize enseignants sur vingt reconnaissent qu’il n’y a pas de moments neutres. Lors du déroulement du travail en classe, des évènements surviennent les uns après les autres. Ces événements imprévus peuvent surgir soit du fait de l’enseignant lui-même suite au rendu de son propre cours, soit du fait des apprenants porteurs de litiges. Dans ce sens, Perrenoud stipule :
Répondre ou non, s’attarder auprès d’un élève en difficulté ou l’encourager d’un mot, choisir de voir ou de ne pas voir, de sanctionner ou de ne pas sanctionner une conduite déviante, suivre ou ne pas suivre une piste suggérée par un élève, poursuivre une discussion agitée ou y mettre fin, donner la parole à tel ou tel, accepter ou non une proposition, dramatiser ou banaliser un appel au calme… autant de décisions prises dans l’instant, sans longue réflexion ou sans réflexion du tout. Cela signifie-t-il que les décisions sont prises au hasard ? Nullement .
Ce comportement traduit tout simplement l’existence de la dimension cachée de la pédagogie.
- De la pluridimensionnalité
A propos de la pluridimensionnalité, il est évident que sous le feu ou la pression des événements inattendus, l’enseignant est obligé de se remobiliser, de résoudre, efficacement ou inefficacement, ces événements qui viennent entraver le déroulement de son activité en classe. Ce faisant, l’enseignant recourt à la dimension cachée de la pédagogie sans s’en rendre compte. Dix-huit (18) enseignants en ont fait l’expérience.
- De la gestion pédagogique
La gestion pédagogique d’une classe place le maître devant l’immédiateté des décisions : l’urgence de la pratique de la classe, les séquences des activités à mener obligent l’enseignant à s’investir personnellement dans sa pratique et à prendre toute décision utile et nécessaire à l’aboutissement de l’action pédagogique. Une leçon inachevée résultant des facteurs multiples fruste l’enseignant qui a passé des nuits blanches à préparer ses leçons. Dix-sept (17) maîtres sur vingt le reconnaissent.
2.2. Synthèse des résultats
Comme souligné ci-dessus, notre recherche s’est déroulée dans les écoles primaires. En ce qui concerne notre échantillon, il était composé de vingt (20) enseignants de tout niveau confondu. Des instruments de collecte de données ont été utilisés : il s’agit principalement de l’entretien semi-directif et l’observation. Cet entretien semi directif pour les enseignants portait sur la connaissance et l’usage de la dimension cachée de la pédagogie.
Sur les vingt (20) enseignants interviewés, six (6) ignorent complètement la notion de dimension cachée de la pédagogie. Ils précisent « qu’ils n’ont jamais entendu parler de cela ». Toutefois, neuf (9) enseignants formulent une définition approximative ou réellement imprécise de la dimension cachée de la pédagogie. Cependant, ils sont cinq (5) enseignants qui ont pu préciser ce qu’est la dimension cachée en évoquant le « travail caché de l’enseignant », c’est-à-dire les savoirs qu’ils mobilisent pour faciliter l’apprentissage ou renforcer leurs acquisitions. Tous les enseignants interrogés ont été amenés à préciser l’importance de la dimension cachée de la pédagogie en termes d’utilité. Au total sept (7) enseignants ont insisté sur le développement des fonctions cognitives de l’enseignant qui doit enseigner une pluralité de disciplines. D’autre part, treize (13) enseignants sur 20, donc la majorité souligne que la dimension cachée de la pédagogie fait intervenir la personnalité de l’enseignant qui doit être capable d’interagir avec les apprenants pour exhumer sa créativité et son sens d’initiatives lorsqu’il est bloqué par une situation inédite ou imprévue. Comment s’en sortir avec panache ou maestria sinon en recourant à la dimension cachée de la pédagogie !
Plus globalement, cette analyse de la situation révèle que les enseignants préparent des cours dont les contenus doivent être mobilisés en classe. Une fois devant leurs élèves, il arrive que ceux-ci se retrouvent en difficulté face aux questions qui leur sont posées. Alors, pour faire face à cette difficulté, l’enseignant adapte sa manière de faire la classe pour amener les élèves à avancer dans leurs apprentissages. Cette situation révèle qu’au-delà de toute préparation de la classe, il y a des éléments cachés qui se révèlent dans le déroulement de la classe.
- Discussion
Les maîtres sortis de l’Ecole Normale des Instituteurs sont prisonniers des théories apprises au cours de leur formation. L’approche des programmes en cours dans ces institutions de formation est loin de les épanouir. En théorie, on pense que la pédagogie est faite de recettes, or « la pratique n’est pas une mise en pratique de recettes », Huberman s’appuie sur :
- « le nombre important d’interactions dans lesquelles le maître est engagé pendant une heure, leur rythme soutenu ;
- la diversité des sollicitations qui se succèdent, souvent se chevauchent ;
- la concentration des activités et interactions dans un espace limité » pour montrer la réalité des événements imprévus auxquels le maître doit faire face. C’est dire qu’en réalité, la pédagogie formelle cohabite avec sa dimension cachée. Les déductions qui ont abouti à la mise en évidence de la dimension cachée de la pédagogie, à partir de leur pratique et leur discours ont semblé être des révélations.
Dans le contexte de l’école congolaise en général et de la circonscription scolaire de Ouenzé II en particulier, les exigences du métier d’enseignant consistent à :
- concevoir et mettre en œuvre son enseignement ;
- organiser le travail de la classe ;
- prendre en compte la diversité des élèves ;
- se former et innover, etc.
Malheureusement, nous l’avons vu, avec les situations multiples de la classe, les conditions du travail enseignant se sont sérieusement dégradées et la profession enseignante est devenue une gageure. Prendreconscience de la dimension cachée de la pédagogie est un facteur d’émancipation pour l’enseignant car elle le rend apte à l’investigation, au diagnostic et à la prise de décision. Abonder dans ce sens, c’est prendre en compte les dimensions multiples du vécu, avec ses composantes individuelles et collectives, psychologiques et sociopolitiques, ses processus conscients et inconscients. Puisque les conditions de travail évoquées par les enseignants sont porteuses des caractéristiques de la dimension cachée de la pédagogie, pourquoi ces derniers en sont-ils inconscients ?
Ainsi, aborder le problème de la dimension cachée de la pédagogie, revient à porter la réflexion sur ce que fait l’enseignant vis-à-vis des élèves, tout particulièrement face aux situations inattendues. Il s’agit là d’une pédagogie qui intègre, dans sa pluri dimensionnalité et sa transversalité tout le processus d’enseignement-apprentissage. Il appartient donc à l’enseignant d’identifier ce sens caché, de le rendre explicite, et donc le sortir de l’invisibilité.
Au sens de Chavallard, les dispositions pratiques permettant de rendre la dimension cachée plus visible et efficace, et donc plus utile pour les maîtres, sont à comprendre dans l’analyse de pratique qui suit la leçon et qui est structurée autour des cycles “explicitation-modélisation” fondés sur la notion de praxéologie que cet auteur définit au regard de quatre entrées : la tâche que s’assigne l’enseignant (son intention générale), les techniques qu’il développe (l’action située observable), les technologies qu’il fournit dans l’entretien (l’explication qu’il donne de son action) et les théories de référence (le champ de la culture professionnelle extrinsèque à l’action). Ces quatre entrées, considèrent la dimension cachée de la pédagogie comme devant se situer, selon Chavallard, moins dans l’ordre de la praxéologie qu’il nomme science de la pratique ou de l’action, et plus dans la science de la praxis, c’est-à-dire le mouvement de va et vient entre le vécu, la pratique et la pensée. Cette alternative suppose une dimension cachée de la pédagogie qui, pour cet auteur, intègre plusieurs champs disciplinaires, parce qu’il s’agit d’une action qui est en soi une opération transdisciplinaire.
Cette dimension cachée est aussi à comprendre avec les travaux de Perrenoud (207), parlant de l’improvisation réglée, ou avec les recherches sur les imprévus et les gestes d’ajustement professionnels évoqués par Bucheton et Soulé (31), qui citent Jean, Chabanne et Bucheton. Tous ces travaux renvoient à l’agir professionnel des enseignants considérés comme des praticiens susceptibles de faire face aux situations inattendues qui viennent scander le déroulement de la classe. La formation devient ainsi une variable d’ajustement devant intégrer la maîtrise des actions et des situations nouvelles inattendues. Ainsi, puisque les textes officiels prévoient des sessions de recyclage ou renforcement des capacités pour les enseignants en exercice, ce serait donc des occasions indiquées pour compléter la formation des maîtres par les techniques d’animation pédagogique permettant de révéler l’existence de cette dimension cachée, ses caractéristiques et son impact sur l’efficacité dans le processus d’enseignement-apprentissage. Les conférences pédagogiques, les leçons d’essais et l’encadrement pédagogique, voilà autant de dispositifs et de pratiques de professionnalisation susceptibles d’être exploitées pour informer et installer la capacité à surmonter les événements inattendus.
Conclusion
Pour mieux comprendre ce qui se passe dans le processus d’enseignement-apprentissage, il importe de disposer d’une image adéquate, réaliste, de la pratique pédagogique et de son rapport à la connaissance. Notre recherche s’est efforcée d’éclairer quelques aspects de la dimension cachée de la pédagogie, de mettre en évidence cette dimension et son impact dans la gestion d’une classe.
Notre recherche a posé le problème de la prise de conscience de la dimension cachée de la pédagogie et de ses manifestations dans le contexte de l’école congolaise en décrivant les réactions des enseignants face aux manifestations de cette dimension cachée. En interrogeant la pratique de la classe et en nous entretenant avec les enseignants de l’école primaire sur leur propre pratique pédagogique, nous avons compris que la dimension cachée de la pédagogie n’est pas simplement une mise en pratique de recettes toutes faites ou de schémas d’action conscients ; elle est guidée, même en suivant ces schémas, de systèmes de pensée et d’action qui conditionnent les décisions multiples et parfois incertaines intervenant dans l’activité de l’enseignant en classe.
C’est dans ce sens que Perrenoud (201) parle de la « pratique pédagogique entre l’improvisation réglée et le bricolage » soulignant « la capacité du maître à supporter des interactions soutenues, décousues, dans une atmosphère bruyante et agitée », qu’il est « sollicité de toutes parts, confronté à des demandes simultanées », et que « quelle que soit la variation d’une classe à l’autre, la pratique pédagogique reste faite, même dans la classe la plus ordonnée et contrôlée, d’une succession de microdécisions de tous ordres ».
La problématique de la dimension cachée de la pédagogie s’inscrit donc dans cette perspective, en soulignant le caractère urgent des décisions prises et qui n’obéit pas forcément à des règles explicites ou à des schémas d’action conscients. Ainsi, notre hypothèse soulignant la complexité et le caractère multiple de la dimension cachée a été confirmée.
Cet article qui n’a pas épuisé les différentes caractéristiques de la dimension cachée, a eu au moins le mérite d’élargir l’horizon mental des enseignants de la circonscription scolaire de Ouenzé II. Il revient à d’autres chercheurs de généraliser et de vulgariser la connaissance de la dimension cachée de la pédagogie.
Travaux cités
Bucheton, Dominique et Yves Soulé. Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant dans la classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées, Éducation et didactique [En ligne], 3-3 | Octobre 2009, mis en ligne le 01 octobre 2011, consulté le 10 décembre 2020. URL : http:// journals.openedition.org/educationdidactique/543 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ educationdidactique.543
Chevallard, Yves. Analyse des pratiques enseignantes et didactiques des mathématiques : l’approche anthropologique. Clermont Ferrand : La Rochelle, 1997.
Cuisiniez, Frédérique et Ghuyslaine Roy-Lemarchand.Réussissez vos actions de formation, ESF, 2008.
Durand, Marc. L’enseignement en milieu scolaire. Paris : Presses Universitaire de France, 3e édition, 2002.
Develay, Michel. Didactique et sciences de l’éducation, Bulletin de l’Association des enseignants chercheurs en sciences de l’éducation n°13, 1993.
Moussavou, Guy. Le travail enseignant : écart entre le prescrit et la réalité dans la classe, Les cahiers de la Chaire. Revue pluridisciplinaire de Recherche, n°3, Septembre 2016. Pointe-Noire : Editions LMI, 2016.
———-. La professionnalisation par l’expérience des enseignants sans formation initiale au Gabon. Paris : L’Harmattan, 2015.
Perrenoud, Philippe. « La pratique pédagogique entre l’improvisation réglée et le bricolage », Éducation & Recherche, 1983, n° 2, pp. 198-212. Repris dans Perrenoud, Ph. : La formation des enseignants entre théorie et pratique, Paris, L’Harmattan, 1994, chapitre I.
———-. Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Paris : ESF, 1996.
Rieunier, Alain. Préparer un cours, les stratégies pédagogiques efficaces. Issy-les-Moulineaux : ESF, 3e édition, 2007.
Romelaer, Pierre. L’entretien de reherche. Bruxelles : De Boeck, 2005.
Tardif Maurice, Lessard Claude. Le travail enseignant au quotidien : Expérience, interactions humaines et dilemmes professionnels. Bruxelles : De Boeck, 2000.
Tsafak, Gilbert. Ethique et déontologie de l’éducation. Paris : PUF, 1998.
Vergnioux, Thierry Piot et Jean-Yves Bodergat. La pédagogie. Son sens, ses pratiques. Paris : EP. 2014.
Comment citer cet article :
MLA : Moussavou, Guy. “La dimension cachée de la pédagogie dans la circonscription scolaire de Ouenzé II à Brazzaville.” Uirtus 1.1 (août 2021): 356-370.
§ Ecole Normale Supérieure de l’Université Marien Ngouabi, [email protected]
[1] Les archives de Discas, 2013, http://www.csrdn.qcca/profilcompétence/enseignant/profils…