Introduction
Les ouvrages d’Ahmadou Kourouma, en de nombreux cas, créent un effet de mobilisation des regards et des sens. Ses héros sont asservis à une espèce de captation visuelle et sensitive sous laquelle ils incarnent, soit une image élogieuse, soit une figure abracadabrante, voire malsaine selon qu’ils sont présentés sous un angle positif ou négatif. L’analyste s’efforce ainsi de saisir l’aspect ou l’affect significatif de ces personnages, dont les apparitions ne font pas mystère d’une idéologie militante. Dans Les soleils des indépendances, en effet, le monde des indépendances apparaît comme la fin d’un univers authentique où les honneurs et la solennité des insignes semblent avoir fait place à l’horreur.
L’honneur présente ici une polysémie confligène. Néanmoins, le Dictionnaire de Furetière et le Dictionnaire de l’Académie française s’accordent sur le fait qu’il désigne toute reconnaissance sociale d’une attitude vertueuse[1]. Cette reconnaissance peut prendre la forme volatile de l’estime publique et de la réputation, ou bien celle de l’octroi d’honneurs, c’est-à-dire de l’attribution de charges d’autorité et de pouvoir, entraînant l’attribution de privilèges matériels et de droits accrus de préséance.
Selon Le Grand Robert de la langue française, l’horreur est une « impression violente causée par la vue ou la pensée d’une chose qui fait peur ou qui répugne (souvent accompagnée par un frémissement, un frison, un mouvement de recul). (https ://www.lerobert.com)
La présente contribution part du constat que les notions d’honneur et d’horreur affichent leur présence dans les textes romanesques africains à l’exemple de Les soleils des indépendances. Dès lors, des questions essentielles orientent et structurent la réflexion : L’honneur est-il un principe qui gouverne la vie du personnage-héros dans l’univers textuel romanesque ? Ce principe doit-il s’appréhender par son amarrage à la déviance ? L’honneur ne peut-il être pensé autrement que dans son rapport à l’horreur ? Si le rapport est établi, quels sont alors les mécanismes choisis dans le roman qui servent à créer l’effet d’horreur ?
Adossée à la sémiotique narrative et à la sociocritique, l’étude explorera quelques traits majeurs de l’honneur et l’horreur. Elle établira que le schème de l’honneur s’intègre dans la diégèse comme un principe qui régit la vie du personnage-héros. Ellemontrera deplus comment Fama prospère sur l’autel d’un devoir d’honneur que le romancier aliène dans la tragicisation de l’horrible.
- L’honneur : un principe qui gouverne le personnage-héros
L’honneur mobilise dans Les Soleils des indépendances les meilleurs suffrages du lecteur.S’il s’applique à des personnages satellites dans Les Soleils des indépendances, il reste un principe moral primordial pour Fama. Les relations du personnage-héros avec son époque « l’ère des Indépendances (les soleils des Indépendances, disent les Malinkés) » (Kourouma 7-8) tiennent des accointances solides avec la morale.Fama, qui ne comprend ni n’accepte son époque, ne se porte garant d’aucune analyse politique et historique, économique et sociologique. Il injurie, condamne ou s’enthousiasme. Il appréhende l’histoire en moraliste, selon les critères moraux qui procèdent des valeurs traditionnelles du peuple malinké.
- Fama et les honneurs : entre conservatismes et jactance
Barthes écrivait : « Le propre du récit n’est pas l’action, mais le personnage comme nom propre » (13), du moins peut-on reconnaître à la fois cette donnée de fait qu’il n’y a pas de roman sans nom propre, et, empiriquement, un fonctionnement de lecture, le rôle décisif des noms dans ce que Jouve a appelé « L’Effet-personnage ». Fama (ce nom signifie « roi », « chef ») a un besoin vital de considération et d’admiration. Quelques jours avant sa mort, il crie ce besoin aux hommes : « Regardez Doumbouya, le prince du Horodougou ! Admirez-moi…! ». (Kourouma 199). Il ne s’agit pas d’un défaut personnel d’orgueil : ce sentiment estle propre du chef, du héros, de se voir honoré, célébré. L’intrigue montrele héros saisi avec délectation les postures ou les scénarii de valorisation : « […] ; il avait le palabre, le droit et un parterre d’auditeurs […] » (Kourouma 13) et il apprécie avec volupté les salutations de ses vassaux : « Fama trônait, se rengorgeait, se bombait. Regardait-il les salueurs ? A peine ! » (Kourouma 113).
Les sentiments d’estime et de considération portés à Fama correspondentà un principe, celui de la dignité de la personne humaine et principalementde l’appartenance sociale. « Quelles que soient sa naissance et sa vacation, nul n’échappe au sentiment de la valeur de son propre être social ; nul n’échappe non plus au souci de la préserver […] aucune société traditionnelle ne saurait se concevoir sans des liens d’honneur entre ses membres. Le souci d’honneur partagé est consubstantiel à tout lien social viable et durable ». (Drevillon et Venturino, www.pur-editions.fr ).
Or, dans la diégèse, celui-ci est remis en question par un métadiscourspeu élogieux : « Un prince presque mendiant, c’est grotesque » (Kourouma 11), « sous les soleils des Indépendances, les Malinkés honnissaient et même giflaient leur prince » (Kourouma 15) ou encore « Cette vie-là n’était-elle pas un soleil éteint et assombri dans le haut de sa course ? » (Kourouma 29). En effet, la déconsidération, le mépris, l’humiliation, le déshonneur, la bassesse… bafouent l’honneur ou la respectabilité de Fama. Ce dernier fait des pieds et des mains pour protéger son intégrité, le respect qu’il a envers lui-même, “sa sphère idéale” des menaces extérieures. Or Fama ne peutgarantir l’inviolabilité de son honneursans s’en référer à l’altérité : « […] en bon Malinké, que pouvait-il chercher encore ? Il […] se déplaça […] se pavana de sorte que partout on le vit ». (Kourouma 13). L’inscripteur recourt aux verbes de mouvement “se déplacer”, “se pavaner”, à l’adverbe “partout” et au verbe de perception “voir”, précédé de la locution conjonctive “de sorte que”. Ils mettent enévidence le désir d’élévation de Fama, surtout si l’on s’en tient à la sémantique qui entoure les mots guillemetés. Belorgey en déduit que« L’honneur est alors inséparable de l’espace public » (197) ; il correspond à la “face”, à « La mise en scène de soi » (Goffman), « c’est nous faire croire tels que nous sommes [en vue d’être reconnus] ». (Billacois 79).
Par cette attache aux règles de l’être ensemble, Fama revendique l’attention ou la dévotiondes Malinkés et des non Malinkés. C’est pourquoi, selon Green, « l’honneur est étroitement lié à l’existence sociale ». (39) . L’opinion positive du groupe est une pièce importante du puzzle. Les honneurs de Fama, un authentique prince Doumbouya, équivalent alors à l’honneur ressenti, exigé et témoigné. Dilmaç souligne que « L’honneur apparaît alors comme un principe tourné vers le soi : il constitue un ensemble de valeurs, mais aussi une moralité choisie par les personnes en vue de donner un sens à leurs actions, mais surtout de protéger leur intégrité » (346). Fama, en effet, jubilait« quand […] les griots et les griottes chantaient la pérennité et la puissance des Doumbouya » (Kourouma 19). Animé de ces sentiments, Fama est en harmonie avec son personnage de chef, « car le héros se nourrit de poèmes et de musique qui l’exaltent, sinon il s’adoucit et se suicide ». (Kourouma acte I).
Pour mériter ces honneurs, Fama veille habituellement à la noblesse de son maintien. « Avec […] des gestes royaux et des saluts majestueux » (Kourouma 106), même s’il est parfois dérisoire, « dommage que le boubou ait été poussiéreux et froissé ! » (Idem).
La narration donne de constater un autre fait : Fama ne perd jamais le sens aigu de la dignité de sa famille. À plusieurs reprises, on le voit marquer ce qui convient ou non à un Doumbouya : « un Doumbouya, un vrai, ne donne pas le dos au danger, se vanta-t-il » ; (Kourouma 164). C’est pourquoi, il est hors de lui quand « le petit douanier gros, rond, ventru, tout fagoté, de la poitrine aux orteils, avec son ceinturon et ses molletières », (Kourouma 104), ne lui témoigne pas la considération attendue :
Le dernier village de la Côte des Ebènes arriva, et après, le poste des douanes, séparant de la République socialiste de Nikinai. Là, Fama piqua le genre de colère qui bouche la gorge d’un serpent d’injures et de baves, et lui communique le frémissement des feuilles. Un bâtard, un vrai, déhonté de rejeton de la forêt et d’une maman qui n’a surement connu la moindre bande de tissu, ni de dignité du mariage, osa, debout sur ses deux testicules, sortir de sa bouche que Fama étranger ne pouvait pas traverser sans carte d’identité ! Avez-vous bien entendu ? Fama étranger sut cette terre de Horodougou ! (Kourouma 103-104).
Il se calme aussitôt quand on sait « distinguer l’or du cuivre » (Kourouma 104) et reconnaître en lui « le descendant des Doumbouya » (Idem). La reconnaissance vaut alors à Fama « les honneurs et les excuses convenables » (Idem).
Les honneurs de Fama peuvent se résumer selon Biard 2009 sous le vocable « d’honneur civique ». Il comprend toutes les civilités, mais aussi les éléments juridiques (tel le respect de l’Autre, celui de la dignité du personnage-héros). Loin d’être déraisonnable ou excessif, cet honneur pourrait alors être envisagé comme « promouvant la vertu » (Billacois 79). Cet honneur dit « civique », porté par les individus dits « Honorables » (Kourouma 100) dont Fama est le prototype, aurait son antithèse caractérisée par un autre type d’honneur, plutôt fondé sur la déviance.
- L’honneur du prince ou le paradoxe de la déviance
Sous la plume d’Ahmadou Kourouma, le monde des indépendances apparaît comme la fin d’un univers authentique. Il est une dégradation de l’univers traditionnel. Pour exemple, Fama, le prince d’hier, connu sous l’appellation de l’honorable, ne se retrouve plus ; non seulement, elles le dépossèdent, mais les indépendances suppriment les chefferies traditionnelles et réduisentles princes en « bande d’hyènes » (Kourouma 9), de mendiants en quête de pâture. « Fama Doumbouya, père Doumbouya, mère Doumbouya, dernier et légitime descendant des princes Doumbouya du Horodougou, totem panthère, était un vautour […] Ah ! les soleils des Indépendances ! » (Kourouma 9). Fama est réduit à sillonner les foules anonymes, de funérailles en funérailles, à la recherche de sa substance. « Il marchait au pas redoublé d’un diarrhéique » (Kourouma 9), bousculé par des badauds, « des badauds plantés comme dans la case de papa ». (Kourouma 9). Il transpire, menace, injurie, couvert d’un vacarme incroyable de « klaxons, pétarades des moteurs, battements des pneus, cris et appels des passants et des conducteurs ». (Kourouma 10). L’honneur dit “civilisé” est rangé aux calandres grecques, la norme civique est désavouée : celle-ci prendrait forme dans la retenue des comportements. L’honneur désigné, en revanche, est “barbare”, vil. Il renverrait à un comportement qualifié de déviant, un pur paradoxe. D’où ce parallèle entre la description qui en est faite et cette célèbre réplique chère à Kourouma : « lui, Fama né dans l’or, le manger, l’honneur et les femmes ! Eduqué pour préférer l’or à l’or, pour choisir le manger parmi d’autres, et coucher sa favorite parmi cent épouses ! Qu’était-il devenu ? Un charognard … ». (Kourouma 10). Ce terme de « charognard » engendre, par analogie, un registre lexical des attributs de Fama. Devenu pauvre, il vit des largesses des amis des défunts dont on célèbre les funérailles. La représentation ci-contre donnée à titre illustratif est appuyée par un commentaire métanarratif.
hyène → cimetière
Fama charognes→charognard →Fama vautour → arrière des cases
L’hyène vit aux alentours des cimetières, les vautours planent à l’arrière des cases. Ici et là, sont des lieux de décomposition, des dépôts de “détritus”. Hyène, vautour et charognard connotent Fama, de même que cimetière, arrière des cases et charognes connotent à la fois des lieux de célébration de funérailles ou de naissance, lieux de prédilection de Fama. Les attributs ressortissent à la fois aux registres zoologique et minéral. Fama est donc condamné à la marginalité, il est un “bâtard” pour la société contemporaine. Personne n’estime lui devoir le respect. Le voilà arrivant en retard à une cérémonie funéraire : Fama essuie les sarcasmes d’un griot qui associe les Doumbouya, totem panthère, aux Keita, totem hippopotame. Proportionnellement à la réaction du griot, symbole du peuple malinké, Boadi apporte des explications édifiantes :
Cette déchéance, cette sorte de unfornunate end oude badly end entacheprofondément le tracé de l’itinéraire du héros romanesque […]. Il perd ses artifices glorieux. Sa fouge et ses limitations l’auto-détruisent, car il n’a pas cette science des grands hommes qui génère la mystique de la surhumanité. Entre le peuple et lui, il y a toujours cette coupure qui intervient brutalement, cette cassure intervenant à un moment crucial et produisant l’incommunicabilité qui accélère l’échec, crée le revers, alimente les déboires (87-88).
« Ces diverses atteintes à l’intégrité physique (et même comportemental) font partie du grand courant moderne de caricaturisation des personnages, […] de leurs rêves impuissants, inarticulés ». (Vaïs 197). La trajectoire de ces personnages-héros, notamment Fama, montre en définitive une démarcation totale avec « le schème épique de l’héroïté » (Boadi 87) parce que l’honneur qui gouverne la vie du personnage est constamment sapé, souillé. L’honneur qui se met en place par la négativité va inexorablement à la catastrophe.
- “L’honorable” Fama Doumbouya : au bout de la course, le folklore de l’horreur
Ohaegbu affirme cruellement : « Fama est fait pour être un raté » (260). Le héros de Les Soleils des Indépendances semble, en effet, par ses maladresses et ses inconséquences se complaire à faciliter la tâche d’un destin qui le persécute. Il se montre lucide, mais n’agit pas de manière conséquente. La seule volonté qu’il marque est celle de franchir la frontière et de mourir. Mais, la mort de Fama laisse un sentiment d’horreur.
- La représentation de l’horreur : monomanie et hollywoodisme
La narration proleptique de l’horreur campe avec éloquence et gravité la menace qui plane surlavie de Fama :« Fama s’avança vers le côté gauche du pont. Le parapet n’était pas haut et sous le pont, en cet endroit, c’était la berge. Les gros caïmans sacrés flottaient dans l’eau et étaient prêts à s’attaquer au dernier descendant des Doumbouya » (Kourouma 200).
Selon Mellier, l’horreur met en scène des « figures de l’altérité surnaturelles, monstrueuses, excessives » (147) se trouvant à la source du phénomène. L’Autre se révèle être une menace physique et psychologique, comme en témoignent l’extrait susmentionné qui, toutefois, ne comporte pas la dimension surnaturelle dont fait mention Mellier. Dans ce récit préfigurant l’horreur, les agresseurs ne sont pas le produit de l’imagination de la victime : ils existent bel et bien. L’horreur se traduit alors par un inconscient paranoïaque, puisque Ahmadou Kourouma se mue en faiseurd’horreur et « développe une fiction où l’Autre n’apparaît que dans le cadre d’un antagonisme explicite » (147). Par conséquent, les menaces sont actualisées par la confrontation à une entité malfaisante réelle : « les gros caïmans sacrés ».
La narration use de la figuration par l’utilisation d’une poétique du descriptif. Le récit donne à voir, il ne suggère pas. Ici, surgit le folklorique, le spectaculaire ou le spectatoriel. Les représentations descriptives semblent se réaliser par photographie, comme le fait remarquer Mellier : « Cette visualisation par le texte doit suffire à donner [au lecteur] l’impression de [la] présence » (37) effective de la menace, dont les propriétés sont intensifiées dans l’esprit du lecteur. « C’est dans la terreur que produit la “monstration” (terme qui joue de l’action de montrer l’événement spectaculaire du monstre) que l’univers du personnage s’effondre et que le lecteur s’abandonne au plaisir du pathétique » (31). À partir de là, il est alors possible de comprendre l’art de l’horreur comme un dispositifde dévoilement : « Fama s’avança vers le côté gauche du pont. Le parapet n’était pas haut et sous le pont, en cet endroit, c’était la berge. Les gros caïmans sacrés flottaient dans l’eau ou se réchauffaient sur les bancs de sable […] » (Kourouma 200).
Le dévoilement s’observe à travers certaines phrases caractéristiques : « Fama s’avança vers le côté gauche du pont » (1), « le parapet n’était pas haut » (2), « les gros caïmans flottaient dans l’eau ou se réchauffaient sur les bancs de sable » (3) et l’expression « en cet endroit » (4). Dans l’élément (1), le sens premier du verbe « s’avancer » est : “se porter en avant”, son sens au second degré est : “se hasarder” qui, à son tour, signifie ” se rendre dans un endroit où l’on peut courir un danger”. « Le côté gauche du pont » (1) mentionné au détriment de “côté droit” indique que l’endroit précisé présenterait des risques. D’où l’évocation de l’élément (4) « en cet endroit ». Dans l’élément (2), un mot attire l’attention de l’analyste : « parapet ». Ce mot a pour contenusémantique : “mur à hauteur d’appui destiné à empêcher les chutes”. La négation montre qu’il n’est pas dans sa position la plus élevée, la probabilité de survenue du dommage, c’est-à-dire la mort, est donc énorme. L’élément (3) matérialisé par les termes clés, tels que « caïmans », « flottaient » et « se réchauffaient » sont aussi couverts de signification. Le caïman est un monstre antédiluvien, mangeur d’hommes ; flottaient, du verbe flotter, a pour sens dénoté “rester à la surface de”. Il s’oppose à l’expression “rester en profondeur”. Le verbe se réchauffaient a pour infinitif se réchauffer : il signifie “redonner de la chaleur à son corps”. Il convient d’entendre par le mot chaleur “vigueur” en vue de passer à un acte. Le champ lexical des mots ou expressions clés pris, sémiotiquement et sémantiquement, se recoupent et se complètent dans la description. Ils désignent la mort.
Force est d’admettre que le mystère n’a pas sa place dans une séquence de dévoilement. En effet, la tâche de Kourouma apparaît tout autre. En modifiant l’état d’attente du lecteur, l’écrivain s’assure que ce dernier n’appréhende plus le dénouement de la scène comme un événement inconnu, mais qu’il l’anticipe plutôt, imaginant l’horreur dont il sera témoin. Des procédés rhétoriques s’adjoignent en outre aux stratégies textuelles dans la description de l’horreur.
- Raconter Fama : une rhétorique de l’horreur
La mort de Fama est volontaire. Il se jette toutefoisdans le fleuve en étant assuré que les caïmans « n’oseront s’attaquer au dernier représentant des Doumbouya » (Kourouma 200). Malheureusement, il eûtplus de mal que de peur : « Fama escalada le parapet et se laissa tomber sur un banc de sable. Il se releva, l’eau n’arrivait pas à la hauteur du genou. Il voulut faire un pas, mais aperçut un caïman sacré fonçant sur lui comme une flèche. Des berges on entendit un cri [horrible] » (Kourouma 200).
Kourouma recourt notamment à la comparaison.
- un caïman sacré est ce qui est comparé : le comparé,
- une flèche le mot qui fait image : le comparant,
- comme : l’outil de comparaison,
- le point commun n’est pas exprimé, il est à déduire du comparant : montrer une direction, le long de la ligne, pour attaquer mortellement.
Grâce aux indices de dévoilement, l’auteur avait peu à peu préparé le lecteur à une scèned’horreur et de dégoût. En effet, les passages descriptifs insistent sur la visibilité des éléments représentés, amplifiant du coup la répugnance de la scène : « Un coup de fusil éclata : d’un mirador de la république des Ebènes une sentinelle avait tiré. Le crocodile atteint grogna d’une manière horrible à faire éclater la terre, à déchirer le ciel ; et d’un tourbillon d’eau et de sang il s’élança dans le bief où il continua à se débattre et à grogner ». Cette explosion de sang et cette excitation criminelle de reptiles géants saisis dans une scène de gourmandise macabre constitue un pic scénarique où horreur et fantastique informent une tragicisation.
Le dévoilement des choses a requis principalement l’emploi des termes excessifs : éclata, grogna d’une manière horrible, déchirer le ciel, tourbillon d’eau et de sang…. Ces amplifications traduisent le paroxysme de l’horreur et lelecteur devient le témoin impuissant d’une scène horrifiante. Le narrateur ne se prive pas de la décrire : « Fama inconscient gisait dans le sang sous le pont. Le crocodile râlait et se débattait dans l’eau tumultueuse […]. Fama gisait toujours sous le pont. Le caïman se débattait dans un tourbillon de sang et d’eau » (Kourouma 201). Ces phrases comportent des groupes de mots redondants inscrits dans une formalisation récurrente, anaphorique à la limite: Fama gisait, sous le pont, le caïman se débattait, sang, non sans omettre la charge sémantique de l’adverbe toujours. Ces considérations s’adossent à ce que Mellier appelle « le fantastique de la représentation »[2] rattaché ici à l’horreur, où apparaît une esthétique de l’extériorisation et de l’excès.
Pourtant la fusillade était arrêtée. Les gardes frontaliers de la république de Nikinai, drapeaux blancs dans les mains, vinrent relever Fama qui avait été atteint sous la partie du pont relevant de leur juridiction. Ils le transportèrent dans leur poste ; leur brigadier l’examina : il était grièvement atteint à mort par le saurien. […] . Une douleur massive, dure, clouait sa jambe, tout son corps était devenu un caillou, il ne se sentait vivre que dans la gorge où il devait pousser pour inspirer, dans le nez qui soufflait du brûlant, dans les oreilles abasourdies et dans les yeux vifs. Fama avait fini, était fini. On en avertit le chef du convoi sanitaire. (Kourouma 202-203-204).
Le narrateur informe du décès du prince Fama. Mais la brutalité de sa mort, causée par le saurien (caïman), est atténuée par l’usage du verbe finir. L’euphémisme emploie des termes adoucis pour désigner une réalité cruelle : « Un malinké était mort » (Kourouma 205). « Tout le Horodougou était inconsolable, parce que la dynastie Doumbouya finissait, les chiens qui les premiers avaient prédit que la journée serait maléfique hurlaient aux morts, toutes gorges déployées sans se préoccuper des cailloux que les gardes leur lançaient. Les fauves répondaient des forêts par des rugissements, les caïmans par des grognements, les femmes pleuraient » (Kourouma 202).
L’horreur dans Les soleils des indépendances se perçoit à travers la représentation des actions. Il ne suggère pas l’indicible. Il mise donc davantage sur le visible et le tangible. Par une description détaillée des événements, ici assimilable à une sorte d’hyperréalisme, l’auteur décrit Fama comme un point de mire, une bête de foire qu’il se donne le plaisir douloureux d’exposer à l’écran, précisément un écran de cinéma. Pour saisir mieux l’impact de cette mise en image grand-format chez Kourouma, le lecteur tiendra compte a priori des observations de Boadi : « La description n’est plus simple énonciation, mais devient langage, c’est-à-dire un code, un montage systémique. L’expressionnisme abstrait des mots laisse place à une discursivité théâtralisée, à une sorte de mise en cinéma, de spectacularisation du discours romanesque ». (83-84). Il renchérit :
Cette forme de mise en spectacle réfère plus encore à l’hypotypose en tant qu’elle fait vivre la scène par l’humour grinçant, le grotesque, le farféluesque, l’ironie déchéante, le comique noir, etc. L’assimilation à l’hypotypose procède en effet de l’énumération des détails concrets et frappants que l’on moule dans un folklore d’animation de mots vivaces et scénarisables qui donnent à voir l’objet décrit. (84).
À la frontière séparant la Côte des Ebènes et la République socialiste de Nikinai, Fama subit l’affront de n’être pas reconnu comme prince du Horodougou. La monomanie de l’honneur a viré à un aveuglement sacrificiel dont la symbolique induit l’universalité sociale de l’horreur.
- Une tragédie universelle
La valeur symbolique de Les soleils des indépendances s’ouvre à desdimensions plus larges. L’œuvre de Kourouma infère une tragédie.
- Fama et la tragédie de la fin
Les personnages ont un destin dramatique ou sont directement responsables du dénouement tragique : dans Les soleils des indépendances, les initiativesdu protagoniste sont la cause indirecte, à première vue, de sa mort. Mais la compréhension au second degré de cette mort est facilitée par une verve prophétique faite de longue date :
Fama partait dans le Horodougou pour y mourir le plus tôt possible. Il était prédit depuis des siècles avant les soleils des Indépendances, que c’était près des tombes des aïeux que Fama devait mourir ; et c’était peut-être cette destinée qui expliquait pourquoi Fama avait survécu aux tortures des caves de la Présidence, à la vie du camp sans nom ; c’était encore cette destinée qui expliquait cette surprenante libération qui le relançait dans un monde auquel il avait cru avoir dit adieu. (Kourouma 193)
Fama sait qu’il est perdu, mais il va jusqu’au bout de son destin qui est de disparaître de ce monde qui le refuse. Ce monde dont il ne veut plus est sur lequel il ferme les yeux en quittant la capitale « Fama referma les yeux et sommeilla ». (Idem 194). Le jusqu’auboutisme de Fama opère dans l’œuvre comme un leitmotiv et une négation des valeurs bourgeoises dominantes sous l’ère des Indépendances.Dans la prison de Mayako, en priant profondément et très souvent, il s’était résigné, il avait fini par accepter sa fin, peu importe les circonstances. La mort est donc une solution pour être délivré de son angoisse existentielle. « Il était prêt pour le rendez-vous avec les mânes, prêt pour le jugement d’Allah. La mort était devenue son seul compagnon ; Fama avait déjà la mort dans son corps et la vie n’était pour lui qu’un mal ». (193).
En clair, Fama se conduit, selon cette trajectoire, en véritable héros tragique. Sa fin, misérable et glorieuse à la fois, fait de lui un héros vaincu. Ce scénario qui campe un héros de la défaite n’est pas exclu de l’écriture romanesque africaine contemporaine. Le personnage-héros selon Boadi est « en déphasage total avec la lecture de l’héroïque rituelle » (87) telle que l’expose Martel pour qui « Le héros vient de la multitude, lui donne l’exemple du courage […]. En contrepartie, le héros reçoit de la multitude une puissance fantastique » (11) qui lui ouvre royalement « les vannes de l’épiphanie glorieuse ». (Boadi 87).
Dans le roman africain contemporain, le scenario des fins tristes ou tragiques, la récurrence des histoires qui finissent en pointillé ou qui finissent mal, édifient à contre-courant des trajectoires héroïques anti-épiphaniques : ici le Mal l’emporte sur le Bien. Cette déchéance noircit considérablement la trajectoire des héros romanesques et constitue ainsi un choc pour le lectorat africain frustré par la contre-publicité de l’héroïque. Réécrire le héros sous une perspective de décanonisation semble ne pas aller dans le sens souhaité par Bourneuf et Ouellet : « Le roman peut surprendre, voire tromper l’attente du lecteur, mais il faut surtout que l’histoire se termine bien pour satisfaire et sauver la morale […] ». (47-48). Le romancier devrait écrire une bonne histoire qui tiendrait son lecteur en haleine, qui lui ferait connaître, à la fin, les plaisirs et les vertiges de l’immersion fictionnelle. L’épilogue inverse est plutôt servi au lecteur dans Les soleils des indépendances.
Fama s’est battu pour la justice et le respect de l’autre parce que l’avènement des temps nouveaux devait lui permettre de retrouver sa puissance de chef ou sinon d’accéder d’une manière quelconque au pouvoir. Il n’obtient rien de tout cela. Son histoire remet au goût du jour les difficultés d’ordre matériel, psychologique, et même religieux qui rendent sensible l’inadaptation du personnage aux réalités de l’époque nouvelle.
- L’hypostasie de Fama vue comme inadaptation à un monde des contingences et de l’improbable
Fama est un héros qui se heurte à un monde incompréhensible. Il ne se reconnaît pas dans la nouvelle Afrique. Ce sentiment est facteur de désarroi tragique : « Tant qu’il y aura le sentiment d’aliénation, l’écrivain rappellera le vieux temps, le temps mythique pour ainsi dire où l’homme se sentait dans un monde cohérent dépourvu d’antagonismes. » (sic) (Ohaegbu 116).
Face aux nouvelles réalités, Fama est un homme en fuite. Mais, telle une fatalité, le nouveau visage de l’Afrique hante sa conscience et son parcours narratif en souffre le martyr.Fama incarne l’image d’un personnage déconnecté du nouvel ordre politique,symboliquement en retard par rapport aux événements. « Aux funérailles du septième jour de feu Koné Ibrahima, Fama allait en retard. Il se dépêchait encore, marchait au pas redoublé d’un diarrhéique. Il était à l’autre bout du pont reliant la ville blanche au quartier nègre à l’heure de la deuxième prière; la cérémonie avait débuté ». (Kourouma). L’odyssée de Fama est un non-sens, une dystopie eschatologique :
À partir de là, s’amorce son odyssée à travers un monde qu’il ne comprend pas jusqu’à cette frontière imposée par la barrière qui se dresse absurdement devant lui, le prince du Horodougou, et dont il ne peut pas davantage comprendre la signification :
Un bâtard, un vrai, un déhonté de rejeton de la forêt et d’une maman qui n’a sûrement connu ni la moindre bande de tissu, ni la dignité du mariage osa, sortir de sa bouche que Fama étranger ne pouvait pas traverser sans carte d’identité ! Avez-vous bien entendu ? Fama étranger sur cette terre de Horodougou ! [Le monde est-il renversé?] (Kourouma 103-104).
En dernier lieu, le tragique de l’inadaptation est collectif, celui de toute une population. Dans Les soleils des indépendances, Fama est la figure hypostasiée du mal de vivre et de l’impossible alchimie du changement, les difficultés de vivre les mutations de l’ère des indépendances. La tragédie subie par le prince Fama rappelle les contradictions sociales d’une époque que l’on retrouve au travers des vécus des populations de la Côte des Ebènes dont les représentants romanesques pourraient être, entre autres : Okonkwo, Mélédouman, etc.
À travers le destin d’Okonkwo, un notable de son clan, Chinua Achebe évoque le choc culturel qu’a représenté pour les autochtones l’arrivée des Britanniques. Presque coupés de l’extérieur, les habitants de la forêt équatoriale pouvaient imaginer un monde à leur image, fait de multiples dieux, de culte des ancêtres, de rites et de tabous. L’irruption des Européens et de leur religion, le christianisme, bouleverse toutes les croyances traditionnelles, d’où le titre du roman Le monde s’effondre.
Mélédouman, dans La Carte d’identité de Jean-Marie Adiaffi, est un prince agni requis à se présenter au bureau du commandant de cercle, Kakatika, pour attester de son identité en raison d’un doute sur le document produit. Faute d’avoir pu, séance tenante, administrer la preuve de son identité, le prince est molesté et jeté en prison, fers aux poings. L’arrestation puis l’emprisonnement de ce prince qui incarne une autorité et un pouvoir évidents dans son milieu culturel, suscite l’émoi et la consternation de son peuple, car celui-ci voue une véritable vénération à la royauté. Finalement, le prince Mélédouman a été innocenté. Mais, au-delà du microcosme africain, le malaise s’étale au macrocosme, c’est-à-dire l’univers extérieur au petit monde, voire toutes les sociétés traditionnelles mises en présence des contraintes modernes et contemporaines et qui vivent un sort similaire.
Conclusion
Ahmadou Kourouma assigne en définitive à l’héroïsme problématique de Fama un tracé narratif dont le crédit idéologique procède des boulimies matérielles, des tensions psychologiques et des radicalismes religieux d’une société africaine réfractaire aux innovations socio-politiques de l’après-indépendance. Dans Les Soleils des indépendances l’émotion du lecteur est assujettie à la tragédie des personnages “désarticulés”, au fondamentalisme culturel des Anciens et à la désillusion collective. Kourouma réinvente principalement l’opposition entre la tradition et le modernisme en désavouant les monolithismes et les clichés du jeu des acteurs. Le récit porte, en particulier, ses enjeux et ses priorités sur les dividendes politiques (les nouveaux pouvoirs), sociologiques (les nouvelles classes sociales) et philosophiques (les nouvelles valeurs).
Le sens de l’honneur est désormais une vue de l’esprit et la dignité n’est plus d’école. Fama quitte sa posture élogieuse et aliène son existence dans une errance macabre. Le héros perd ses insignes d’essence et opte plutôt pour un nihilisme moral et une fronde irrévérencieuse. La figure héroïque dont Fama est l’incarnation prend sa force dans une scénographie de l’horreur où les descriptions sont vives, amplifiées et portées à un haut niveau de cruauté.
Des stratégies textuelles et narratives et des procédés rhétoriques sont au service de la représentation. Ils ont été forgés par l’écrivain comme les instruments adéquats pour s’exprimer de manière sincère et sentie. De même, l’art visuel et réaliste des descriptions, l’expressivité du discours sont subordonnés à la volonté de décrire exactement et de témoigner d’une tragédie universelle : « Fama est un authentique héros tragique dans la mesure où toute une société riche de traditions meurt avec lui […] ». (Kourouma 185). Ainsi le roman de Kourouma rejoint « l’universelle condition humaine » d’André Malraux.[3]
Travaux cités
Aloysius Umunnakwe, Ohaegbu. « Autour de l’évocation du passé dans la littérature africaine », Présence francophone, 23, (automne 1981) : 110-120.
———- « Les Soleils des Indépendances ou le drame de l’homme écrasé par le destin », dans Présence africaine Nouvelle série, 90 (1974) : 253-260.
Ano Boadi, Désiré. « Roman africain postcolonial et nouvelles formes d’héroïté : entre hyperréalisme caricaturesque et contrecoups de l’anti-épique ». Revue de Littérature & d’Esthétique Négro-Africaines. 2. 16 (2016) : 76-90.
Barthes, Roland. L’analyse structurale du récit. Paris : Seuil, “Points”, 1981.
Belorgey, Jean-Michel. « Grandeurs et servitudes de la transgression », in Gautheron M. (dir), L’honneur. Image de soi ou don de soi : un idéal équivoque. Paris, Autrement (1991) : 190-199.
Biard, Michel. « Anne Simonin, Le déshonneur dans la République. Une histoire de l’indignité 1791-1958 », Annales historiques de la Révolution Française, 2009 [En ligne], 357 juillet-septembre, mis en ligne le 09 décembre 2009, URL:http://journals.openedition.org/ahrf/10665; DOI :https//doi.org/10.4000/ahrf.10665, consulté le 15 janvier 2021.
Billacois, François. « Flambée baroque et braises classiques ». Gautheron M (dir), L’honneur. Image de soi ou don de soi : un idéal équivoque. Paris, Autrement (1991) : 69-81.
Bourneuf, Roland et Ouellet, Réal. L’univers du roman. Paris : PUF, 1972.
Drevillon, Hervé et Venturino, Diego. « Penser et vivre l’honneur à l’époque moderne ». Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2011, www.pur-editions.fr, consulté le 3 février 2021.
Goffman, Erving. La mise en scène de la vie quotidienne. Paris : Les Editions de Minuit, Tomes 1 et 2, 1973.
Green, André. « L’honneur et le narcissisme », in Gautheron M (dir), L’honneur. Image de soi ou don de soi : un idéal équivoque. Paris, Autrement (1991) : 37-52.
Jouve, Vincent. L’Effet-Personnage dans le roman. Paris : Presses Universitaires de France, Collection « Écriture », 1992.
Kourouma, Ahmadou. Le diseur de vérité, acte I. 1999
Kourouma, Ahmadou. Les soleils des indépendances. Paris : Seuil, 1970.
Littré, Emile. Dictionnaire de la langue française. Paris : Hachette, t. 2040-2043, 1874.
Martel, Rémy. La foule. Paris : Larousse, 1972.
Mellier, Denis. La littérature fantastique. Paris : Éd. du Seuil, 2000.
Mellier, Denis. L’écriture de l’excès : fiction fantastique et poétique de la terreur. Paris : H. Champion, 1999.
Nicolas, Jean-Claude. Comprendre Les Soleils des Indépendances d’Ahmadou Kourouma. Paris : Seuil, 1985.
Roberge, Martine. L ‘art de faire peur : des récits légendaires aux films d’horreur. Québec : Les Presses de l’Université Laval, 2004.
Vaïs, Michel. L’écrivain scénique. Paris : PUQ, 1978.
Comment citer cet article :
MLA : Danho, Yayo Vincent. «Le prince Fama dans Les soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma : Des honneurs à l’horreur.» Uirtus 1.1 (août 2021): 34-50.
[1] Pour Furetière, le terme honneur signifie, entre autres, « témoignage d’estime ou de soumission qu’on rend à quelqu’un par ses paroles, ou par ses actions » ; « se dit en général de l’estime qui est due à la vertu & au mérite » ; « s’applique plus particulièrement à deux sortes de vertus, à la vaillance pour les hommes, & à la chasteté pour les femmes » ; « se dit aussi de la chose qui honore, qui donne de la gloire », etc. (Furetière A., Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes, La Haye-Rotterdam, 1690, article Honneur). Dans le Dictionnaire de l’Académie française : l’honneur est : « action, démonstration extérieure par laquelle on fait connaître la vénération, le respect, l’estime qu’on a pour la dignité, ou pour le mérite de quelqu’un » ; honneur « signifie encore, Vertu, probité » ; « se prend aussi pour la gloire qui suit la vertu, pour l’estime du monde, & pour la réputation » ; « se prend aussi pour Dignité, Charge ; mais en ce sens il n’a d’usage qu’au pluriel » (Le dictionnaire de l’Académie française, Paris, 1694, article Honneur).
[2]– Dans son ouvrage La littérature fantastique, Denis Mellier reprend cette catégorisation en remplaçant le fantastique de la représentation par le fantastique de la présence. Bien que l’analyse de ces catégories reste sensiblement la même, Mellier renomme quelques éléments étudiés en regard de chacune de ces tendances : la stratégie ou programme textuel dans le fantastique de la représentation devient l’enjeu dans le fantastique de la présence et l’écriture dans le premier type de fantastique a dorénavant pour nom la poétique dans le second.
[3]– La Condition humaine est un roman d’André Malraux. Dans ce roman, Malraux définit ses personnages comme des types de héros en qui s’unissent la culture, la lucidité et l’aptitude à l’action. Mais ne sont-ils pas également plongés en permanence dans la boue de la condition humaine, alternance de grandeur et de déchéance ? Kyo se suicide dans l’espoir d’une fusion fraternelle. Mais cet espoir est illusoire. Tout le tragique de la condition humaine est là. L’angoisse eschatologique se double dans l’impossible dépassement de soi, de l’appréhension face à sa propre conscience. La vie est absurde, et l’homme incapable de savoir qui il est. N’y a-t-il pas corrélation entre les faits décrits et l’histoire de Fama ? (Nous soulignons).



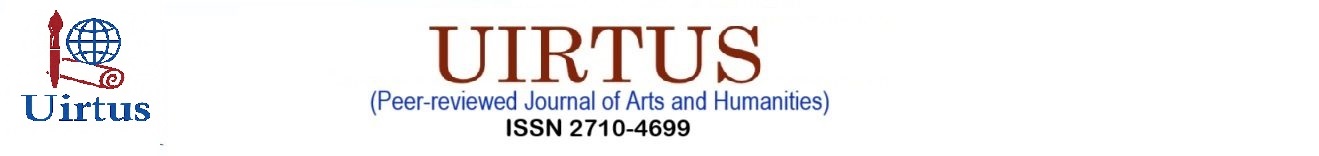
Pingback: Uirtus Vol 1 N° 1 – uirtus